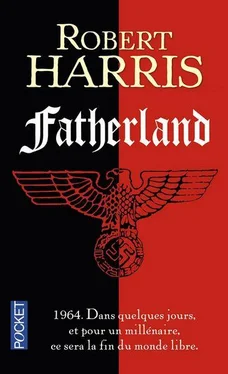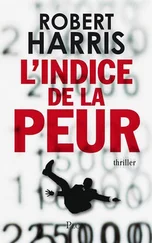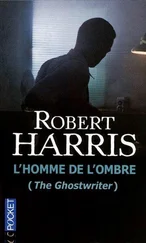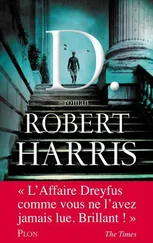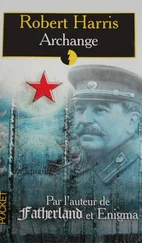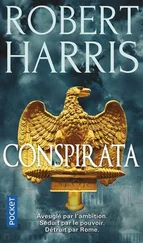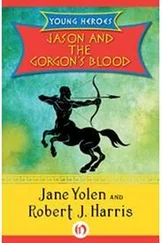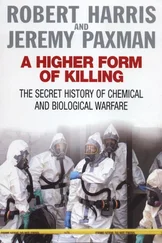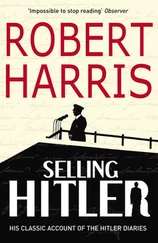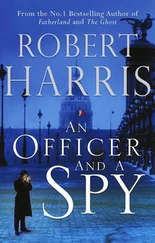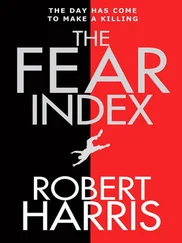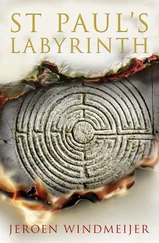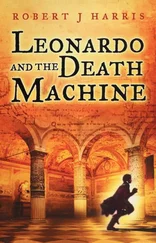Notes sur une visite à Auschwitz-Birkenau par Martin Luther, sous-secrétaire d’État, ministère des Affaires étrangères du Reich
(Manuscrit, 11 pages)
14 juillet 1943
Enfin, après presque trois ans de demandes réitérées, je reçois l’autorisation d’accomplir une tournée d’inspection complète du camp d’Auschwitz-Birkenau pour compte du ministère des Affaires étrangères.
J’atterris à l’aéroport de Cracovie en provenance de Berlin, peu avant le coucher du soleil, et je passe la soirée chez le gouverneur-général Hans Frank, avec le secrétaire d’État Josef Bühler et leur état-major au château de Wawel. On doit me prendre demain à l’aube au château pour me conduire au camp (durée du trajet : environ une heure) où je dois être reçu par le commandant, Rudolf Höss.
15 juillet 1943
Le camp. Ma première impression est à l’échelle de l’installation qui mesure, selon Höss, environ 2 km sur 4 km. La terre est une argile jaunâtre, semblable à celle de Silésie orientale ; un paysage de désert, interrompu de-ci de-là par le vert de quelques bouquets d’arbres. À l’intérieur du camp, s’étirant bien au-delà de mon champ de vision, des centaines de baraquements de bois aux toits couverts de papier bitumé vert. Au loin, dans les allées, je vois des petits groupes de captifs en vêtements rayés bleu et blanc : certains portent des planches, d’autres des bêches et des pioches ; quelques-uns chargent des grandes caisses sur des camions. Une odeur particulière flotte sur l’endroit.
Je remercie Höss pour son accueil. Il m’explique les dispositions administratives. Ce camp est sous la juridiction SS de l’Office central d’administration économique. Les autres camps, dans le district de Lublin, sont sous l’autorité du SS-Obergruppenführer Odilo Globocnik. Les contraintes du service empêchent malheureusement Höss de me faire personnellement les honneurs du camp ; il me confie aux bons soins d’un jeune SS-Untersturmführer, Weidemann. Il ordonne à Weidemann de faire en sorte que tout me soit montré et qu’il soit répondu à toutes mes questions. Nous commençons par un petit déjeuner dans la caserne des SS.
Après la collation, nous partons en voiture vers le secteur sud du camp. Ici : un embranchement ferroviaire, d’approximativement 1,5 km de long. De chaque côté : des barbelés soutenus par des pylônes de béton et aussi des miradors de bois avec nids de mitrailleuses. Il fait déjà chaud. L’odeur est épouvantable, un million de mouches bourdonnent. À l’ouest, au-dessus des arbres : une cheminée d’usine en brique rouge, de section carrée, crache sa fumée.
7 h 40 du matin : la zone le long de la voie ferrée commence à se garnir d’hommes de la SS, certains avec des chiens, mais aussi de détenus des corvées spéciales désignés pour les assister. On entend au loin le sifflet d’un train. Quelques minutes plus tard, la locomotive franchit lentement le portique d’entrée ; les jets de vapeur soulèvent des nuages de poussière jaune. La machine stoppe à notre hauteur. Les portes se referment derrière le convoi. Weidemann : « C’est un transport de Juifs de France. »
J’estime la longueur du train à une soixantaine de wagons de marchandises, à hautes parois de bois. La troupe et les prisonniers spéciaux se postent tout autour. Les portes sont déverrouillées et ouvertes. D’un bout à l’autre du train on crie les mêmes mots : « Tout le monde descend ! Emmenez les bagages à main ! Laissez les bagages lourds dans les voitures ! » Les hommes passent la tête en premier, éblouis par la lumière, et sautent sur le sol — un mètre cinquante — puis se retournent pour aider les femmes, les enfants, les vieillards, et pour recevoir les bagages.
L’état des déportés : pitoyable ; sales, poussiéreux, gesticulant, brandissant des bols et des tasses en direction de leurs bouches, pleurant de soif. Derrière eux, gisant dans les voitures, les morts et ceux qui sont trop mal en point pour bouger. Weidemann explique que leur périple a commencé il y a quatre nuits. Les gardes SS poussent ceux qui sont capables de marcher sur deux rangs. Les familles séparées s’appellent. Avec beaucoup de gestes et de cris, les deux colonnes s’en vont dans des directions différentes. Les hommes valides se dirigent vers le camp de travail. Le reste avance vers l’écran d’arbres ; Weidemann et moi à leur suite. En regardant derrière, je vois les détenus en tenue rayée grimper dans les wagons et sortir les bagages et les corps.
8 h 30 : Weidemann estime la colonne à environ deux milles individus — femmes portant des nourrissons, enfants pendus à leurs jupes, vieillards des deux sexes, adolescents, malades. Ils marchent en rang par cinq sur un chemin en cendrée, trois cents mètres environ, puis à travers une cour, puis par un autre chemin jusqu’à douze marches de béton menant à une immense chambre souterraine, cent mètres de long. Un panneau annonce en plusieurs langues (allemand, français, grec, hongrois) : « Bains et salle de désinfection. » C’est bien éclairé, avec de nombreux bancs, des centaines de patères numérotées.
Les gardes crient : « Tout le monde se déshabille ! Vous avez dix minutes ! » Les gens hésitent, échangent des regards. L’ordre est répété plus rudement, et cette fois, avec inquiétude mais dans le calme, ils obtempèrent. « Retenez votre numéro de patère afin de pouvoir récupérer vos effets ! » Les détenus en régime spécial circulent parmi eux, murmurent des encouragements, aident les plus faibles — de corps ou d’esprit — à se dévêtir. Certaines mères tentent de dissimuler les nourrissons dans les tas de vêtements, mais les enfants sont rapidement découverts.
9 h 05. Nue, la foule franchit les grandes portes de chêne flanquées de gardes et claudique jusqu’à une autre chambre, semblable à la première mais totalement dégarnie, à l’exception de quatre grands piliers carrés à vingt mètres d’intervalle. Au bas de chaque pilier, une plaque de métal percée d’orifices. Le local se remplit, les portes se ferment. Weidemann me fait signe. Je le suis par le vestiaire désert ; nous remontons les marches de béton, jusqu’à l’air libre. J’entends le bruit d’un moteur de voiture.
Sur le gazon qui recouvre le toit de l’installation, une petite camionnette s’avance en cahotant, marquée des couleurs de la Croix-Rouge. Elle s’arrête. Un officier SS et un médecin en sortent, munis de masques à gaz et portant quatre boîtes métalliques. Quatre conduits de béton émergent de l’herbe, à vingt mètres l’un de l’autre. Le médecin et l’officier soulèvent les couvercles et versent une substance mauve granulée. Ils ôtent leurs masques, allument une cigarette au soleil.
9 h 09 : Weidemann me ramène en bas. Le seul bruit est un tambourinement étouffé à l’autre bout de la pièce, derrière les valises et les piles de vêtements encore chauds. Un petit judas de verre est enchâssé dans les panneaux de chêne. J’y colle un œil. La paume d’un homme frappe contre l’ouverture ; je rejette brusquement la tête en arrière.
Un garde dit : « L’eau des douches doit être particulièrement chaude ce matin pour qu’ils hurlent comme ça. »
À l’extérieur, Weidemann m’annonce : « Nous devons attendre vingt minutes. Est-ce que le Canada vous intéresse ? » Je dis : « Le quoi ? » Il rit : « Le Canada — une section du camp. Pourquoi Canada ? — Il hausse les épaules — Personne ne sait. »
Canada. 1 km au nord de la chambre à gaz. Très vaste espace couvert, rectangulaire, un mirador à chaque coin, entouré de barbelés. Des montagnes d’effets personnels — malles, sacs à dos, valises, sacs de voyage, paquets, couvertures, landaus, chaises roulantes, membres artificiels… Des brosses, des peignes… Weidemann : chiffres établis pour le RF-SS concernant les biens personnels récemment envoyés au Reich : chemises d’hommes, 132 000 ; manteaux de femmes, 155 000 ; cheveux de femmes, 3 000 kg (« Un wagon de marchandises ») ; vestes de garçons, 15 000 ; robes de filles, 9 000 ; mouchoirs, 135 000. Je reçois une trousse de médecin, remarquablement manufacturée, comme souvenir, Weidemann insiste.
Читать дальше