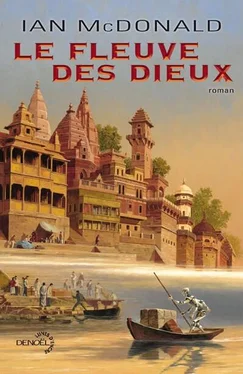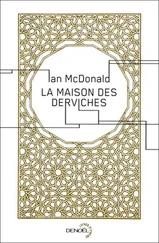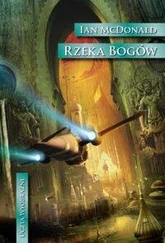Eil aurait dû prendre l’argent. Le liquide dans son sac file comme de l’eau sur du sable. Celles de ses cartes de crédit qui n’ont pas encore atteint leur plafond en approchent. Un crore de roupies, qui ne laissent aucune trace et sont acceptées partout, un crédit qui pourrait l’emmener n’importe où. À n’importe quel endroit de la planète. Mais cela reviendrait à accepter son rôle. Qui a écrit que Tal devait être puni ? Laquelle de ses actions mérite l’opprobre général ? Eil considère sa petite vie, décortique les terribles vulnérabilités qui l’ont transformée en une arme politique aveugle. Étranger, seul, isolé, nouveau. Ils l’observaient depuis son arrivée en shatabdi. Tranh, la nuit de délire torride à l’hôtel de l’aéroport – jamais eil n’avait connu un tel plaisir sexuel –, la fête au temple, l’invitation couleur crème au bord doré qu’eil avait exhibée partout au bureau comme une icône… Chacun des verres déversés dans sa précieuse gorge… On avait joué d’eil comme d’une bansurî.
S’apercevant qu’eil serre les poings de fureur, Tal est surpris par l’intensité de sa colère. Un neutre raisonnable, sain d’esprit, sage prendrait la fuite. Mais eil veut savoir. Veut regarder une bonne fois en face le visage qui a décrété tout cela pour eil.
« Bon, l’ami, je ne vous emmène pas plus loin. » Le chauffeur agite sa radio. « Ces cinglés du Shivajî ont la bougeotte. Ils se sont échappés du rond-point Sarkhand.
— Vous m’abandonnez avec eux dans les parages ? » crie Tal au phut-phut qui s’éloigne. Eil entend la rage de Hindutvâ enfler et refluer dans les canyons des rues. Et celles-ci s’éveillent, échoppe après boutique après kiosque après dhâbâ. Une camionnette décharge des ballots de journaux du matin sur le béton du terre-plein central. Les crieurs de journaux affluent comme des milans noirs. Craignant que ses traits le trahissent, Tal relève son col. Son crâne rasé lui semble affreusement vulnérable, un fragile œuf marron. Deux routes jusqu’à la sécurité. Eil voit les façades émaillées de paraboles satellite de White Fort derrière les panneaux solaires et les réservoirs d’eau sur les toits. Eil se glisse le long de la file de véhicules, tête baissée, évitant de croiser le regard des commerçants qui remontent leurs rideaux de fer et des ouvriers des équipes de nuit qui reviennent d’une période de travail à l’heure de la côte Pacifique. Tôt ou tard, plus tôt que tard, quelqu’un verra ce qu’eil est. Tal jette un coup d’œil aux ballots de journaux. Une, gros titres, photos couleur.
Le bruit de la foule se déplace dans son dos, à gauche, puis à droite, puis tout près dans son dos. Tal se met à courir à petites foulées, le manteau collé au menton malgré la chaleur croissante. Les gens regardent, maintenant. Encore un carrefour. Encore un carrefour. Le rugissement sans voix se déplace à nouveau, semble désormais devant, puis gagne d’un coup en volume et en véhémence. Tal jette un coup d’œil de tous côtés. Ils sont derrière. Une rangée d’hommes en chemise blanche débouche au petit trot sur l’avenue depuis une rue latérale. Il y a un moment de silence. La circulation elle-même s’immobilise et se tait. Puis un rugissement ciblé frappe Tal avec une force presque physique. Eil laisse échapper un petit gémissement de peur, jette son stupide manteau encombrant pour se mettre à courir. Des glapissements et des aboiements s’élèvent dans son dos. Les kârsevaks bondissent à sa poursuite. Pas loin. Pas loin. Pas. Loin. Pas. Loin. Pas. Loin. Tout. Près. Tout. Près. Tal se lance dans la forêt de piliers qui soutiennent White Fort. Des cris et mugissements résonnent, s’écrasent sur les piliers en béton. On se rapproche. On est rapides. Plus rapides que toi, petite chose pervertie et contre nature. Petite chose bourrée de vice et d’anormalité. On va te piétiner, mollusque. On va t’entendre exploser sous nos bottes. Des projectiles tombent et rebondissent : canettes, bouteilles, fragments de vieux circuits. Et Tal faiblit, faiblit. Se fane. Il ne reste plus rien en eil. Les batteries sont à plat. À zéro. Tal tapote les commandes subdermiques de son avant-bras. Quelques secondes plus tard, la décharge d’adrénaline se produit. Eil la paiera plus tard, au prix fort. Eil paierait n’importe quel prix, maintenant. Tal reprend de l’avance sur ses poursuivants. Voit les ascenseurs. Fais qu’il y en ait un. Ardhanârîshvara, dieu des choses divisées, fais qu’il y en ait un, et qu’il fonctionne. Les chasseurs claquent des mains sur les piliers de béton huileux. On. Vient. Te. Tuer. On. Vient. Te. Tuer.
Lumière verte. La lumière verte est salut, la lumière verte est vie. Tal plonge vers la lumière verte de l’ascenseur dès que les portes s’écartent. Eil se glisse dans la fente sombre, écrase le bouton. Les portes se referment. Des doigts s’insinuent entre elles, cherchant les capteurs, les interrupteurs, la chair à l’intérieur, n’importe quoi. Centimètre par centimètre, ils écartent les portes.
« Il est là, ce chûtiyâ ! »
Eil ! Eil ! hurle intérieurement Tal en écrasant les doigts avec ses poings, avec les talons pointus de ses chaussures. Les doigts se retirent. Les portes se collent l’une à l’autre. L’ascension commence. Tal s’arrête deux étages en dessous du sien pour les attirer, attend que les portes s’ouvrent et se referment, puis monte à l’étage supérieur au sien. Alors qu’eil redescend sans bruit par l’escalier, dont les marches luisant du passage régulier de pieds nus puent l’ammoniaque humide même en pleine sécheresse, eil entend, de plus en plus nettement, des gens discuter. Tal tourne tout doucement le coin. Ses voisins sont massés dans la porte ouverte de Mâmâ Bhârat. Tal descend une autre marche. Tout le monde parle, gesticule, certaines femmes, horrifiées, se pressent le dupattâ sur la bouche. Certaines s’inclinent et se relèvent dans les rituels du chagrin. Les voix des hommes tranchent dans les bavardages et les mélopées, un mot ici, une phrase là. Oui, la famille vient, elle arrive, qui aurait laissé une vieille femme ici toute seule, une honte, une honte, la police les trouvera.
Encore un pas.
La porte de l’appartement de Mâmâ Bhârat, enfoncée, gît sur le sol. Par-dessus la tête des hommes furieux, Tal voit la pièce profanée. Murs, fenêtres, peintures de dieux et d’avatars sont constellés de trous. Tal en reste ébahi, refuse de comprendre. Des balles ont percé ces trous. C’est un ébahissement trop long. Un cri.
« Il est là ! »
La voix plaintive de Paswan, son voisin. La foule s’écarte, ouvrant une relation directe entre Tal, le doigt accusateur de Paswan et les pieds par terre. Tout le monde tourne la tête. Ils ont les pieds dans une mare de sang. Une mare étonnamment brillante de sang frais et rouge, frais de vie et d’oxygène, qui déjà attire les mouches. Les mouches sont dans la pièce. Les mouches sont dans la tête de Tal.
On peut se passer de toi, maintenant , avait dit Tranh.
Les pieds dans du sang frais, luisant. Ils sont encore dans l’immeuble. Eil fait demi-tour, se remet à courir.
« Il est là, le monstre ! » rugit Paswan. Les voisins de Tal reprennent le cri. La voix collective vrombit dans le puits de béton de la cage d’escalier. Tal agrippe la rampe métallique à pleines mains, se hisse vers le haut. Son corps entier est douleur. Son corps entier hurle, gémit, l’avertit qu’il est proche de la fin, qu’il n’en peut plus. Mais Mâmâ Bhârat est morte. Mâmâ Bhârat a été abattue et par ce matin d’août avec l’aube qui descend de la coupole crasseuse tout là-haut par les flancs de la cage d’escalier, la haine, le mépris, la peur et la colère du Bhârat sont tout entiers focalisés sur un neutre en train de grimper des marches en béton. Ses voisins, les gens au milieu desquels eil vivait si paisiblement ces derniers mois, veulent déchirer son corps de leurs mains.
Читать дальше