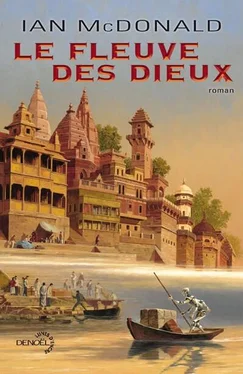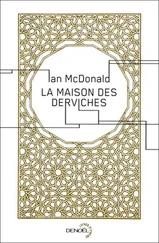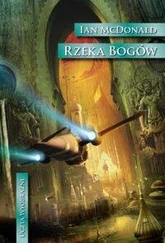— Madame la… Madame Rânâ, nous ne savons pas…
— Qui d’autre ? Vous n’êtes pas aussi intelligent que vous le pensez, Khan. Aucun de nous ne l’est. Votre démission est acceptée. » Sajida Rânâ serre alors les dents et écrase le poing sur la rambarde de calcaire sculpté. Du sang se met à couler de ses phalanges. « Pourquoi vous m’avez fait ça ? Je vous aurais tout donné. Et votre femme, vos garçons… Pourquoi les hommes risquent-ils ces choses ? Je vous désavouerai.
— Bien entendu.
— Je ne peux plus vous protéger. Shahîn, je ne sais pas ce qu’il va vous arriver maintenant. Disparaissez de ma vue. Si on est encore vivants demain, on pourra s’estimer heureux. »
Pendant que Shahîn Badûr Khan repart sur le gravier ratissé en direction de la voiture officielle, les arbres et buissons obscurs autour de lui s’illuminent de chants d’oiseaux. Il s’imagine un moment qu’il s’agit, résonnant dans son oreille interne, du chant produit par tous les mensonges qui constituent sa vie en se frottant les uns aux autres dans leur envol collectif vers le jour. Il se rend compte ensuite que c’est l’ouverture du chœur de l’aube, les oiseaux messagers qui chantent au plus profond de la nuit. Shahîn Badûr Khan s’arrête, se tourne, lève la tête, écoute. L’air est chaud mais d’une présence et d’une propreté pénétrante. Il respire de pures ténèbres. Il sent la présence des cieux comme un dôme au-dessus de lui, chaque étoile une épingle de lumière descendant percer son cœur. Shahîn Badûr Khan sent l’univers tourner autour de lui. Il est à la fois axe et moteur, sujet et objet, tourné et tourneur. Une chose minuscule, une petite chanson au milieu d’innombrables autres perdues dans le noir. Le temps aplanira ses faits et méfaits, l’histoire aplatira son nom dans la poussière générale. Ce n’est rien. Pour la première fois depuis que ces petits pêcheurs se sont éclaboussés et aventurés dans le crépuscule kéralais, il comprend libre. La joie s’embrase dans le puits de son manipûra-chakra. Le moment sûfi de désintéressement, d’intemporalité. Dieu dans l’inattendu. Il ne le mérite pas. Le mystère est que cela n’arrive jamais à ceux qui s’imaginent le mériter.
« Destination, sahb ? »
Responsabilités. Après l’illumination, le devoir.
« La havelî. » Tout est plus facile, maintenant. Une fois dits, les mots sont faciles à répéter. Sajida Rânâ avait raison. Il aurait dû lui en parler d’abord. L’accusation l’avait surpris : Shahîn Badûr Khan s’était vu rappeler, sévèrement, qu’il avait pour Premier ministre une femme, une femme mariée qui refusait de prendre le nom de son mari. Il polarise la fenêtre pour se protéger des regards indiscrets.
Bilqis ne mérite pas ça. Elle mérite un bon mari, un vrai homme qui, même si elle ne l’aime plus et ne partage plus ni son lit ni sa vie, ne la déshonorerait pas en public, sourirait, dirait ce qu’il faut, ne lui ferait jamais se couvrir le visage de honte au milieu du Cercle des Dames de la Loi. Il avait tout eu – comme Sajida Rânâ l’avait dit –, et ne pouvait pourtant s’empêcher de détruire tout cela. Il méritait vraiment ce qui lui était arrivé. Puis, sur le cuir des sièges craquelé par le soleil d’une voiture gouvernementale bhâratîe, Shahîn Badûr Khan change d’opinion. Il ne mérite pas cela. Personne ne le mérite, et tout le monde le mérite. Qui peut garder la tête droite, et qui se permettrait de juger ? Il est un bon conseiller, le meilleur. Il a servi son pays avec sagesse et dévouement. Celui-ci a encore besoin de lui. Peut-être pourrait-il se réfugier dans l’obscurité, s’enfouir comme un crapaud au fond de la boue en attendant la fin de la sécheresse.
Un début de lumière se répand dans les rues où la voiture officielle bourdonne doucement, comme un papillon de nuit. Shahîn Badûr Khan s’autorise un sourire dans son cube de verre noirci. La voiture prend le virage où le sâdhu est assis sur une dalle de béton, un bras maintenu en l’air par une sangle reliée à un lampadaire. Shahîn Badûr Khan connaît le truc : on finit par perdre toute sensation. L’automobile s’arrête d’un coup. Shahîn Badûr Khan doit tendre les mains pour ne pas tomber.
« Qu’est-ce qui se passe ?
— Des ennuis, sahb. »
Shahîn Badûr Khan dépolarise la fenêtre. La route devant lui est bloquée par la circulation du matin. Les gens ont quitté leurs taxis et s’appuient aux portières ouvertes pour observer ce qui les a arrêtés. Des corps défilent par le carrefour : des hommes indistincts en chemise blanche et pantalon foncé, des jeunes hommes avec leur première moustache, qui avancent à petites foulées régulières et rageuses en levant et abattant d’un coup leurs lâthîs. Une batterie de percussionnistes passe, un groupe de femmes au visage farouche et anguleux vêtues de rouge Kâlî, puis des nâgâ sâdhus, blancs de cendres, qui brandissent de grossiers trishûlas de Shiva. Shahîn Badûr Khan voit pesamment arriver une immense effigie rose de Ganesh en papier mâché, criarde, presque fluorescente dans les premières lueurs du jour. Elle oscille bord à bord, dirigée avec une certaine maladresse par des marionnettistes aux jambes nues. Derrière Ganesh, un spectacle encore plus extraordinaire : les ondulations orange et la flèche rouge d’un râthayâtra. Et des torches. Dans chaque main, avec chaque accompagnateur ou coureur, du feu. Shahîn Badûr Khan ose entrouvrir la fenêtre. Une avalanche de sons lui tombe dessus : un vaste rugissement inachevé. Des voix s’en détachent, entonnent un thème, se fondent à nouveau : des chants, des prières ; des slogans, des hymnes nationalistes ou kârsevaks. Il n’a pas besoin d’entendre les paroles pour savoir qui sont ces gens. Le grand tourbillon de manifestants qui encerclait le rond-point Sarkhand se déverse désormais dans Vârânacî. Cela ne peut arriver que s’il a plus important à détester. Shahîn Badûr Khan sait où ils vont avec du feu dans les mains. L’information a filtré. Il avait espéré disposer de davantage de temps.
Shahîn Badûr Khan regarde par-dessus son épaule. La route est encore dégagée.
« Sors-moi de là. »
Gohil obtempère sans discuter. La grande automobile recule, fait demi-tour, klaxonne brutalement les autres véhicules en montant sur le terre-plein central en béton pour redescendre sur la chaussée opposée. Alors qu’il noircit les fenêtres, Shahîn Badûr Khan aperçoit des volutes de fumée monter à l’est dans le ciel, huileuses sur le jaune de l’aube comme de la graisse en feu sortant d’un bûcher funéraire.
Le phut-phut roule sans destination précise. Comme Tal a dit au chauffeur en lui jetant une poignée de roupies : roulez, c’est tout.
Il lui faut s’enfuir. Abandonner emploi, logement, tout ce qu’eil s’est acquis à Vârânacî. Aller quelque part où personne ne connaît son nom. Mumbaï. Retourner à maman Mumbaï. Trop près. Trop rosse. Tout au sud, Bengaluru, Chennaï. Ils ont une importante industrie des médias, là-bas. Un bon décorateur y trouvera toujours du travail. Même Chennaï pourrait ne pas être assez loin. Si seulement eil pouvait changer à nouveau de nom, de visage. Eil pourrait passer par Patna, acheter de nouvelles opérations chirurgicales à Nânak. Les faire mettre sur sa note. Si Nânak acceptait de lui faire encore crédit. Tal aurait très vite besoin de travail. Oui, c’est cela : prendre toutes ses affaires, puis le chemin de la gare, et une fois à Patna, une nouvelle identité.
Tal tapote l’épaule du chauffeur. « White Fort.
— Pas à cette heure de la nuit.
— Je vous paierai double. »
Читать дальше