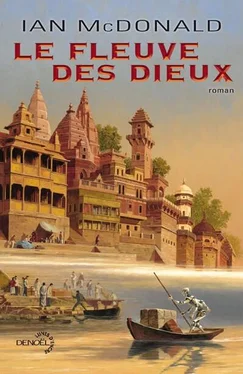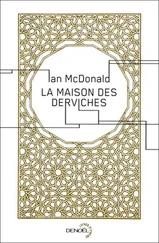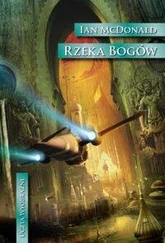L’hiver. Les abricotiers sont nus ; de la neige sèche, piquante comme du sable, n’a pu s’empêcher de dériver contre le mur blanc taché d’eau. Les montagnes semblent assez proches pour irradier du froid. Elle se souvient qu’ils habitaient la dernière maison du quartier. Devant son portail, les rues s’interrompaient au profit d’une friche nue qui continuait jusqu’aux collines. Derrière le mur, il y avait le désert, le rien. La dernière maison de Kaboul. En toute saison, le vent hurlait sur la grande plaine et venait se briser sur le premier objet vertical qu’il trouvait. Elle ne se souvient pas que les abricotiers aient jamais donné un seul fruit. Elle-même se trouve là dans son duffle-coat à capuche fourrée, les pieds dans ses bottes en caoutchouc, les mains dans des moufles reliées à un fil passant par les manches, parce qu’elle a entendu du bruit la nuit dernière dans le jardin, alors elle a regardé, mais ce n’étaient ni les soldats ni les méchants étudiants, rien que son père en train de creuser dans le sol meuble entre les arbres fruitiers. Un déplantoir à la main, elle se trouve maintenant sur ce petit monticule de terre fraîchement retournée. Son père est au travail à l’hôpital, où il aide des femmes à avoir des bébés. Sa mère regarde un soap opera indien traduit en pachto à la télévision. Tout le monde le trouve complètement idiot, une perte de temps, tellement indien, mais le regarde quand même. Elle se met à genoux dans ses collants d’hiver côtelés et commence à creuser. Plus profond, plus profond, tordre et pelleter, puis la lame verte émaillée crisse sur du métal. Elle gratte autour et dégage la chose molle et informe que son père a enterrée. Quand elle l’arrache du trou, la prenant pour un chat mort, elle manque la lâcher. Elle comprend ensuite ce qu’elle a trouvé : la sacoche noire. L’autre, celle pour les visites spéciales. Elle tend la main vers le fermoir en argent.
Dans le souvenir de Nadja Askarzadah, le hurlement de sa mère à la porte de la cuisine l’en empêche. Après cela viennent de vagues souvenirs de cris, de voix en colère, de punition, de douleur et peu après, la fuite en pleine nuit dans les rues de Kaboul, allongée sur la barquette arrière avec les réverbères qui défilent d’un coup au-dessus d’elle, un éclat de lumière, deux, trois, quatre. Dans l’enfance virtuelle de l’aeai, le hurlement diminue progressivement de volume pour devenir un lancinant arôme d’hiver, de froid, d’acier et de choses mortes et sèches qui l’aveugle presque. Et Nadja Askarzadah se souvient. Elle se souvient avoir ouvert la sacoche. Sa mère qui se rue à travers la terrasse en bousculant les chaises en plastique qui y résidaient à demeure. Elle se souvient avoir regardé à l’intérieur. Sa mère qui crie son nom mais elle ne lève pas la tête, il y a des jouets à l’intérieur, des jouets de métal brillant, des jouets de caoutchouc noir. Elle se souvient avoir soulevé les objets en métal inoxydable entre ses moufles dans le soleil hivernal : le spéculum, l’aiguille à sutures courbe, la cuillère de curetage, les seringues et tubes de gel, les électrodes, le caoutchouc trapu et strié de la matraque électrique. Sa mère qui la tire à l’écart par la capuche fourrée, qui d’une claque lui fait lâcher les objets en métal et ceux en caoutchouc, qui la jette de l’autre côté du sentier, le gravier durci par le gel qui déchire ses collants et lui érafle les genoux.
Les fines branches des abricotiers s’entrecroisent et projettent Nadja Askarzadah dans un autre souvenir qui ne lui appartient pas. Elle n’est jamais allée dans ce couloir de blocs de béton carrelé en vert, mais elle sait qu’il a existé. C’est une illusion authentique. C’est un couloir que vous pourriez voir dans un hôpital, mais sans l’odeur d’hôpital. Avec de grandes portes battantes translucides d’hôpital ; la peinture écaillée sur les arêtes métalliques trahit la fréquence des passages, et pourtant il n’y a que Nadja Askarzadah dans le couloir vert. De l’air glacial pénètre par les persiennes d’un côté du couloir, de l’autre, il y a des portes avec des noms et des numéros. Nadja franchit un jeu de portes battantes, deux, trois. Chaque fois, le bruit se fait un peu plus fort, le bruit d’une femme qui sanglote, une femme parvenue au-delà de tout, à un endroit où il ne reste ni honte ni dignité. Nadja avance vers ces pleurs. Elle dépasse un chariot d’hôpital abandonné près d’une porte. Un chariot équipé de sangles pour les chevilles, les poignets, la taille. Le cou. Nadja franchit les dernières portes battantes. Les sanglots deviennent gémissements aigus. Ils émanent de la dernière porte à gauche. Nadja l’ouvre, comprimant le solide ressort.
La table occupe le centre de la pièce et la femme le centre de cette table. Un appareil enregistreur est posé près d’elle, relié à un micro au-dessus de sa tête. Nue, immobilisée en croix, la femme a les pieds et les mains liés à des anneaux disposés aux coins de la table. Ses seins, l’intérieur de ses cuisses et son pubis rasé sont marqués de brûlures de cigarettes. Un spéculum chromé brillant ouvre son vagin à Nadja Askarzadah. Un homme en blouse de médecin et tablier vert est assis au pied de la table. Il termine d’enduire de gel de contact une matraque électrique trapue, dilate le spéculum au maximum et glisse la matraque entre les lèvres de métal. Les hurlements de la femme deviennent incompréhensibles. L’homme soupire, jette un coup d’œil à sa fille, l’accueille d’un haussement de sourcils et presse le bouton déclencheur.
« Non ! » hurle Nadja Askarzadah. Il y a un éclair blanc, un rugissement comme si l’univers touchait à sa fin, sa peau chatoie sous le choc synesthésique, elle sent une odeur d’oignon d’encens de céleri de rouille et se retrouve étendue sur le sol du service décors d’Indiapendent, Tal penché sur elle avec dans la main le hoek qu’eil lui a enlevée. Refoulement de déconnexion. Les neurones hésitent. La bouche de Nadja Askarzadah s’agite. Il y a des mots qu’il faut qu’elle dise, des questions qu’elle doit poser, mais elle est expulsée d’un autre monde. Tal lui tend une main fine, lui fait signe avec insistance.
« Venez, cho chweet, il faut partir.
— Mon père, elle a dit…
— Beaucoup de choses, bâbâ. Et j’en ai entendu beaucoup. Veux pas le savoir, c’est entre elle et vous, mais il faut qu’on parte, tout de suite. » Tal saisit par le poignet Nadja Askarzadah étendue sans grâce sur le sol, la hisse sur ses jambes. Sa force surprenante dissipe le nuage de flash-back : abricotiers en hiver, ouverture d’une sacoche noire, traversée d’un couloir vert, la pièce avec la table et l’enregistreur mpeg chromé.
« Elle m’a montré mon père. Elle m’a ramenée à Kaboul, elle m’a montré mon père…»
Tal pousse Nadja par une sortie de secours qui donne sur un bruyant escalier métallique.
« Elle vous a sûrement montré de quoi vous faire parler assez longtemps pour que les kârsevaks arrivent jusqu’à nous. Pânde est passé, ils approchent. Vous êtes trop confiante, bâbâ. Moi qui suis un neutre, je ne me fie à personne, et encore moins à moi-même. Bon, vous venez, ou vous voulez finir comme notre chère Première ministre ? »
Nadja jette un coup d’œil en arrière à l’écran courbe, à la volute chromée du hoek sur le bureau. Des illusions rassurantes. Elle suit Tal comme une enfant. L’escalier est un cylindre vitré de pluie. On se croirait à l’intérieur d’une cascade. Main dans la main, Nadja et Tal dévalent les marches métalliques en direction du signe vert SORTIE.
Thomas Lull pose devant eux la dernière des trois photographies. Lisa Durnau remarque qu’il s’est livré à un tour de passe-passe. L’ordre est inversé : Lisa. Lull. Aj. Une arnaque avec les cartes.
Читать дальше