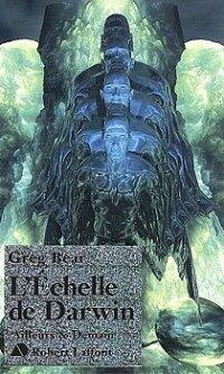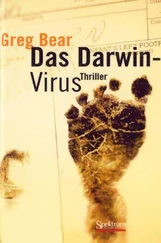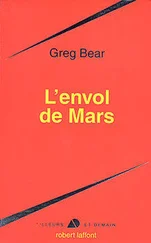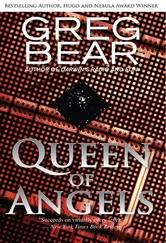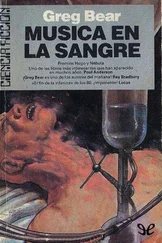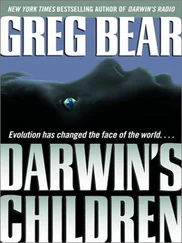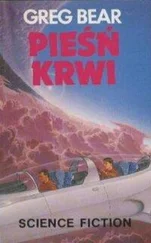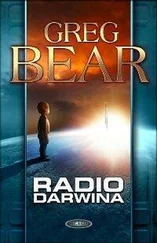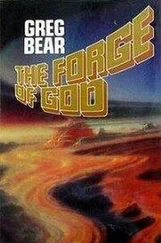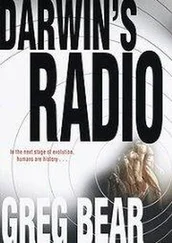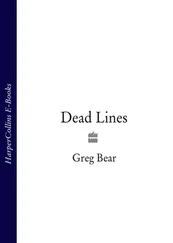Publié dans Gil Blas en octobre 1882 et cité par Madame Bancquart.
J’ai dû abréger cette citation et malheureusement les points de suspension indiquant des coupures interfèrent avec ceux du texte de Maupassant. Le lecteur est prié de se reporter à l’édition citée, pages 628 et 629.
Éditions Coopération, Paris 1939. Le rapprochement entre cette scène et Le Horla est proposé par Bergier et Pauwels dans Le Matin des magiciens , Gallimard, 1960.
Évolution, une théorie en crise , Londreys, Paris, 1988.
Pour étayer cette préface, je me suis servi notamment de l’excellente synthèse de Marcel Blanc, Les Héritiers de Darwin (Seuil, 1990), à laquelle je renvoie mon lecteur. Ce n’est pas l’ouvrage le plus récent mais outre que la théorie néodarwinienne n’a guère connu de bouleversements depuis sa parution, il présente l’avantage de résumer à peu près toutes les positions en présence. Il est aussi plus maniable que l’imposant Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution , sous la direction de Patrick Tort (PUF, 1999, 3 volumes, 4 862 pages, 6 370 grs).
Sur les relations entre paléontologie et théories de l’évolution, voir Éric Buffetaut, Des fossiles et des hommes , Laffont, 1991.
Les Xipéhuz ressemblent beaucoup à certains des Grands Anciens imaginés par H.P. Lovecraft. Il est permis de s’interroger sur la généalogie qui conduit des uns aux autres.
La quasi-simultanéité de la parution du Horla et des Xipéhuz amène à s’interroger sur les raisons de l’échec de la science-fiction française à s’imposer après un si brillant début.
Voir notamment ma préface à Histoires de mutants , Le Livre de Poche n°3766, et celle de Demètre Ioakimidis à Histoires de surhommes , Le Livre de Poche n°3786.
On trouvera cet étonnant roman dans Sur l’autre face du monde et autres romans scientifiques de sciences et voyages , «Ailleurs et demain», Laffont, 1973.
«Ailleurs et demain», Robert Laffont, 2003.
«Ailleurs et demain», Robert Laffont, 2000.
Richard Dawkins, un ultra-darwiniste, entreprend de répondre à cette question dans L’Horloger aveugle , que j’ai publié chez Laffont en 1989, sans convaincre entièrement.
Depuis la rédaction du roman de Greg Bear, des analyses du génome mitochondrial de Néandertaliens semblent bien avoir montré que cette espèce ne pouvait pas être l’ancêtre direct de l’homme moderne mais plutôt une espèce cousine. Toutefois la complexité du mécanisme imaginé par l’auteur peut lui permettre de contourner cette «difficulté».
Mais sans que cette réorganisation ait pour but de faire face à ce stress, contrairement à ce qui se passe dans le roman de Bear.
Voir Denis Buican, Darwin et le darwinisme (PUF, 1987) et La Présélection génotypique et le modèle évolutif (La Pensée et les hommes, Bruxelles, 1980).
Le Livre de Poche n°7234. Dans ma préface à ce roman, j’aborde également les questions de l’origine de la vie et des débuts de l’évolution.
Ces taches rappellent celles de certains calmars et celles des caméléons. Un exemple d’évolution convergente!
Sauf si l’on imagine des éleveurs comme ces Anglais qui ont porté en quelques siècles la tératologie canine au rang d’un art.
Les durées évoquées ici sont forcément approximatives et sujettes à la plus grande caution. Faut-il le rappeler?
Les vieux malins contribuent certes à l’élimination des jeunes insuffisamment performants mais ils protègent les autres.
C’est le titre d’un de ses livres. Traduction française: Mengès, 1978.
Il faut bien voir que l’histoire du phylum humain est hautement spéculative puisqu’elle ne repose que sur l’étude de quelques dizaines de fossiles souvent très incomplets. La découverte de tout nouveau sujet conduit généralement à des réorganisations généalogiques d’envergure. La dernière fois que j’ai consulté une liste présumée exhaustive des fossiles appartenant à la famille des hominidés au sens restreint, il y a une dizaine d’années, elle comportait quatre-vingt-dix spécimens.