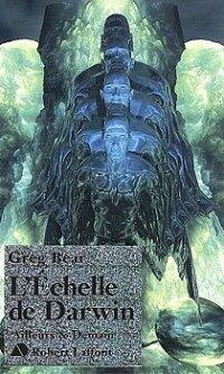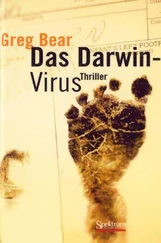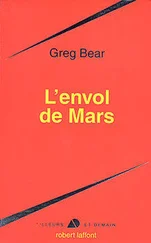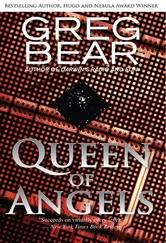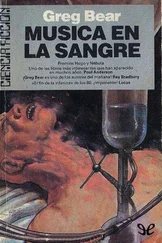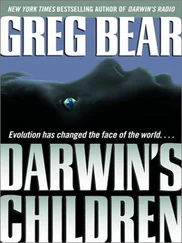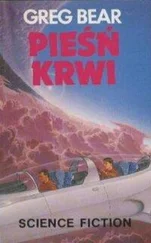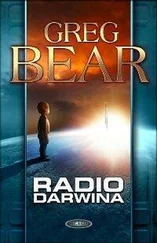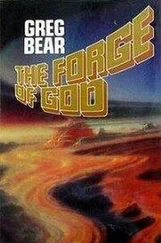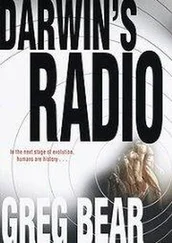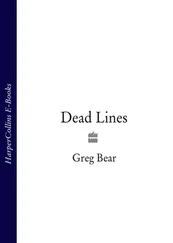Les néodarwiniens classiques n’aiment pas l’idée de la sélection intraspécifique entre petits groupes : elle impliquerait selon eux que ces groupes constituent de relatifs isolats génétiques devant se reproduire principalement entre leurs membres assez longtemps pour que des différences significatives apparaissent entre les groupes ; cette hypothèse incestueuse n’est pourtant pas nécessaire. Richard Dawkins est un partisan fanatique de la thèse du Gène égoïste [55] C’est le titre d’un de ses livres. Traduction française: Mengès, 1978.
par ailleurs souvent vérifiée… chez des insectes sociaux, thèse qui privilégie la sélection entre individus (ou un peu au-delà en tenant compte de la proximité génétique). La sélection entre individus est certes la plus facile à comprendre là où pour une espèce donnée les ressources sont rares, la prédation forte et où la simple survie est le facteur déterminant de la reproduction. Seul celui qui survit pour se reproduire transmet ses gènes. Mais comment expliquer alors la longévité humaine qui déborde largement la période de reproduction et surtout l’accroissement relativement récent de cette longévité ?
C’est que, dans la lignée humaine, depuis peut-être des millions d’années, le problème central des protohumains n’est ni la nourriture, ni la menace de prédateurs. Des chasseurs-cueilleurs peu nombreux et se déplaçant facilement en petits groupes ne doivent pas avoir de mal à se nourrir ni même y consacrer beaucoup de temps. Et si j’étais un machairodonte, j’y réfléchirai à deux fois avant de rôder auprès de ces bipèdes teigneux, volontiers solidaires face à un ennemi commun, vifs, inventifs et armés de griffes de silex au bout de longs bâtons. Du reste, les machairodontes ont disparu tandis que les humains sont toujours là.
Le souci principal des protohumains, c’est le sexe et la reproduction. Et si un groupe s’assure un meilleur succès dans l’accès à des femmes (je n’ose plus écrire femelles), que ce soit par la séduction ou par des méthodes plus énergiques, il assure mieux la transmission de ses gènes, par exemple ceux de la longévité et ceux que l’on peut rattacher d’une manière ou d’une autre au langage, à la mémoire et à la performance intellectuelle (pour ne pas dire l’intelligence).
Cependant, même le recours à ces spéculations néodarwiniennes plus ou moins améliorées ne règle pas la question. Les espèces de grands singes ont en gros bénéficié des mêmes circonstances. Elles n’ont pas évolué significativement et sont en voie de disparition. Certes la lignée humaine qui a survécu (et qui n’était pas forcément la meilleure sub specie æternitatis ) a probablement éliminé tous ses concurrents de même origine un peu moins chanceux, si bien que la plupart de ses autres possibles nous demeurent inconnus, au moins présentement [56] Il faut bien voir que l’histoire du phylum humain est hautement spéculative puisqu’elle ne repose que sur l’étude de quelques dizaines de fossiles souvent très incomplets. La découverte de tout nouveau sujet conduit généralement à des réorganisations généalogiques d’envergure. La dernière fois que j’ai consulté une liste présumée exhaustive des fossiles appartenant à la famille des hominidés au sens restreint, il y a une dizaine d’années, elle comportait quatre-vingt-dix spécimens.
.
Mais il y a quelque chose qui nous échappe plus radicalement dans l’histoire du phylum humain et des possibilités qui se sont ouvertes à lui du fait de sa propre transformation. En un million d’années (deux ou trois si l’on compte large), l’organisation du système nerveux de certains hominidés a connu plus de remaniements que tous les systèmes nerveux de toutes les espèces au cours des deux cents millions d’années précédentes. Et l’on comprend mieux l’attachement de Greg Bear à la perspective lamarckienne même si elle pose une question qu’elle ne résout pas. Il manifeste cet attachement en abordant une question corollaire : celle de l’évolution sur d’autres mondes. Dans Héritage, il décrit comme j’ai déjà dit, sur une autre planète, une évolution de type purement lamarckien. Évitant le modèle généralement considéré comme dominant sur notre planète, il renonce au Principe de Médiocrité.
Lorsqu’on ne sait rien de positif sur un domaine donné, ce qui est le cas en exobiologie, science éminemment conjecturale, et qu’on ne dispose que d’un seul exemple, la prudence méthodologique conduit à adopter le Principe de Médiocrité. Selon ce principe, la Terre n’occupe pas le centre du monde, le Soleil est une étoile quelconque, la Galaxie une nébuleuse moyenne et nous ne bénéficions d’aucun privilège d’espèce. Tout cela est assez vraisemblable et parfois vérifié.
Malheureusement, le Principe de Médiocrité, auquel il n’est fait appel qu’en l’absence de toute population statistiquement observable, conduit parfois à des conclusions fâcheuses et peut-être absurdes : ainsi puisque la civilisation humaine a de six à huit mille ans et que le plus probable est qu’elle se situe aujourd’hui au sommet de la courbe de Gauss des civilisations, elle devrait avoir disparu dans six à huit mille ans. Il devient même possible d’évaluer la probabilité qu’elle atteigne les cent mille ans, et cette probabilité est quasiment nulle.
La question est de savoir si le Principe de Médiocrité s’applique également aux différentes étapes de la vie observées sur Terre. Mon opinion personnelle est qu’on peut distinguer quatre grandes étapes dans l’évolution de la vie terrestre, la provirale (ARN et/ou ADN), la procaryote (qui implique déjà probablement la symbiose de plusieurs formes d’êtres vivants bien organisés), l’eucaryote ou pluricellulaire, ou encore métazoaire, et finalement la symbolique, toute récente, avec l’humanité, le langage, les mathématiques et les prix littéraires. Il n’est pas du tout certain que le Principe de Médiocrité s’applique aisément à la procession de ces quatre étapes entre lesquelles il semble que quelque chose de très singulier soit chaque fois advenu. Il est assez difficile de l’admettre pour la planète Terre.
Admettons que le Soleil soit une étoile de type assez ordinaire. Il reste à établir qu’une planète d’une taille précise, ni trop petite, ni trop grosse, et en orbite dans une zone non moins définie autour de son étoile, soit commune dans le cosmos ; cela est assez vraisemblable. Encore faut-il qu’elle dispose d’un satellite disproportionné, en l’occurrence la Lune, issue d’un improbable cataclysme, qui provoque des effets de marée peut-être indispensables à l’apparition de la vie et presque certainement à sa migration hors des océans. Il faut aussi, afin d’accélérer un peu les choses, que cette planète soit soumise périodiquement à des extinctions massives d’espèces, possiblement provoquées par des bombardements d’astéroïdes, et que notamment un groupe très prospère qui avait vécu à peu près paisiblement pendant deux cents millions d’années, les dinosaures, soit éradiqué par une catastrophe inattendue pour laisser place à des rats négligeables qui devaient donner naissance à une race merveilleuse d’observateurs conscients de l’univers, dont un représentant signe cette préface sceptique. Cela fait beaucoup de circonstances singulières, et encore a-t-on négligé ici la plupart de celles qu’enfilent les tenants du principe anthropique fort. À moins qu’un projet n’ait enchaîné cette incroyable série.
En invoquant la contingence, Stephen Jay Gould balaie la tentation du Principe de Médiocrité et par extension celle du projet et du téléfinalisme. La vie a pu surgir ailleurs, et même fréquemment puisqu’elle semble apparue sur Terre très peu de temps après que la planète s’est à peu près stabilisée. Elle est peut-être une propriété émergente et à peu près inéluctable de l’univers physico-chimique. Mais la succession de hasards qui a orienté la vie sur Terre n’a aucune probabilité raisonnable de se reproduire sur d’autres mondes, et l’évolution, qui peut dans son principe être souvent à l’œuvre, a suivi ailleurs d’autres voies, comme le suggère Greg Bear.
Читать дальше