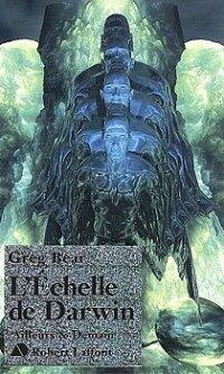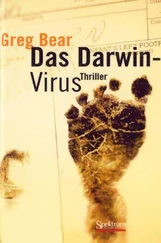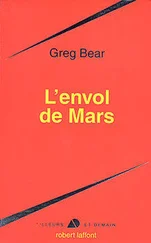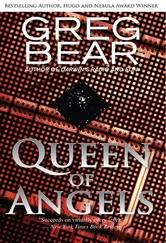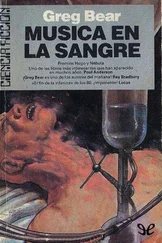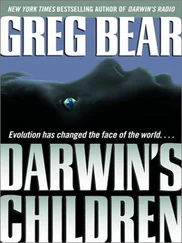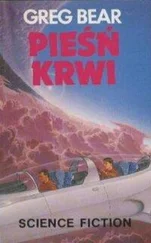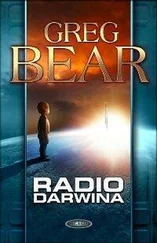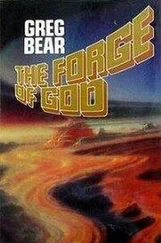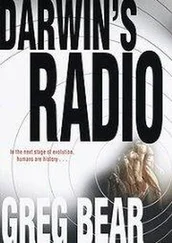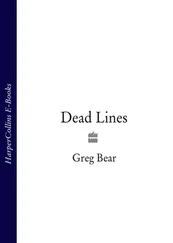Assez curieusement, Rosny Aîné dans Les Xipéhuz (1887) puis dans La Mort de la Terre (1912) semble exploiter tardivement la conception de Cuvier de la succession des règnes dans une discontinuité absolue : les Xipéhuz [40] Les Xipéhuz ressemblent beaucoup à certains des Grands Anciens imaginés par H.P. Lovecraft. Il est permis de s’interroger sur la généalogie qui conduit des uns aux autres.
en forme de cônes n’ont aucune relation biologique avec les humains qui vont les exterminer, pas plus que les ferro-magnétaux de La Mort de la Terre n’en ont avec les humains qu’ils vont remplacer, ni du reste avec aucune forme de vie biologique. Pas trace d’évolution ici, ce qui est tout de même surprenant de la part d’un auteur qui s’est beaucoup intéressé à la paléontologie. On a déjà dit ce que la nouvelle presque contemporaine de Maupassant devait sans doute au darwinisme [41] La quasi-simultanéité de la parution du Horla et des Xipéhuz amène à s’interroger sur les raisons de l’échec de la science-fiction française à s’imposer après un si brillant début.
. Celui-ci cependant inspirera relativement peu d’œuvres. On en trouve une expression dans La Machine à explorer le temps (1895) de H. G. Wells. Son gradualisme est peu encourageant pour des écrivains qui doivent retenir l’attention du lecteur par l’évocation d’un moment de crise. C’est pourquoi le mutationnisme de De Vries aura une postérité littéraire plus abondante, à ce point qu’un ouvrage de la taille de celui-ci ne suffirait pas à résumer les nombreuses histoires de mutants et de surhommes [42] Voir notamment ma préface à Histoires de mutants , Le Livre de Poche n°3766, et celle de Demètre Ioakimidis à Histoires de surhommes , Le Livre de Poche n°3786.
. Mais il faudra attendre les années 1930 pour les voir se multiplier.
Je n’en signalerai ici que quelques-unes pour baliser l’histoire du thème. Dès 1929, René Thévenin, dans Les Chasseurs d’hommes [43] On trouvera cet étonnant roman dans Sur l’autre face du monde et autres romans scientifiques de sciences et voyages , «Ailleurs et demain», Laffont, 1973.
, illustre le thème avec une pointe de génie. Le mutationnisme tient la vedette dans l’extraordinaire fresque d’Olaf Stapledon, Les Derniers et les Premiers (1930), qui décrit la succession de quinze espèces d’hommes, radicalement différentes les unes des autres. Dans Rien qu’un surhomme (1935), Stapledon brosse le portrait peut-être le plus convaincant jamais imaginé de l’espèce qui aurait pu nous succéder si elle n’avait choisi de s’effacer. Mais c’est À la poursuite des Slans (1940, 1946, 1951), le roman d’A. E. Van Vogt, qui popularisera le thème. Les Slans sont en fait des mutants artificiellement produits pour aider l’espèce humaine normale à résoudre ses problèmes grâce à leurs facultés supérieures ; les humains ordinaires supportent mal d’être distancés et se livrent à leur encontre à des pogroms. Aussi par la suite, l’intolérance à l’endroit des nouveaux venus différents devient un poncif. Arthur C. Clarke et Théodore Sturgeon renouvellent le thème en 1953 respectivement dans Les Enfants d’Icare et Les Plus qu’humains en insistant sur une conscience collective voire cosmique.
À partir des années 1970, le thème du surhomme se raréfie progressivement peut-être parce qu’il est devenu idéologiquement suspect. Peut-être aussi parce que les auteurs ont pris conscience de la quasi-impossibilité de décrire subtilement un être beaucoup plus avancé que nous, et de la naïveté qu’il y a à s’imaginer son apparition soudaine : le néodarwinisme a fait des progrès.
C’est pourquoi lorsque Greg Bear publie en l’an 2000 L’Échelle de Darwin puis lui donne une suite, Les Enfants de Darwin [44] «Ailleurs et demain», Robert Laffont, 2003.
en 2002, la surprise est considérable. Et Bear ne se contente pas de rénover le thème du successeur de l’ Homo sapiens sapiens ; il imagine aussi, pour la première fois, de façon audacieuse et astucieuse, un mécanisme original de l’évolution qui explique, à un moment donné de l’histoire, l’apparition de cette espèce. Chose singulière, sans qu’ils aient pu se donner le mot, un autre écrivain, australien celui-là, Greg Egan, propose lui aussi dans Téranésie [45] «Ailleurs et demain», Robert Laffont, 2000.
, en 2000 également, un nouveau processus évolutionnaire. Décidément, au moment du changement de millénaire, la problématique de l’évolution est de retour.
Bien que les solutions spéculatives avancées par Bear et Egan diffèrent totalement, elles affrontent de conserve certaines difficultés rencontrées par la théorie néodarwinienne.
Tout d’abord, les espèces apparaissent dans la nature « parfaites » relativement à leurs conditions d’existence, et leurs organes, ainsi l’œil, celui du poulpe aussi bien que ceux des vertébrés, forcent l’admiration : il est souvent pris à témoin par les adversaires de l’évolution sous le prétexte qu’on ne voit pas bien comment des formes incomplètes auraient pu y conduire [46] Richard Dawkins, un ultra-darwiniste, entreprend de répondre à cette question dans L’Horloger aveugle , que j’ai publié chez Laffont en 1989, sans convaincre entièrement.
. Ensuite les espèces, pour la plupart, sont remarquablement stables, sur des dizaines et parfois des centaines de millions d’années. Dans les deux cas, c’est tout le problème dit du « chaînon manquant » qui ne se pose pas seulement à propos de l’espèce humaine mais de presque toutes les espèces : les « archives » paléontologiques offrent rarement de séries à peu près complètes de phénotypes intermédiaires et les lacunes sont difficilement imputables à la rareté des fossiles si l’évolution s’est déroulée très graduellement sur de longues périodes de temps.
Tout se passe donc comme si l’évolution faisait des sauts, ce que George Simpson, l’un des fondateurs du néodarwinisme, a appelé l’évolution quantique. Ce que confirme la paléontologie : des groupes d’espèces, voire des espèces, surgissent assez brusquement à des moments bien identifiés. C’est ce qui conduit Stephen Jay Gould et Nils Eldredge, après les « mutations systémiques » de Richard Goldschmidt et sa théorie « saltationiste » (1940), à avancer la théorie des « équilibres ponctués » (1972). L’explication catastrophiste selon laquelle ces explosions d’espèces nouvelles feraient suite à des cataclysmes comme celui qui a exterminé les dinosaures à la fin du crétacé n’est pas suffisante.
On peut invoquer trois acteurs de l’évolution : un Grand Ordonnateur, éventuellement divin ou extraterrestre, qui appliquerait un Plan ; la sélection naturelle qui ne laisse subsister que les « plus aptes » dans un environnement présumé stable (ou dynamiquement stable) ; la contingence dont le hasard génétique est un volet et la chute d’astéroïdes (ou les changements climatiques brutaux) un autre. La thèse du Grand Ordonnateur a pour avantage d’éviter la nécessité de toute autre explication, ce qui est aussi son principal inconvénient : une telle position épistémologique n’a jamais été efficace ; il a toujours été possible de trouver des interprétations rationnelles plus détaillées et mieux étayées, même si elles n’étaient ni complètes ni définitives.
La sélection naturelle s’est vu opposer l’impossible définition de l’aptitude, objection qui revient à jouer sur les mots. Sont les « plus aptes » ceux qui survivent et se reproduisent : les forces évolutionnaires agissent comme un filtre du vivant, mais le plus important est ici de comprendre que ce filtre est dynamique et non pas statique ; c’est tout le milieu vivant, tous les écosystèmes, nombreux et complexes, qui se transforment et se rééquilibrent en interagissant, et les règles du jeu de la survie changent constamment ou brusquement. L’évolution sculpte globalement et dans le détail les formes du vivant.
Читать дальше