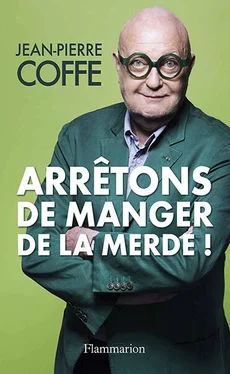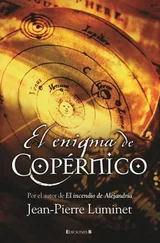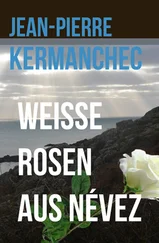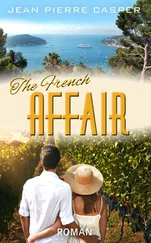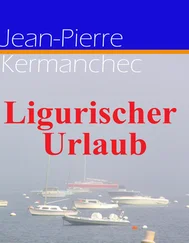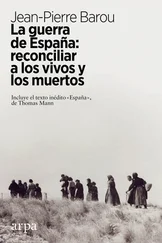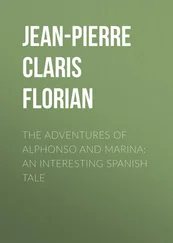En 2014, l’œuf est considéré par l’ensemble de la population comme un « bon produit », sain, naturel, source de vitamines, capable de remplacer la viande (un œuf = un bifteck de 100 grammes), et surtout peu coûteux.
À première vue, tout roule pour l’œuf. Il n’y aurait pas lieu de se poser de questions, ni de s’en faire. Mais comment le consommateur peut-il s’y retrouver quand les producteurs et les distributeurs multiplient les marques, les labels et autres calembredaines marketing pour activer le marché ? Savez-vous ce que représente « poules élevées en plein air », « œufs ramassés sur la paille comme autrefois », « œufs extra-frais datés du jour de ponte », « fraîcheur coq », « plein air fermier », ou encore « pondus en France », c’est le petit dernier, tout juste éclos en 2013 ? Savez-vous faire la différence entre toutes ces allégations ? Savez-vous vraiment ce que vous achetez, ce que vous consommez ou faites consommer à vos enfants ? Aiguiller et informer le consommateur. Foutaises ! Avec tout ce charabia, on ne sait même plus dans quel panier mettre ses œufs ! En quoi sont-ils différents ? Sont-ils vraiment différents ? Que veut-on nous faire avaler ?
Pour découvrir ce qui se cache sous la coquille, examinons le mode de production des œufs. Tout d’abord, prenons connaissance des résultats d’un sondage Ifop conduit pour l’ONG Compassion in World Farming (CIWF). Du point de vue de la lucidité des consommateurs, il est rassurant de savoir que 52 % d’entre eux considèrent qu’il est « difficile d’avoir une information sur le mode d’élevage des poules pondeuses », en dépit des nombreuses notifications sur les emballages. Alors, comment ça se passe ? Premier coup de bluff : les élevages avec l’allégorique photo figurant sur les boîtes, exhibant de belles rouquines qui picorent dans une vaste prairie bien verte. Bidon. La réalité est tout autre. La belle époque où les poules gambadaient dans les champs et les basses-cours, grattant, fouinant ici et là, insouciantes et libres… c’est terminé ! Aujourd’hui, elles sont pour ainsi dire toutes logées à la même enseigne. Le vieux poulailler, rêve lointain des urbains, est passé au rang d’antiquité, il s’est métamorphosé en un vaste bâtiment, sorte de hangar, dans lequel vivent plus de 300 000 volatiles, enfermés dans des cages sans voir la lumière du jour. Adieu la Gournay dorée, la Crèvecœur, la Bresse noire dorée, ou la Barbezieux, remplacées par plusieurs races proposées par les deux grands sélectionneurs mondiaux (Hendrix et EW Group), beaucoup plus productives et supportant mieux l’enfermement. Elles débarquent dans l’élevage à l’âge de dix-huit semaines, après être nées dans des couvoirs, et se mettent au boulot tout de suite. Pas le temps de rigoler, de s’encanailler dans une basse-cour, elles sont là pour pondre, pondre toujours plus.
Les dispositifs sont précis. Pour un élevage en cage, chaque poule doit pouvoir disposer d’une superficie de 750 cm 2, d’un nid, d’une litière pour picorer et gratter, d’un perchoir d’au moins 15 cm, d’une mangeoire de 12 cm de longueur et d’un système d’abreuvement approprié. Ces dispositions sont multipliées par le nombre de poules dans la cage, limité à quatre ou cinq. Ces batteries de cage sont installées sur environ huit étages séparés les uns des autres par au moins 35 cm, et chaque cage doit être occupée d’un dispositif approprié pour le rétrécissement des griffes. Plus de 32 millions de poules vivent ainsi comme des ouvrières chinoises du prêt-à-porter. Cantonnées à la tâche, elles pondent 300 œufs en moyenne par an. Pour favoriser l’ambiance estivale favorable à la ponte, les bâtiments sont chauffés en permanence à 18 °C et restent allumés continuellement. Est-ce une chance, pour elles, de vivre en été des journées de 22 heures et demie au lieu de 24 ? Personne n’a encore réussi à les interroger. Dans ces bâtiments, tout est calme, étrangement ; elles tournent la tête de droite à gauche, mais quand soudain à l’heure du repas elles se redressent, le caquètement monte en gamme et le distributeur automatique délivre la pâtée. La tête de la poule, d’un mouvement rapide et rythmé, plonge dans le mélange. Une ration de granulés, c’est 45,5 % de céréales sous forme de sous-produit, des tourteaux de soja, des vitamines et des minéraux, ainsi que quelques oligoéléments (calcium et phosphore).
Tout est soigneusement calculé : les exigences biologiques de la poule et les contraintes économiques de l’éleveur. Les 138 grammes quotidiens sont pesés au gramme près car l’éleveur vit dans la terreur que la poule, sa machine à pondre, ne se dérègle. Imaginez, un supplément de 5 grammes par jour et par poule, et ses comptes virent au rouge. On est bien loin de la poignée de grains approximative de la fermière !
Sitôt pondu, l’œuf est entraîné sur un tapis roulant, miré avant de rejoindre un centre de conditionnement. L’œuf évite ainsi tout contact avec la fiente et les souillures : l’œuf est « sanitairement correct ». D’autant que les œufs fêlés et cassés sont éliminés afin de ne pas salir les autres. Les œufs issus de ces élevages en batterie — huit cents dans l’Hexagone — représentent 78 % de la production. Ce type d’élevage est interdit en Allemagne et aux Pays-Bas. Deux hypothèses : soit nous sommes à la traîne, soit le lobby des industriels de l’œuf est puissant, au choix.
Pour l’élevage alternatif ou au sol, rassurez-vous, l’espace de liberté est limité. Les poules sont recluses à l’intérieur d’un bâtiment où peuvent loger 30 000 volailles. Mais seulement 3 % des élevages prétendent à ce type de production. Les rations alimentaires sont les mêmes, et par conséquent les œufs aussi. Là encore, en 1999, le législateur européen est intervenu en fixant la taille des mangeoires à 10 cm au minimum, longitudinale ou circulaire, progrès considérable ! Et le même type d’abreuvoir, continu ou circulaire, lui aussi, à pas moins de 2,5 cm par poule. Il impose même un nid, mais pour sept (il est préférable de ne pas avoir envie de pondre en même temps, il n’y a pas de place pour tout le monde) et, miracle parmi les miracles, un perchoir de 15 cm de longueur par poule. Les techniciens européens, à défaut d’être compétents, sont méticuleux et imposent une limitation de la densité animale. Rien à voir avec une salle de bal, un mètre carré seulement pour neuf poules.
Pour éviter trop de casses ou de fêlures, les éleveurs de poules de batterie et d’élevage au sol ont recours à quelques additifs — tolérés — comme le butyrate de sodium, pour stimuler les fonctions hépatiques. Quant au producteur, il veille à satisfaire les désirs du marché et des centrales d’achat qui imposent des normes de jaune, et il ajoute des colorants de synthèse dans les gamelles, car oui, en France, on se distingue, on veut manger des œufs roux, alors que dans le monde 80 % des œufs sont blancs et dotés d’un jaune soutenu presque orangé. C’est le maïs qui donne naturellement la couleur du jaune. Pour les éleveurs industriels, le maïs coûte cher, trop cher, il est remplacé par des aliments moins onéreux, ce qui entraîne un jaune plus pâle. Qu’à cela ne tienne, il sera coloré artificiellement.
Que la poule soit élevée en cage ou au sol, elle est bombardée d’antibiotiques, sinon gare aux ravages : une telle promiscuité encourage le développement des bactéries. Environ 30 % des poules de batterie sont constamment sous antibiotiques, mais rassurez-vous, braves gens, mangez tranquilles, tout cela est légal, autorisé par la DSV (Direction départementale des Services vétérinaires). Pourquoi autorisé ? Tout simplement parce que les résidus d’antibiotiques sont faibles… Quoi qu’il en soit, ils restent bien présents dans l’œuf et on se garde bien évidemment de vous l’indiquer sur l’emballage.
Читать дальше