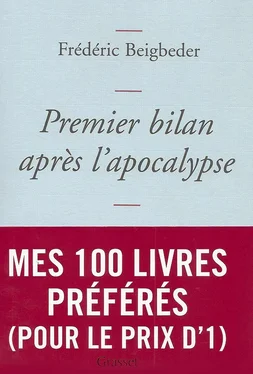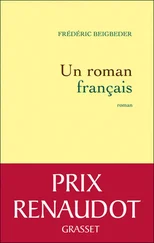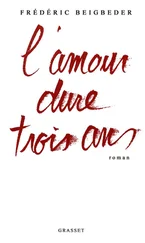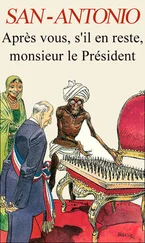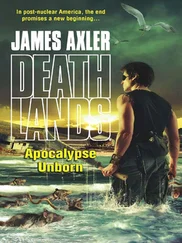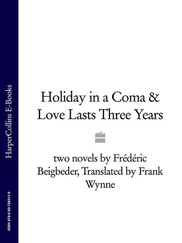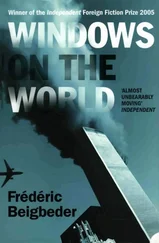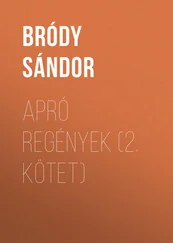J’ai lu ce roman plus de cinquante ans après sa publication et pourtant, je me souviens m’être totalement identifié au personnage. Sa situation de déraciné et de rebelle était extrêmement séduisante, romantique (impression d’ailleurs renforcée par l’écriture lyrique qui court tout au long du livre). Il se dégageait du texte un sentiment puissant de liberté qui avait dû aussi séduire tous les routards et hippies des années 60… On avait envie en le lisant de tout foutre en l’air. Pour quelqu’un qui habitait Paris 6e, c’était réellement salutaire : je voulais partir sur les traces du personnage, mener une vie aventureuse et sortir me perdre dans la nuit, errer… Le Loup des steppes a eu pour moi, à cette époque, la même importance que Tropique du Cancer , de Henry Miller. Vous en connaissez beaucoup, des prix Nobel de littérature qui ont donné leur nom à des groupes de rock (Steppenwolf, celui qui chantait « Born to be wiiiild ») ?
La notion de liberté sonne faux pour ma génération : on nous parle beaucoup de liberté, mais j’ai le sentiment profond que nous ne sommes pas libres du tout. Néanmoins, Hesse m’a incité à toujours essayer de conquérir « ma » liberté, à tout faire pour éviter le destin tout tracé que mon milieu social me réservait. Harry Haller, le personnage du roman, reste d’ailleurs à la périphérie de la bourgeoisie dont il est issu, et en rejette les manières, les valeurs : je l’associe au héros d’un roman que ma mère adorait (Para, de Knut Hamsun), vivant isolé dans une cabane au milieu de la forêt. Alter ego misanthrope et suicidaire de l’auteur, Harry Haller, à travers sa perception décalée et absurde de l’existence, de la société, est un personnage très moderne ; il annonce Bardamu, Meursault, Roquentin, mais peut-être aussi, par sa vision de la sexualité et son pessimisme foncier, les personnages d’auteurs américains comme Bukowski — à l’instar de Chinaski, l’alter ego de Bukowski, Haller cherche sa place et professe une certaine forme de stoïcisme. (Notons au passage que Charles Bukowski est d’origine allemande comme Hesse.)
Il faut parler aussi de la structure du roman qui est très audacieuse. Le livre est agencé comme une succession de poupées russes : d’abord la préface de « l’éditeur », témoin de l’histoire, ensuite les « carnets » de Harry Haller à l’intérieur desquels figure un autre livre, un mystérieux Traité sur le loup des steppes… J’avoue moins apprécier la deuxième partie du livre et ses délires quasi psychédéliques, annonciateurs des 70’s : Harry dialogue avec Gœthe (dont il critique la « fausseté » de l’œuvre), Mozart, etc. Ça devient un peu trop magique pour mon bon sens béarnais.
Le Loup des steppes a été interdit par le régime nazi, ce qui est assez troublant, car, à sa manière, Harry pressent qu’une nouvelle catastrophe est sur le point de se produire. À de multiples reprises, l’auteur revient sur le fait que son personnage est « pris entre deux époques ». Il est facile aujourd’hui de donner à ce roman une interprétation politique — comme on l’a souvent fait pour les œuvres de Kafka, où l’on voyait une dénonciation du stalinisme futur. Hesse y évoque expressément l’agitation nationaliste qui devient « de plus en plus agressive » ; il parle « des milliers et des milliers d’hommes [qui] préparent avec zèle la prochaine guerre ». L’ami chez lequel il va dîner « trouve les juifs et les communistes haïssables » et « ne se rend pas compte qu’autour de lui la prochaine guerre se prépare ». Cet aspect prophétique est assez troublant. Pour autant, et c’est ce qui fait de ce roman un grand et beau texte, à aucun moment l’auteur ne fait montre de manichéisme, de certitudes… Harry Haller est-il le premier bobo ? Un Bartleby germanique ? Un poète stoïcien ? Un agoraphobe exalté ? Non, Le Loup des steppes est le dernier représentant d’une espèce disparue en 1942 : l’honnête homme.
Hermann Hesse, une vie
« L’œuvre entière de Hesse est un effort poétique d’émancipation en vue d’échapper au factice et de réassumer l’authenticité compromise » (André Gide). À celui de Gide, je préfère le compliment de Thomas Mann le 3 janvier 1928 : « Le Loup des steppes m’a réappris à lire. » C’est plus direct. Hermann Hesse est né à Calw (Wurtemberg) le 2 juillet 1877 et mort en Suisse le 9 août 1962. Durée de vie : 85 ans. Achetez des produits allemands, c’est du solide ! Il est devenu célèbre à 27 ans, grâce à un roman d’éducation écrit à Bâle : Peter Camenzind (1904). Puis il s’est installé dans une ferme proche du lac de Constance, s’est marié et emmerdé, a foutu le camp aux Indes comme un vieux baba, quitté sa femme après la Première Boucherie mondiale, et pondu Siddhartha, puis Le Loup des steppes en 1927, enfin Narcisse et Goldmund, avant de recevoir le prix Nobel de littérature en 1946, ce qui était un sacré exploit pour quelqu’un de la même nationalité qu’Adolf Hitler. Hermann Hesse fut le Paulo Cœlho de l’entre-deux-guerres : il écrivait des contes new âge alors que le new âge n’avait pas encore été inventé. C’est donc lui qui l’a inventé !
Numéro 92 : « Hell » de Lolita Pille (2002)
Hell de Lolita Pille s’intitulait Confessions d’une pétasse quand j’ai reçu ce manuscrit rue Gît-le-Cœur, par la poste, un matin de 2002. D’habitude, je ne lis pas les manuscrits : soit c’est bien et je sombre dans une dépression jalouse, soit c’est nul et je n’ose pas le dire à l’auteur. Et puis, pour quoi faire ? À l’époque je n’étais pas éditeur (aujourd’hui je ne le suis plus) et, en tant que critique, je n’ai déjà pas le temps de lire tous les livres publiés. Les manuscrits me parviennent généralement accompagnés d’une lettre dans laquelle le génie maudit dit le plus grand bien de moi ; malheureusement, le reste de son courrier est moins intéressant : lamentations de vieilles peaux larguées par leurs trois maris ; plagiats des derniers best-sellers de la liste de L’Express ; fantasmes sexuels de profs de lycée… Je n’envie pas les directeurs littéraires. Laclavetine a bien décrit leur métier harassant dans un roman intitulé Première Ligne.
Pourtant le texte de Lolita Pille m’a happé, il n’y a pas d’autre mot. Elle avait un ton cinglant, une méchanceté sautillante, une façon merveilleusement insolente de décrire la jeunesse dorée de l’Ouest parisien. Elle me rappela de mauvais souvenirs : gueules de bois à répétition, sexe sans lendemain, virées de sales gosses arrogants, maintenant j’assume ce passé. La vérité, c’est que je n’ai pas pu lâcher son manuscrit avant de l’avoir terminé, et pourtant Dieu sait si j’avais autre chose à foutre que de lire une arriviste inconnue. En outre l’auteur, âgé de 17 ans, ne fournissait pas sa photographie avec le texte, ce qui était vraiment la preuve d’un manque de savoir-vivre. Le lendemain matin, je téléphonais à mon éditeur pour lui recommander cette petite peste. Hell est donc un peu de ma faute…
Je sais que je ne devrais pas écrire sur un bouquin que j’ai pistonné auprès de Grasset : ce n’est pas très éthique, mais après tout je n’ai jamais touché un rond dessus, alors pourquoi ne pas vanter ces qualités qui m’ont tant enthousiasmé il y a une décennie ? La jeune littérature néglige souvent le camp des vainqueurs, la nullité des élites, la détresse de l’aristocratie : depuis Hugo, il faut écrire sur les misérables pour être un romancier sérieux. Hell raconte cet enfer qui fait rêver les idiotes. « Si les riches ne sont pas heureux, c’est que le bonheur n’existe pas. » Telle est la phrase clé de cette sotie impertinente et frivole, que je traduirais dans mon langage fruste : quand on est une fille à papa sans papa, on n’a pas le droit d’être désespérée, juste le droit d’être ridicule. C’est pourquoi il faut, de temps en temps, plaindre les riches, même si c’est dégoûtant. Cela fait mentir la société capitaliste : il n’est pas vain de rappeler que l’argent fait le malheur de tous, y compris de ceux qui en ont trop. Lolita Pille piaffait d’impatience devant le panthéon des têtes à claques bourgeoises : Fitzgerald, Sagan, Ellis… Elle ne les avait pas lus quand elle a eu l’idée de son roman sur l’avortement d’une amoureuse trop gâtée, entourée d’écervelés et de radasses, qui se salit pour se sentir exister, ou atteindre la profondeur introuvable aux Planches (rue du Colisée). Elle voulait juste comprendre pourquoi elle sacrifiait tout à la nuit, pourquoi elle trouvait débiles tous ses copains, pourquoi elle se sentait mal, et conne, et seule, et enceinte d’un connard drogué. Elle a choisi d’en rire pour énerver tout le monde. Elle a de la chance : pour rendre supportable une histoire aussi puante, il fallait beaucoup de talent. Est-ce cela que certains dénomment « l’énergie du désespoir » ? Je crois que Hell est exactement le contraire : une parabole sur la perte de confiance en soi, sur une génération détruite par l’ironie.
Читать дальше