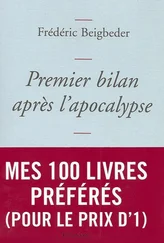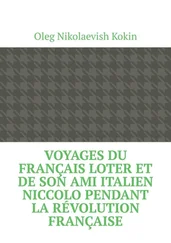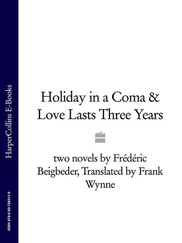Frédéric Beigbeder
Un roman français
« Comme un printemps les jeunes enfants croissent
Puis viennent en été
L’hiver les prend et plus ils n’apparoissent
Cela qu’ils ont été. »
Pierre de RONSARD, ode à Anthoine de Chasteigner, 1550.
à ma famille
et à Priscilla de Laforcade
qui en fait partie.
Je suis plus vieux que mon arrière-grand-père. Lors de la deuxième bataille de Champagne, le Capitaine Thibaud de Chasteigner avait 37 ans quand il est tombé, le 25 septembre 1915 à 9h15 du matin, entre la vallée de la Suippe et la lisière de la forêt d’Argonne. J’ai dû harceler ma mère de questions pour en savoir plus ; le héros de la famille est un soldat inconnu. Il est enterré au château de Borie-Petit, en Dordogne (chez mon oncle) mais j’ai vu sa photographie au château de Vaugoubert (chez un autre oncle) : un grand jeune homme mince en uniforme bleu, aux cheveux blonds coiffés en brosse. Dans sa dernière lettre à mon arrière-grand-mère, Thibaud affirme qu’il ne dispose pas de tenailles pour découper les barbelés afin de se frayer un chemin vers les positions ennemies. Il décrit un paysage crayeux et plat, une pluie inces sante qui transforme le terrain en marécage boueux et confie qu’il a reçu l’ordre d’attaquer le lendemain matin. Il sait qu’il va mourir ; sa lettre est comme un « snuff movie » — un film d’horreur réalisé sans trucages. À l’aube, il a accompli son devoir en entonnant le Chant des Girondins : « Mourir pour la patrie, c’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie ! » Le 161 eRégiment d’Infanterie s’est jeté sur un mur de balles ; comme prévu, mon arrière-grand-père et ses hommes ont été déchiquetés par les mitrailleuses allemandes et asphyxiés au chlore. On peut donc dire que Thibaud a été assassiné par sa hiérarchie. Il était grand, il était beau, il était jeune, et la France lui a ordonné de mourir pour elle. Ou plutôt, hypothèse qui donne à son destin une étrange actualité : la France lui a donné l’ordre de se suicider. Comme un kamikaze japonais ou un terroriste palestinien, ce père de quatre enfants s’est sacrifié en connaissance de cause. Ce descendant de croisés a été condamné à imiter Jésus-Christ : donner sa vie pour les autres.
Je descends d’un preux chevalier qui a été crucifié sur des barbelés de Champagne.
Je venais d’apprendre que mon frère était promu chevalier de la Légion d’honneur, quand ma garde à vue commença. Les policiers ne me passèrent pas tout de suite les menottes dans le dos ; ils le firent seulement plus tard, lors de mon transfert à l’Hôtel-Dieu, puis quand je fus déféré au Dépôt sur l’île de la Cité, le lendemain soir. Le président de la République venait d’écrire une lettre charmante à mon frère aîné, le félicitant pour sa contribution au dynamisme de l’économie française : « Vous êtes un exemple du capitalisme que nous voulons : un capitalisme d’entrepreneurs et non un capitalisme de spéculateurs. » Le 28 janvier 2008, au commissariat du VIII earrondissement de Paris, des fonctionnaires en uniforme bleu, revolver et matraque à la ceinture, me déshabillaient entièrement pour me fouiller, confisquaient mon téléphone, ma montre, ma carte de crédit, mon argent, mes clés, mon passeport, mon permis de conduire, ma ceinture et mon écharpe, prélevaient ma salive et mes empreintes digitales, me soulevaient les couilles pour voir si je cachais quelque chose dans mon trou du cul, me photographiaient de face, de profil, de trois quarts, tenant entre les mains un carton anthropométrique, avant de me reconduire dans une cage de deux mètres carrés aux murs couverts de graffitis, de sang séché et de morve. J’ignorais alors que, quelques jours plus tard, j’assisterais à la remise de Légion d’honneur de mon frère au palais de l’Élysée, dans la salle des fêtes, qui est moins étroite, et que je regarderais alors par les baies vitrées le vent troubler les feuilles des chênes du parc, comme si elles me faisaient signe, m’appelaient dans le jardin présidentiel. Allongé sur un banc en ciment, aux alentours de quatre heures du matin, en ce soir noir, la situation me semblait simple : Dieu croyait en mon frère et Il m’avait abandonné. Comment deux êtres aussi proches dans l’enfance avaient-ils pu connaître des destins aussi contrastés ? Je venais d’être interpellé pour usage de stupéfiants dans la rue avec un ami. Dans la cellule voisine, un pickpocket tapait du poing sur la vitre sans conviction, mais avec suffisamment de régularité pour interdire tout sommeil aux autres détenus. S’endormir eût été de toute façon utopique car même quand les séquestrés cessaient de beugler, les policiers s’apostrophaient à haute voix dans le couloir, comme si leurs prisonniers étaient sourds. Il flottait une odeur de sueur, de vomi et de bœuf-carottes mal réchauffé au micro-ondes. Le temps passe très lentement quand on n’a plus sa montre et que personne ne songe à éteindre le néon blanc qui clignote au plafond. À mes pieds, un schizophrène plongé dans un coma éthylique gémissait, ronflait et pétait à même le sol de béton crasseux. Il faisait froid, pourtant j’étouffais. J’essayais de ne penser à rien mais c’est impossible : quand on enferme quelqu’un dans une niche de très petite taille, il gamberge affreusement ; il tente en vain de repousser la panique ; certains supplient à genoux qu’on les laisse sortir, ou piquent des crises de nerfs, parfois tentent de mettre fin à leurs jours, ou avouent des crimes qu’ils n’ont pas commis. J’aurais donné n’importe quoi pour un livre ou un somnifère. N’ayant ni l’un, ni l’autre, j’ai commencé d’écrire ceci dans ma tête, sans stylo, les yeux fermés. Je souhaite que ce livre vous permette de vous évader autant que moi, cette nuit-là.
Je ne me souviens pas de mon enfance. Quand je le dis, personne ne me croit. Tout le monde se souvient de son passé ; à quoi bon vivre si la vie est oubliée ? En moi rien ne reste de moi-même ; de zéro à quinze ans je suis face à un trou noir (au sens astrophysique : « Objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper »). Longtemps j’ai cru que j’étais normal, que les autres étaient frappés de la même amnésie. Mais si je leur demandais : « Tu te souviens de ton enfance ? », ils me racontaient quantité d’histoires. J’ai honte que ma biographie soit imprimée à l’encre sympathique. Pourquoi mon enfance n’est-elle pas indélébile ? Je me sens exclu du monde, car le monde a une archéologie et moi pas. J’ai effacé mes traces comme un criminel en cavale. Quand j’évoque cette infirmité, mes parents lèvent les yeux au ciel, ma famille proteste, mes amis d’enfance se vexent, d’anciennes fiancées sont tentées de produire des documents photographiques.
« Tu n’as pas perdu la mémoire, Frédéric. Simplement, tu ne t’intéresses pas à nous ! »
Les amnésiques sont blessants, leurs proches les prennent pour des négationnistes, comme si l’oubli était toujours volontaire. Je ne mens pas par omission : je fouille dans ma vie comme dans une malle vide, sans y rien trouver ; je suis désert. Parfois j’entends murmurer dans mon dos : « Celui-là, je n’arrive pas à le cerner. » J’acquiesce. Comment voulez-vous situer quelqu’un qui ignore d’où il vient ? Comme dit Gide dans Les Faux-Monnayeurs, je suis « bâti sur pilotis : ni fondation, ni sous-sol ». La terre se dérobe sous mes pieds, je lévite sur coussin d’air, je suis une bouteille qui flotte sur la mer, un mobile de Calder. Pour plaire, j’ai renoncé à avoir une colonne vertébrale, j’ai voulu me fondre dans le décor tel Zelig, l’homme-caméléon. Oublier sa personnalité, perdre la mémoire pour être aimé : devenir, pour séduire, celui que les autres choisissent. Ce désordre de la personnalité, en langage psychiatrique, est nommé « déficit de conscience centrée ». Je suis une forme vide, une vie sans fond. Dans ma chambre d’enfant, rue Monsieur-le-Prince, j’avais punaisé, m’a-t-on dit, une affiche de film sur le mur : Mon Nom est Personne. Sans doute m’identifiais-je au héros.
Читать дальше