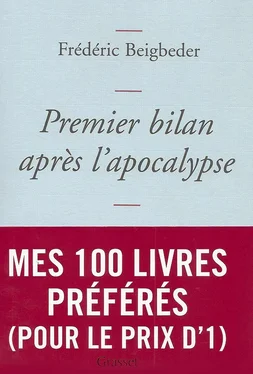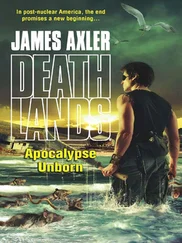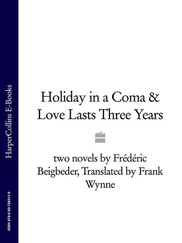Ce n’est pas tous les jours qu’on dégote un trésor pareil. Caché dans la vieille malle d’une dame âgée nommée Edna Webster, un gros paquet d’inédits de Richard Brautigan attendait dans l’Oregon depuis 1955 d’être retrouvé en 1992, puis traduit en 2003. Des textes éparpillés, des poèmes de jeunesse, des comparaisons cocasses, et la naissance d’une plume : « Imaginez que mon esprit soit un taxi et que soudain (“Bon Dieu, qu’est-ce qui se passe ?”) vous vous retrouvez à l’intérieur. »
À 21 ans, Brautigan confia un manuscrit à la mère de son premier flirt. Il lui affirma alors : « Quand je serai riche et célèbre, ce sera ta sécurité sociale. » C’était rigoureusement exact. Était-il prétentieux parce qu’il était jeune ? Non, il était prétentieux parce qu’il était écrivain. Tout écrivain sans prétention est un hypocrite ou un imposteur. Car écrire est l’activité la plus pédante qui soit. Rien de plus agaçant que cette tendance des auteurs actuels à baisser les yeux à la télé quand ils se font copieusement insulter par des critiques improvisés. Dans « Des livres et moi », Morgan Sportès avait trouvé la parade : le bras d’honneur !
Autre remarque notable : quand il était jeune, Brautigan était déjà Brautigan. En fait, Brautigan n’a jamais rien fait d’autre qu’écrire du Brautigan. Cela est la preuve définitive qu’il était un grand écrivain : il était incapable d’écrire autrement que comme lui-même, avec sa naïveté comique. Comme Fitzgerald ou Blondin, on a envie de lui taper dans le dos à chaque page comme si l’on trinquait. Salinger disait qu’un bon livre vous donne envie d’écrire une lettre à son auteur : avec Brautigan, on désire plutôt lever son verre (ou son joint). Dommage qu’il se soit suicidé il y a vingt-six ans, rendant ce vœu moins facile à exaucer.
Tout dans cet assemblage d’inédits n’est pas du meilleur tonneau : « L’argent est une triste merde » n’est certes pas le vers du siècle. Mais tout y est drôle et intense, sauvé par des questions du genre : « Ce poème est-il aussi beau que deux billets de cinq dollars frottés l’un contre l’autre ? » ou « Est-ce que les filles doivent vraiment aller aux toilettes ? ».
Le livre est bilingue, ce qui permet de vérifier que la poésie est fidèlement traduite. Cela permet aussi de s’apercevoir que les Américains sont parfois gentils. Par exemple, c’est parce qu’ils sont gentils qu’ils préfèrent le Bien au Mal. C’est donc parce qu’ils sont gentils qu’ils deviennent parfois méchants. Brautigan était un jeune prétentieux capable d’écrire de jolies gentillesses : « Je prendrai ta main, qui me rappelle un chat que j’ai bien connu, et nous irons marcher. » On sent que le futur hippie aime la douceur de cette main, qu’il a envie de la caresser, mais aussi qu’il a peut-être peur de ses griffes, qu’elle pourrait le blesser, ou disparaître, et qu’alors il regretterait ses ronronnements. Tout cela évoqué en quelques mots tout simples : « je prendrai ta main, qui me rappelle un chat que j’ai bien connu ». On a envie de connaître ce félin, presque autant que la muse qui a inspiré pareille métaphore au moustachu planant.
Richard Brautigan, une vie
« Si nous n’avons pas besoin de tels écrivains, alors de quoi avons-nous besoin ? » (Philippe Djian.) Richard Brautigan est né en 1935 à Tacoma, dans l’État de Washington, et a mis fin à ses jours en octobre 1984 à Bolinas, en Californie. Surnommé « The Last of the Beats », ce hippie moustachu qui traînait à San Francisco est devenu riche et célèbre grâce à La Pêche à la truite en Amérique (1967), vendu à plus de trois millions d’exemplaires. Écrivain de la contre-culture des seventies, il a vu, lentement mais sûrement, la gloire s’éloigner de lui. Il a commencé à s’endetter, acheté un ranch dans le Montana, bu de plus en plus. Il est parti au Japon mais a commis l’erreur de revenir. Ses livres marchaient de moins en moins alors qu’ils étaient de mieux en mieux : Il pleut en amour (1976) et Journal japonais (1978) sont supérieurs en densité à La Vengeance de la pelouse (1971), mais j’aime aussi la loufoquerie de Tokyo-Montana Express (1980) ou les surréalistes Mémoires sauvés du vent (1982) disponibles en poche, chez 10/18.
Numéro 95 : « Clémence Picot » de Régis Jauffret (1999)
Vers la fin du XXe siècle, on publiait deux sortes de romans : soit l’histoire d’une femme de 30 ans qui cherchait un mec, soit celle d’un homme détraqué qui tuait des gens. La grande idée de Régis Jauffret consista à fournir les deux d’un coup. Comme un shampooing 2 en 1, Clémence Picot raconte l’histoire d’une femme de 30 ans qui n’a pas de mec et qui, en même temps, devient une détraquée qui tue des gens. Clémence Picot vit seule, boulevard Saint-Michel, toute la journée, et travaille comme infirmière de nuit dans un hôpital. Ses parents sont morts dans un accident d’avion. Elle veut un enfant, mais comme elle est toujours vierge à 30 ans, elle préfère tuer celui de sa voisine, qui est pourtant sa seule amie. Ce qui participe d’une certaine logique même s’il ne s’agit pas d’un acte foncièrement amical.
Grâce au talent froid de Régis Jauffret, cette existence sinistre parvient à donner un livre palpitant. C’est Misery réécrit par Emmanuel Bove, ou une version féminisée du boucher de Seul contre tous, le radical film de Gaspar Noé. Au bout de quelques années de solitude totale, Clémence Picot s’ennuie tellement qu’elle en devient folle. Vraiment très folle : à côté, Christine Angot est une femme équilibrée. Ce qui pourrait être un luxe (dans notre époque individualiste, vivre seul n’est-il pas le sommet de la liberté ?) s’avère pour elle un calvaire permanent. On ne sait pas à quoi ressemble Clémence Picot. Elle est pire que moche : transparente. Ses parents l’ont traumatisée ; elle est d’une timidité maladive ; alors elle torture un chien et un oncle, alternativement.
Nous vivons dans un monde étrange : la plupart d’entre nous mangent à leur faim, notre pays traverse une de ses plus longues périodes de paix, et pourtant tout le monde se plaint. Eternels insatisfaits, nous en demandons toujours plus. Nous ignorons ce que nous cherchons : notre vie est une quête sans Graal. Que se passe-t-il quand la vie ne nous octroie pas le bonheur parfait pour lequel la société nous a programmés ? Peut-on survivre si on est privé de ce modèle que l’écrivain Guillaume Dustan nomme « hétéro-fasciste » : un homme couche avec une femme, l’épouse, vit avec elle, lui fait de beaux enfants souriants ? Est-il supportable de ne pas ressembler à une publicité pour la CNP ? Selon Régis Jauffret, nous vivons dans un monde étrange qui fabrique des meurtriers.
Clémence Picot est un livre claustrophobe, angoissant, pathétique et injuste, pénible et grisâtre, qui procure un plaisir hypnotique. On le lit en se demandant pourquoi on le lit. Est-ce par voyeurisme ? Masochisme ? Ou pitié ? Nous habitons la tête de cette dingo qui parle toute seule, pleure tout le temps, ne fait plus aucun effort, se nourrit n’importe comment, ne se regarde jamais dans la glace, aime voir les autres souffrir. On admire le travail d’écrivain (Jauffret a mis douze ans à achever ce texte) ; un style clinique (normal, pour parler d’une infirmière) ; une écriture factuelle, « béhavioriste », sans romantisme, qui parvient à atteindre une pureté monstrueuse : « Paris contenait une infinité d’humains qui ne me connaissaient pas. J’avais été mise au monde par des gens qui n’existaient plus. »
Читать дальше