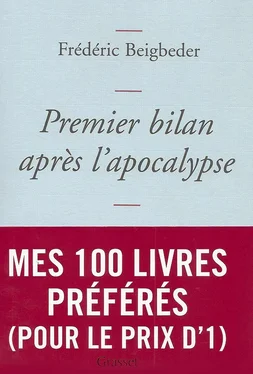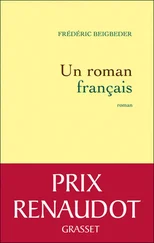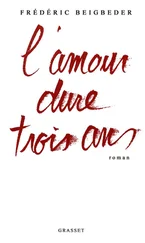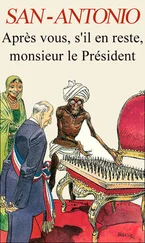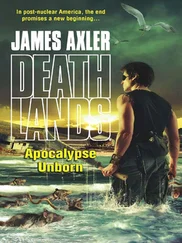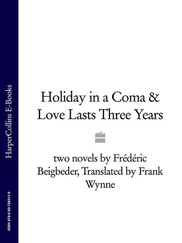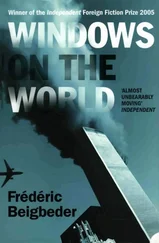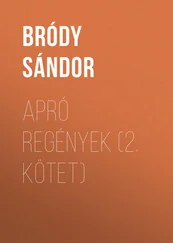Personne ne comprend rien à la nuit. Les gens qui vont au bureau tous les jours, qui ont le courage (ou l’obligation) de se lever tôt, ne peuvent pas comprendre ceux qui ne dorment jamais, ne foutent rien de la journée parce qu’ils se réveillent à 18 h 30 puant la clope, l’alcool et la désolation, et passent la soirée à se détruire pour fuir leur solitude. Mais Alain Pacadis ne parlait pas seulement de la nuit : il imposait de la poésie dans la presse.
C’est à cela que servent les chroniqueurs mondains ! On pense qu’ils font des listes de stars, des commentaires décalés de photos, des digressions vaines sur des bandes de snobinards avinés, alors qu’ils cherchent autre chose : décrire l’angoisse de l’élite, le fonctionnement de la nouvelle aristocratie, faire squatter du luxe frivole dans le journal, avec le style comme passager clandestin. Proust, Fitzgerald, Sagan, Agathe Godard et Bertrand de Saint Vincent : même combat ! Notre temps peut être condensé en une soirée faussement futile. Ce que faisait Pacadis, à sa manière punk défoncée, c’était tout simplement du roman, c’est-à-dire une forme de reportage qui crée son propre mystère. Ses lunettes noires lui permettaient d’y voir plus clair : « Paupières d’argent et teint de lune se promènent avec l’amour et la mort » (11 juin 1975). « La réalité n’existe pas, derrière une façade, une apparence, il n’y a que du vide, je n’existe pas… pas plus que vous qui me lisez » (juin 1979).
Désormais, pour frimer devant les jeunes crétins qui n’ont pas connu Paca l’hirsute, peut-être suffira-t-il que je leur raconte cette anecdote : un soir de 1985, j’ai trouvé Alain Pacadis adossé aux colonnes de la cité Bergère, en larmes. Il pleurait tout seul car il venait de se voir refuser l’entrée du Palace. Son perfecto couvert de badges fluo puait le vomi. Il avait probablement déjà chié dans son froc. Il reniflait avec son gros pif plein de morve un caillou de speed ramassé par terre. Lui qui aujourd’hui incarne ce que François Buot (dans un essai consacré en grande partie à lui) baptisa L’Esprit des seventies, s’était fait jeter comme un clodo par le service d’ordre du Palace. Fabrice Emaer était mort, des jeunes gens pas chic avaient récupéré l’endroit, et Paca n’était plus le bienvenu. Édenté, il titubait devant l’entrée, réclamant des verres gratuits alors qu’il risquait à tout moment de sombrer dans le coma. Je n’étais à l’époque pas assez connu pour le faire pénétrer dans cette discothèque dont il incarne aujourd’hui la splendeur. Tu parles ! Splendeur, mon cul ! eût dit la Zazie de Queneau. C’est à coups de pompes qu’on virait la loque humaine ! Il y a une telle distorsion entre les légendes et la réalité. Scott Fitzgerald à la fin de sa vie : les jeunes le croyaient mort. Kerouac, Blondin, Bukowski, Thompson : parodies d’eux-mêmes. La meilleure chose à faire avec ces génies cabossés, c’est de les lire. Parce que les côtoyer n’était pas un cadeau. Ils se laissaient écraser par leur personnage, se croyaient sans cesse obligés de parader pour rester à la hauteur de la légende. Leur existence devenait un fardeau ; c’est tout de même con d’être assassiné par un masque. Je me suis contenté de raccompagner Alain Pacadis en taxi. Il s’est endormi en bavant contre la vitre. J’ai dû ouvrir la fenêtre pour pouvoir respirer tellement il puait la crasse. Arrivé en bas de chez lui, il se réveilla très dignement, et se tint droit en descendant de la voiture, avec cette raideur à la Von Stroheim qui trahit les grands alcooliques ou les vrais désespérés. Dans ce livre, il écrit : « Le jour se lève : ça me donne envie de mourir. » Quelques semaines après, le plancher était débarrassé.
Alain Pacadis, une vie
Né en 1949 à Paris et mort trente-sept ans après dans la même ville, Alain Pacadis incarne la punkitude littéraire par ses frasques, sa silhouette avachie, ses lunettes noires posées sur son gros pif, mais surtout par une liberté d’écriture rarement atteinte dans la presse quotidienne (la chronique « White flash » dans Libération à partir de novembre 1975, ensuite intitulée « Nightclubbing »). Tous les chroniqueurs qui se mettent en scène dans leurs articles ont une dette envers ce mélomane trash et érudit capable de citer Baudelaire et les Stooges dans la même phrase, qui était aussi un remarquable intervieweur, à la fois connivent et insolent, dans Façade ou Palace magazine. Aujourd’hui nous connaissons la source de son angoisse existentielle : le suicide de sa mère en 1970 le fit basculer dans la drogue dure et le dandysme mondain. Homosexuel et amateur d’héroïne, il serait sans doute mort du sida si sa compagne, un transsexuel, ne l’avait pas étranglé à sa demande. Vivre vite est malheureusement incompatible avec mourir vieux.
Numéro 98 : « Un monde de cristal » et « Homo Zapiens » de Viktor Pelevine (1999 et 2001)
L’heure est grave : les Russes souffrent de notre ostracisme, et encore, on aurait très bien pu se passer du préfixe « ost ». Oui, avouons-le, nous prenons les Russkofs pour de gros débiles pleins de vodka, portant chapka et putes sur la tête, dansant le kazatchok dans des villas tropéziennes et fondant en larmes en comptant les milliards perdus depuis le dernier krach boursier. Les ex-Soviétiques nous font sourire : on les imagine tout juste bons à nous vendre du caviar ou du pétrole de contrebande ou à croquer du verre pilé en se faisant passer pour des princes déchus. On oublie qu’ils ont inventé le roman moderne : il se pourrait bien que leurs écrivains vivants aient quelques histoires à raconter sur leur nouvel empire capitaliste. Viktor Pelevine arrive juste à temps pour démentir ces préjugés qui n’insultent que nous-mêmes. Ce romancier hystérique est la preuve que l’art n’a pas de frontières : prenez le désarroi occidental, multipliez-le par la tragédie du stalinisme et l’avènement du matérialisme, et vous risquez de démoder Boulgakov.
Un monde de cristal rassemble six nouvelles publiées en 1996 à Moscou : elles ont pour point commun une écriture hallucinée, l’irruption de l’irrationnel dans le réel, le goût du bordel complet, la danse avec des fantômes. Deux soldats drogués et paranoïaques croisent Lénine à Petrograd en pleine révolution de 1917 ; une magicienne folle organise des mariages avec des soldats morts ; deux prostituées moscovites découvrent qu’elles sont d’anciens cadres du parti…
Le problème à résoudre pour les romanciers russes d’aujourd’hui est le suivant : comment raconter des histoires à des gens qui en ont marre qu’on leur raconte des histoires ? Quand on a vécu la chute du tsar, puis celle du communisme, puis l’explosion de Tchernobyl et de l’oligarchie, on n’a plus confiance en rien. Aucun peuple n’a été déçu aussi souvent en un seul siècle. En Russie, la réalité est aussi fluctuante qu’un rêve.
Alors qu’écrire pour ces gens-là ? Viktor Pelevine a trouvé la solution : décrire un monde où tout s’équivaut. Ce que Camus appelait « l’absurde », il suffit de le nommer « chaos ». Pelevine pond une littérature onirique et transsexuelle, où les contrôles d’identité sont permanents, entrelardés de délires mêlant Matrix et Tolstoï. Ses personnages passent leur temps à contrôler leurs papiers d’identité comme pour se rassurer sur leur propre existence.
L’Occident imagine que les Russes sont en retard sur lui alors qu’ils sont en avance. Ils n’ont pas cru au communisme mais ils ne croient pas au capitalisme non plus ! Nous supposons les Russes émerveillés par nos vitrines, alors qu’ils n’en sont que dégoûtés. Nous avons tort de les mépriser : c’est nous qui sommes naïfs. Quelqu’un comme Viktor Pelevine a beaucoup à nous apprendre, parce qu’il est encore plus blasé que nous. Il est revenu de tous les espoirs que nous n’avons pas encore osé formuler.
Читать дальше