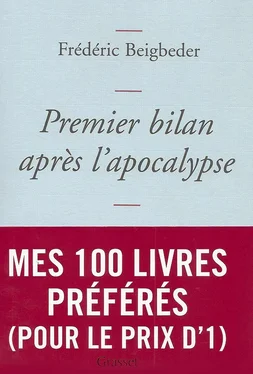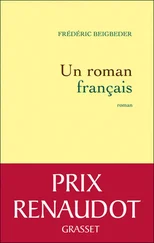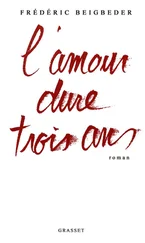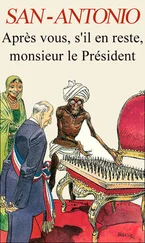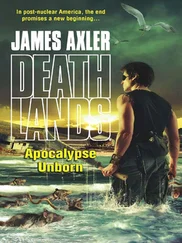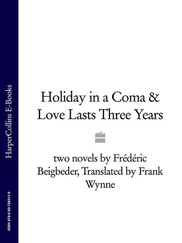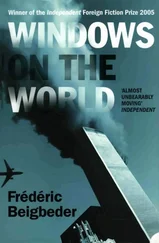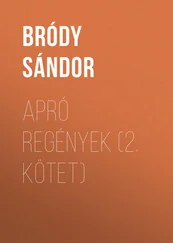Le parti pris de La Peau est de constater que dans une guerre tout le monde est mort depuis le départ, qu’une guerre n’est qu’une lutte entre morts. La guerre est comme la vie : une horde de cadavres en sursis. La guerre accélère la vie, la réveille (d’où les nombreuses scènes de sexe, de prostitution). « On croit lutter et souffrir pour son âme, mais en réalité on lutte et on souffre pour sa peau, rien que pour sa peau. » La peau ne peut protéger nos os. La peau est ce qui nous sépare de l’extérieur mais aussi notre point de contact avec le réel. Nos corps sont entourés de peau « flasque, qui pend au bout des doigts comme un gant trop large ».
J’ai lu La Peau à l’âge de 16 ans parce qu’un camarade de lycée me l’avait conseillé. Je venais de découvrir le Voyage au bout de la nuit et il m’avait dit que c’était la même chose en mieux parce que Malaparte parlait de la Seconde Guerre mondiale, plus proche de nous. Cette lecture me transforma. Pour la première fois de ma vie, un roman me faisait respirer le parfum des morts que l’Europe me cachait. Les profs d’Histoire évitaient la question de la lâcheté française, de la défaite française. À la télévision, tout était beau et propre : les nazis avaient perdu, les Américains nous avaient libérés. Les bons avaient liquidé les méchants. Mais mon peuple à moi était dans les deux camps et mon grand-père ne me le disait pas. Les deux grands tabous de ma jeunesse : les Français ne sont pas gentils, et les Américains non plus. Un autre tabou en train de tomber (grâce à Günter Grass et W. G. Sebald) : les Allemands aussi ont souffert. Il y a plus de scoops dans les livres que dans la presse.
Depuis cette lecture, je suis persuadé que les romans doivent dire la vérité, même si elle est apocalyptique. La beauté est juste une manière de dire la vérité. « Les destructions peuvent être belles » (Kundera, La Plaisanterie ). La guerre est séduisante : oh là là, on a le droit d’écrire une chose pareille ? Oui, c’est même un devoir. Et aussi : la mort est magnifique, l’horreur est glamour, les attentats sont sexy, la torture est érotique, la pornographie est romantique, le roman est amoral, et rien n’est plus captivant qu’un tsunami.
« Il n’y a pas de bonté, dit Jack, il n’y a pas de miséricorde dans cette merveilleuse nature.
— C’est une nature méchante, dis-je, elle nous hait, elle est notre ennemie. Elle hait les hommes.
— Elle aime nous voir souffrir, dit Jack à voix basse.
— Elle nous fixe avec des yeux froids, pleins de haine et de mépris.
— Devant cette nature, dit Jack, je me sens coupable, honteux, misérable. Ce n’est pas une nature chrétienne. Elle hait les hommes parce qu’ils souffrent.
— Elle est jalouse des souffrances des hommes, dis-je. » (Malaparte, La Peau , 1949.)
Ce que j’aime dans les romans : on ouvre un livre sur la Seconde Guerre mondiale et il vous parle d’une catastrophe naturelle datant du 11 mars 2011. Les romans ne sont pas là pour clarifier les choses mais pour les compliquer. Ce que nous voyons est moins vrai que ce que nous lisons. Les grands romans détiennent le mensonge qui éclairera nos existences. La vérité est planquée quelque part, dans une fiction. Mais laquelle ? Elle m’échappe comme une jolie femme. Je la cherche sans cesse, je la lis parfois, un jour j’essaierai de l’écrire.
Curzio Malaparte, une vie
Un jour Malaparte rencontre Benito Mussolini. Celui-ci lui pose une colle : « Alors mon cher, dites-moi, qu’auriez-vous fait si vous vous étiez appelé Bonaparte ? » Réponse du Toscan : « J’aurais perdu à Austerlitz et gagné à Waterloo. » Malaparte est un pseudonyme (« Bonaparte a mal fini, Malaparte finira bien »). Le vrai nom de Malaparte est Kurt-Erich Suckert (1898–1957). Son père était allemand (comme celui de Bukowski). Malaparte est le Hemingway italien, le Céline transalpin. Lui aussi fut blessé durant la Première Guerre. Fasciste jusqu’en 1933, résistant ambigu par la suite, il se fît construire la plus belle maison du monde à Capri (celle où Godard tourna Le Mépris). Il était vantard, mythomane, frimeur, narcissique, bref : un artiste normal. Ses meilleurs romans sont Kaputt (1943) et La Peau (1949). Il est aussi l’auteur de Technique du coup d’État, essai d’actualité en 1931 autant qu’en 2011 en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Jordanie, en Algérie… (complétez vous-même la liste).
Numéro 10 : « La Fêlure » de Francis Scott Fitzgerald (1936)
Ils ne sont pas nombreux, les livres qu’on peut relire tous les ans en vingt minutes, et qu’on a ensuite envie de serrer très fort contre son cœur jusqu’à les broyer. The Crack-Up est de ceux-là. Ce sont trois articles commandés par la revue Esquire (et publiés en février, mars et avril 1936). C’est à ma connaissance la première fois au monde qu’un homme brisé par l’alcool avoue publiquement, dans un magazine, son intoxication, sa dépression et son incapacité à écrire. C’est une lettre d’adieu absolument désespérée, et cependant d’une dignité qui force le respect. Sa parution fit scandale : les Américains furent choqués d’être confrontés avec une telle impudeur à la décadence de leur icône des années folles.
Comment échapper à sa légende ? De leur vivant, Scott et Zelda Fitzgerald trimballaient déjà un fardeau de clichés : enfants du jazz, buveurs de gin, danseurs excentriques, amants scandaleux, ils avaient taylorisé les rôles (lui, le fêtard bourré, et elle, la flapper flippée). Leur mort n’a fait qu’empirer la situation. Fitzgerald ne peut aujourd’hui être décrit autrement qu’en enfant gâté de la génération perdue ou comme symbole du chagrin en smoking.
Mais Francis Scott Fitzgerald fut d’abord un grand auteur comique, comme tous les grands auteurs tout court. Il possédait un sens de la provoc dandy qui me ravit : « J’avais des invités en croisière et c’était tellement drôle qu’il a fallu que je coule le yacht pour qu’ils rentrent chez eux. » Son œuvre entière — nouvelles et romans — est une satire légère de la haute bourgeoisie américaine, de ses mariages arrivistes et de son lucre ostentatoire. C’est Tchékhov réécrit par Saint-Simon. Et c’est en étudiant son humour qu’on découvre le vrai visage de Fitzgerald, celui d’un révolté. « Je suis essentiellement marxiste », nota-t-il dans les Notebooks retrouvés après sa mort. Fitzgerald, ancêtre de Che Guevara ? Derrière tout caricaturiste infiltré se cache un dangereux terroriste. Tendre est la nuit, c’est du Buñuel, du Ferreri, du Mocky. Gatsby est un voyou qui se moque des milliardaires. Aujourd’hui, Fitzgerald publierait « Un diamant gros comme le World Trade Center ».
« Le chapeau du prestidigitateur était vide. » La dépression économique de 1929 entraîna chez Scott une autre dépression, nerveuse celle-là. La Fêlure est le récit de son naufrage. Son auteur avait tout prévu de sa vie future, il comprend que dans sa jeunesse il rédigeait son propre avenir quand il riait des gens ruinés. Le malheur est prévisible, ce qui ne l’empêche pas d’arriver. L’incipit est célèbre : « Of course all life is a process of breaking down » (« Toute vie est bien entendu un processus de démolition »). La Fêlure raconte pourquoi et comment le grand écrivain du New York des années 20 se retrouve pauvre et démoli à Hollywood, deux décennies plus tard : « Et tout d’un coup, sans m’y attendre, j’allai mieux. — Et aussitôt que j’en eus vent, je me fêlai comme une vieille assiette. » La destruction s’est faite en quatre étapes : permettez-nous de vous proposer LA FÊLURE MODE D’EMPLOI.
Читать дальше