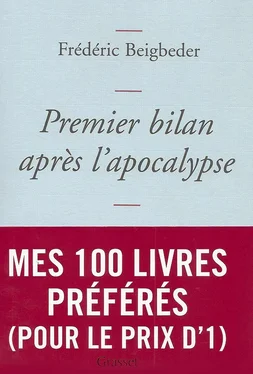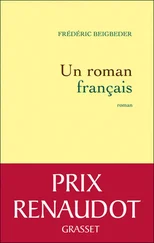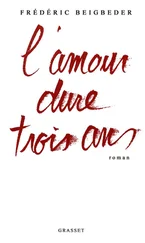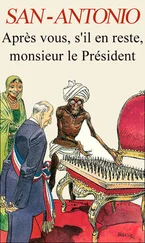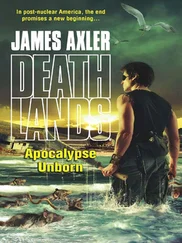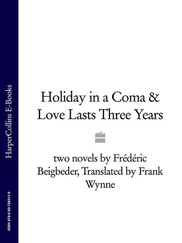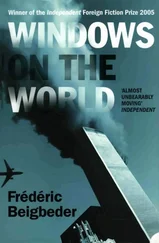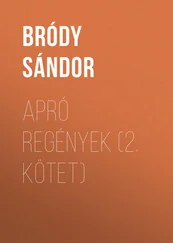Nada exist (expression de Francis Bacon signifiant à la fois que rien n’existe ou que seul le néant est certain) est un joyau de drôlerie amère et de cruauté désespérée : « Si on regarde les choses de près, tout est horrible. » Pourtant, ce n’est pas un roman nihiliste, au contraire, mais une ode à l’année 2007. Quand on parle aussi comiquement de la mort, on rend hommage à la vie, cette sublime déception. La grande littérature est toujours celle qui se gausse de notre finitude.
Simon Liberati, une vie
En dehors d’être le barbu ivre que vous avez peut-être découvert chez Thierry Ardisson il y a quelques années, Simon Liberati est aussi un écrivain professionnel. Je veux dire qu’il a longtemps écrit pour les autres : il a été nègre et journaliste. Il fut même brièvement « rédactrice en chef » (c’est lui qui le dit) du magazine Cosmopolitan au XXe siècle. Son premier roman, Anthologie des apparitions (Flammarion, 2004), était un hommage aux jeunes adolescents qui tramaient à l’Élysées-Matignon dans les années 70 en talons hauts et minijupe avant de finir dans des poubelles tropéziennes. Nada exist, plus étrange, long et original, était le road book d’une génération sans voyages. Plus étincelant, le troisième, L’hyper Justine, a obtenu le prix de Flore en 2009. Simon Liberati est né en 1960 à Paris mais il est pourtant un des premiers romanciers importants du XXIe siècle. Il prépare actuellement un récit sur l’accident mortel de Jayne Mansfield que, malheureusement, J. G. Ballard ne lira pas.
Numéro 72 : « Une vie à brûler » de James Salter (1997)
On croit qu’on se fout de la vie des autres, et je vais vous faire une confidence : c’est vrai. À priori, la vie de James Salter, vieil Américain de 86 ans, ex-pilote d’avion dans l’armée américaine, n’a rien pour nous passionner et, par ailleurs, on commence à en avoir marre des écrivains qui tiennent à tout prix à nous raconter leur biographie : où ils sont nés et à quelle heure, ce que faisaient leurs parents et comment ils se prénommaient, et toutes ces conneries à la David Copperfield. Quand Balzac a dit qu’il voulait « concurrencer l’état civil », il ne voulait pas dire « rédiger sa fiche d’état civil ». Et puis tout le monde n’est pas Chateaubriand. Dieu merci, James Salter n’est pas Monsieur-tout-le-monde. Sa vie, il s’en fout autant que nous : il a les Mémoires qui flanchent. Tout ce qu’il veut, c’est se souvenir de quelques émotions fugaces, de conversations perdues, de filles échappées. Il visite son passé comme un musée trop grand, sans s’appesantir sur chaque tableau. Ici, tiens, une promenade avec mon père ruiné chantant Otche Chornia (Les Yeux noirs). Là, une guerre en Corée. Et regardez, là-bas, c’est Jack Kerouac sur un terrain de foot. Vous ai-je parlé de cette femme dont j’étais amoureux et qui n’en a jamais rien su ? Laquelle ? Il y en a tellement.
Une vie à brûler n’est pas une autobiographie, c’est une soirée diapos chez un ami américain : des images défilent sur un drap jauni, instantanés éphémères, esquisses, bribes. Une vie passe si vite. Et se lit aussi rapidement. Comme Sagan dans Avec mon meilleur souvenir , Salter surfe sur son existence, énumère les rencontres qui ont compté ; il écrit le livre que Fitzgerald n’a pas eu le temps d’écrire, étant mort trop tôt. Quand j’étais adolescent — je le suis toujours, mais passons —, je voulais mourir à 30 ans. Aujourd’hui, j’en ai 45, et j’aimerais vivre vieux comme Salter, pour pouvoir me repencher sur ma vie et la feuilleter avec mélancolie et tendresse, comme un album de famille, en faisant semblant de m’en moquer. Une vie à brûler est donc le livre qui vous ôte l’envie de mourir jeune : « … il n’y a pas la place pour tout. Il n’y a que les générations qui s’avancent comme la marée, les années remplies de bruit et d’écume, qui sont ensuite balayées et englouties par le reste. C’est ce dont on hérite, à vivre dans les villes ». (Bénissons au passage la divine traduction de Philippe Garnier.)
Oui, on aimerait, comme James Salter ou Charles Simmons, devenir un beau vieux, au lieu d’un vieux beau. Simplement s’asseoir en costume froissé, et fermer les yeux pour se récapituler, glanant çà et là les moments de joie qui ont justifié notre présence sur terre. Oh, ce n’était pas grand-chose, « une maîtresse italienne tout ce qu’il y a de bien, qui prenait l’avion n’importe où pour me rejoindre », trois fois rien, les yeux émeraude de Lara Micheli, un soir d’automne, au Café du Soleil, à Genève… Quelqu’un a dit que la culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié : c’est faux. Mais c’est la meilleure définition possible du bonheur. Le bonheur, ce sont toutes ces petites choses auxquelles on pense quand on ne pense pas.
James Salter, une vie
Pour raconter sa vie, James Salter a écrit un livre de 439 pages et vous voudriez qu’on vous résume son existence en dix lignes ? Non mais vous me prenez pour Wikipédia ou quoi ? ! Certes, on pourrait vous dire que James Salter est né en 1925 à New York, qu’il fut pilote de chasse avant de plaquer l’armée pour écrire des scénarios et quelques beaux romans, dont Un sport et un passe-temps (son histoire d’amour avec une Française) et Un bonheur parfait (son Tendre est la nuit). Mais pour le reste, lisez son livre, vous ne le regretterez pas, et ainsi Salter ne mourra jamais.
Numéro 71 : « Journal parisien » de Ned Rorem (1951–1955)
Sur la couverture trône une photo de Ned Rorem par Henri Cartier-Bresson : on dirait Le Clézio. Mais dès qu’on entrouvre son Journal parisien, on ne trouve ni désert, ni Nouveau-Mexique, ni petites filles pauvres émigrées, ni chercheurs d’or indiens. La ressemblance physique n’entraîne pas de similitude littéraire, sinon je serais aussi drôle que Pierre Palmade. Ned Rorem tient son journal d’Américain à Paris mais il le fait sans exotisme ni condescendance, contrairement à Hemingway. C’est un Miller gay, ou plutôt un Truman Capote qui serait resté à Paris plus longtemps, ou une Shirley Gold-farb du sexe masculin. Ce livre d’une magnifique tapette absorbe et restitue les années 50 comme personne. Ivrogne invétéré, lèche-cul professionnel, obsédé séducteur, mégalomane soumis, faux timide et vrai arriviste, narcissique érudit : Rorem a toutes les qualités du parfait diariste. Marie-Laure de Noailles en était folle. Julien Green lui offrit une bible chez Galignani. Il rencontra Picasso, Dali, Jean Cocteau et Jean Marais, Paul Éluard, Boris Kochno, Christian Dior, Alice B. Toklas, Man Ray, Balthus et Cecil Beaton. Cela se passait il y a cinquante ans. Ce qui a changé ? Aujourd’hui, il rencontrerait au mieux Pierre Bergé, Karl Lagerfeld et François-Marie Banier, au pire Laurent Ruquier, Amanda Lear et Orlando. C’est juste que l’époque est différente.
Lire ces carnets intimes présente de nombreux avantages : on peut les reposer pour lire autre chose et les reprendre quand l’autre chose vous ennuie. On peut sauter les passages de name-dropping mélomane sans perdre le fil des ragots distrayants. On a réellement le sentiment d’être en 1951, bien plus que si on lisait un roman se déroulant en 1951. Si un héros de roman rencontrait Picasso, Green, Cocteau, etc., il ne serait pas crédible ! Chez Ned Rorem non plus, ce n’est pas vraisemblable, seulement c’est vrai. On recopiera avec bonheur une belle moisson d’aphorismes : « On ne peut continuer à bien créer sans être complimenté » ; « Puisqu’il nous faut vivre en cage, je préfère la construire moi-même » ; « L’Amour est Résignation, c’est-à-dire un incident qu’on ne sait différer » ; « Reconnaître que l’on est idiot n’empêche pas d’être idiot » ; « En France, les disputes renforcent une histoire d’amour, en Amérique elles l’achèvent » ; « Nos dons ne sont pas des dons puisqu’on les paie très cher » ; « Tous les artistes ne sont-ils pas le croisement d’un enfant et d’une vicomtesse ? » Cela dit, la meilleure phrase du livre n’est pas de Ned Rorem mais du poète John Ashbery : « Quand on a été heureux à Paris, on ne peut plus l’être ailleurs — même pas à Paris. » Les plus belles phrases sont celles qu’on ne comprend pas tout à fait mais qu’on ressent profondément : elles s’adressent à notre âme davantage qu’à notre cerveau.
Читать дальше