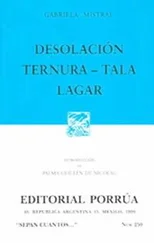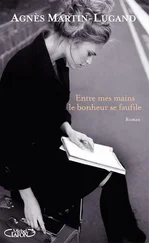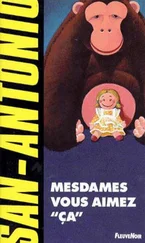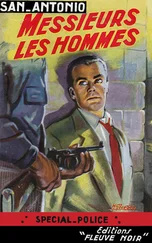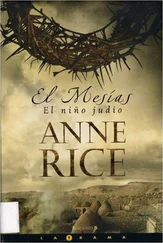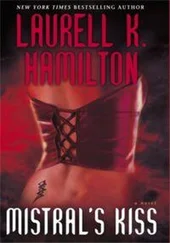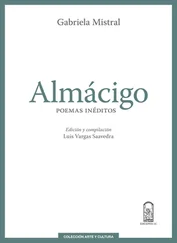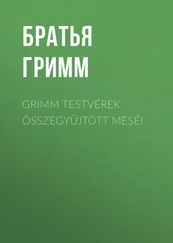Il me souvient que le matin, tant que dura l’investissement, – et il dura toute une semaine, – les gens partaient avec leurs vivres et allaient se poster sur les coteaux et les mamelons qui dominent l’abbaye pour épier, de loin, le mouvement de la journée. Le plus joli, c’étaient les filles de Barbentane, de Boulbon, de Saint-Remy ou de Maillane, qui, pour encourager les assiégés de Saint-Michel, chantaient avec passion, et en agitant leurs mouchoirs:
Provençaux et catholiques,
Notre foi, notre foi, n’a pas failli:
Chantons, tous tressaillants,
Provençaux et catholiques.
Tout cela, mêlé d’invectives, de railleries et de huées à l’adresse des fonctionnaires, qui défilaient farouches, là-bas, dans leurs voitures.
A part l’indignation qui soulevait dans les cœurs l’iniquité de ces choses, le Siège de Caderousse, par le vice-légat Sinibaldi Doria, – qui a fourni à l’abbé Favre le sujet d’une héroïde extrêmement comique, était, certes, moins burlesque que celui de Frigolet; et aussi un autre abbé en tira-t-il un poème qui se vendit en France à des milliers d’exemplaires. Enfin, à son tour, Daudet, qui avait déjà placé dans le couvent des Pères Blancs son conte intitulé l’Élixir du Frère Gaucher, Daudet, dans son dernier roman sur Tarascon, nous montre Tartarin s’enfermant bravement dans l’abbaye de Saint-Michel.
CHAPITRE VI: CHEZ MONSIEUR MILLET
L’oncle Bénoni – La farandole au cimetière. – Le voyage en Avignon. – Avignon il y a cinquante ans. – Le maître de pension. – Le siège de Caderousse. – La première communion. – Mlle Praxède. – Pélerinage de Saint-Gent. – Au collège Royal. – Le poète Jasmin. – La nostalgie de mes quatorze ans.
Et, alors, il fallut me chercher une autre école pas trop éloignée de Maillane, ni de trop haute condition, car nous autres campagnards, nous n’étions pas orgueilleux et l’on me mit en Avignon chez un M. Millet, qui tenait pensionnat dans la rue Pétramale.
Cette fois, c’est l’oncle Bénoni qui conduisit la voiture. Bien que Maillane ne soit qu’à trois lieues d’Avignon, à cette époque où le chemin de fer n’existait pas, où les routes étaient abîmées par le roulage et où il fallait passer avec un bac le large lit de la Durance, le voyage d’Avignon était encore une affaire.
Trois de mes tantes, avec ma mère, l’oncle Bénoni et moi, tous gîtés sur un long drap plein de paille d’avoine qui rembourrait la charrette, nous partîmes en caravane après le lever du soleil.
J’ai dit «trois de mes tantes». Il en est peu, en effet, qui se soient vu, à la fois, autant de tantes que moi; j’en avais bien une douzaine; d’abord, la grand’Mistrale, puis la tante Jeanneton, la tante Madelon, la tante Véronique, la tante Poulinette et la tante Bourdette, la tante Françoise, la tante Marie, la tante Rion, la tante Thérèse, la tante Mélanie et la tante Lisa. Tout ce monde, aujourd’hui, est mort et enterré; mais j’aime à redire ici les noms de ces bonnes femmes que j’ai vues circuler, comme autant de bonnes fées, chacune avec son allure, autour de mon berceau. Ajoutez à mes tantes le même nombre d’oncles et les cousins et cousines qui en avaient essaimé, et vous aurez une idée de notre parentage.
L’oncle Bénoni était un frère de ma mère et le plus jeune de la lignée. Brun, maigre, délié, il avait le nez retroussé et deux yeux noirs comme du jais. Arpenteur de son état, il passait pour paresseux, et même il s’en vantait. Mais il avait trois passions: la danse, la musique et la plaisanterie.
Il n’y avait pas, dans Maillane, de plus charmant danseur, ni de plus jovial. Quand, dans «la salle verte», à la Saint-Eloi ou à la Sainte-Agathe, il faisait la contredanse avec Jésette le lutteur, les gens, pour lui voir battre les ailes de pigeon, se pressaient à l’entour. Il jouait, plus ou moins bien, de toutes sortes d’instruments: violon, basson, cor, clarinette; mais c’est au galoubet qu’il s’était adonné le plus. Il n’avait pas son pareil, au temps de sa jeunesse, pour donner des aubades aux belles ou pour chanter des réveillons dans les nuits du mois de mai. Et, chaque fois qu’il y avait un pèlerinage à faire, à Notre-Dame-de-Lumière, à Saint-Gent, à Vaucluse ou aux Saintes-Maries, qui en était le boute-en-train et qui conduisait la charrette? Bénoni, toujours dispos et toujours enchanté de laisser son labeur, son équerre et sa maison pour aller courir le pays.
Et l’on voyait des charretées de quinze ou vingt fillettes qui partaient en chantant:
A l’honneur de saint Gent.
Ou
Alix, ma bonne amie,
Il est temps de quitter
Le monde et ses intrigues,
Avec ses vanités.
Ou bien:
Les trois Maries,
Parties avant le jour,
S’en vont adorer le Seigneur.
Avec mon oncle, assis sur le brancard de la charrette, qui les accompagnait avec son galoubet, et chatouille-toi et chatouille-moi, en avant les caresses, les rires et les cris tout le long du chemin!
Seulement, dans la tête, il s’était mis une idée assez extraordinaire: c’était, en se mariant, de prendre une fille noble.
– Mais les filles nobles, lui objectait-on, veulent épouser des nobles, et jamais tu n’en trouveras.
– Hé! ripostait Bénoni, ne sommes-nous pas nobles, tous, dans la famille? Croyez-vous que nous sommes des manants comme vous autres? Notre aïeul était émigré; il portait le manteau doublé de velours rouge, les boudes à ses souliers, les bas de soie.
Il fit tant, tourna tant, que, du côté de Carpentras, il entendit dire, un jour, qu’il y avait une famille de noblesse authentique, mais à peu près ruinée, où se trouvaient sept filles, toutes à marier. Le père, un dissipateur, vendait un morceau de terre tous les ans à son fermier, qui finit même par attraper le château. Mon brave oncle Bénoni s’attifa, se présenta, et l’aînée des demoiselles, une fille de marquis et de commandeur de Malte, qui se voyait en passe de coiffer sainte Catherine, se décida à l’épouser. C’est sur la donnée de ces nobles comtadins, tombés dans la roture, qu’un romancier Carpentrassien, Henri de la Madeleine, a fait son joli roman: la Fin du Marquisat d’Aurel. (Paris, Charpentier, 1878.)
J’ai dit que mon oncle était paresseux. Quand, vers milieu du jour, il allait à son jardin, pour bêcher ou reterser, il portait toujours son flûteau. Bientôt, il jetait son outil, allait s’asseoir à l’ombre et essayait un rigaudon. Les filles qui travaillaient dans les champs d’alentour accouraient vite à la musique et, aussitôt, il leur faisait danser la saltarelle.
En hiver, rarement il se levait avant midi.
– Eh! disait-il, bien blotti, bien chaud dans votre lit, où pouvez-vous être mieux?
– Mais, lui disions-nous, mon oncle, ne vous y ennuyez-vous pas?
– Oh! jamais. Quand j’ai sommeil, je dors; quand je n’ai plus sommeil, je dis des psaumes pour les morts.
Et, chose singulière, cet homme guilleret ne manquait pas un enterrement. Après la cérémonie, il demeurait toujours le dernier au cimetière, d’où il s’en revenait seul, en priant pour les siens et pour les autres, ce qui ne l’empêchait pas de répéter, chaque fois, cette bouffonnerie:
– Un de plus, charrié à la Cité du Saint-Repos!
Il dut bien, à son tour, y aller aussi. Il avait quatre-vingt-trois ans, et le docteur, ayant laissé entendre à la famille qu’il n’y avait plus rien à faire:
– Bah! répondit Bénoni, à quoi bon s’effrayer! il n’en mourra que plus malade.
Et, comme il avait son flûteau sur sa table de nuit:
– Que faites-vous de ce fifre-là, mon oncle? lui demandai-je, un jour que je venais le voir.
Читать дальше