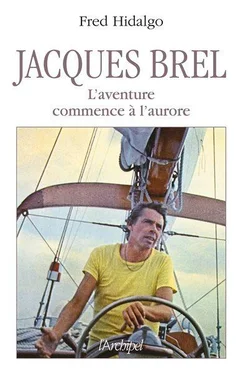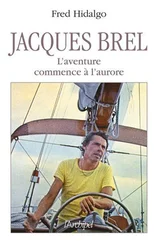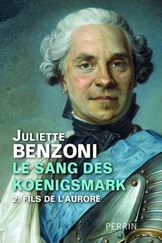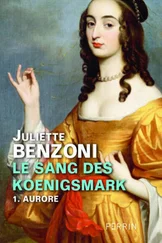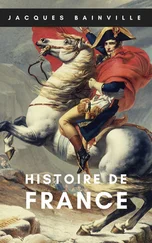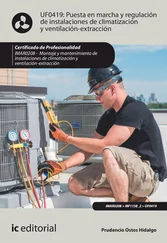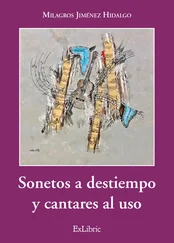Lama ! Que d’allusions à cet artiste depuis qu’il a quitté la France ! À Pierre Perret, rencontré en bateau dans les Grenadines (« Pierrot, quand tu verras Lama, dis-lui qu’il me reste encore un poumon ! ») ; à Eddie Barclay, dans une lettre signée « Lama Van Brel » ; à Carlos, après l’hospitalisation de celui-ci à Papeete, dans une cassette qu’il lui adresse, accent belge à l’appui (« Mon cher Carlos, voici le vieux Lama belge ») ; à d’autres encore (« Dites à Lama de ne plus tousser, j’ai arrêté de fumer ! ») ; à Claude Lemesle… Ce dernier avance aujourd’hui cette interprétation : « Monsieur Brel a réussi à construire sa propre statue de son vivant en abandonnant la scène à trente-sept ans. Mais, quelque part, ça l’exaspère de savoir que quelqu’un occupe à présent son créneau, indûment, selon lui. Ce n’est pas si facile, même quand on l’a voulu, qu’on y a tenu, de renoncer à la première place dans le cœur des gens. Lama est tout ce qu’il déteste, parce que Lama vit tout ce qu’il ne vit plus. Même les adieux sincères sont difficiles [248] Claude Lemesle, op. cit.
. »
Possible. Probable même… bien qu’un malentendu, semblable à celui qui a causé « l’affaire Antoine », ait sans doute été à l’origine de celle-ci. Serge Lama : « Il a dit que, quand il avait mal aux poumons, Lama toussait. En réalité, c’est moi qui l’ai dit en premier. Il se trouvait dans les îles et, lorsque j’ai dit ça, j’ai voulu faire un mot d’esprit, avec un total respect. J’ai dit : “Dites à Brel qu’il se soigne bien, parce que quand il a mal aux poumons, c’est moi qui tousse.” Je reste persuadé que si je lui avais dit ça en tête à tête, il l’aurait pris avec humour et il en aurait rigolé. Mais je ne sais pas comment ça lui a été rapporté. Par contre, la seule fois où je l’ai rencontré, il m’a dit des choses aimables. C’était au Don Camillo. Il m’a barré le passage, alors que j’avançais, et il m’a dit qu’il aimait beaucoup ce que je faisais. J’étais tellement ému que j’ai juste balbutié quelques phrases [249] Eddy Przybylski, op. cit.
. » Il est certain que Brel n’aurait jamais fait autant de cas d’un artiste qui lui était insignifiant ; il fallait forcément qu’il lui portât une certaine estime, au moins professionnelle.
Juillet 1977, Papeete. « Nous buvons un armagnac ou deux, se rappelle Claude Lemesle. Il a un peu grossi et s’est laissé pousser une petite barbiche. Il part le lendemain enregistrer à Paris et me confie que ça ne l’amuse pas, qu’il le fait pour son ami Eddie Barclay.
« Chose étrange : c’était la dernière fois que je voyais Jacques Brel vivant et je me suis rendu compte un jour que, trois ans plus tard, Joe Dassin était mort exactement au même endroit, au fond du restaurant, à droite. Il y a de ces coïncidences [250] Claude Lemesle, op. cit.
! »
À présent, le premier étage de l’établissement où les deux hommes échangèrent ces derniers mots n’existe plus, remplacé par une boutique de vêtements. Mais, au rez-de-chaussée du même bar-restaurant, Le Métro, au centre commercial Vaima de Papeete, une plaque rappelle que Joe Dassin est décédé là, d’une crise cardiaque, le 20 août 1980, à l’âge de quarante et un ans. Claude Lemesle, qui était présent ce jour-là, n’a pas tort : il y a de ces coïncidences…
Quelques jours plus tôt, le Grand Jacques avait demandé à Paul-Robert Thomas pourquoi il avait choisi de s’installer à Tahiti, après un parcours aussi atypique, lui le pied-noir déraciné en 1962. Né à Sétif, en Algérie, « le dernier jour de la Seconde Guerre mondiale », il se souvenait de ce déferlement de violence qui avait mis fin brusquement à son enfance et à son insouciance : « L’évasion et la découverte n’existaient plus alors que dans les têtes et les livres. Je lisais et relisais Le Tour du monde en quatre-vingts jours , les souvenirs d’Albert Schweitzer… Tout cela emplissait mon crâne d’aventures et de merveilleux. Dehors, dans les rues, claquaient les armes automatiques. Il fallut plus de deux mille jours et deux mille nuits pour que se taisent le tambour et le canon. »
Brel : « Pourquoi es-tu venu t’installer ici, toubib ? »
Thomas : « Le hasard et la chance. »
Brel : « Le hasard et la chance n’existent pas ! Seuls la volonté et le travail existent. Thomas Edison avait raison : “Le génie c’est un pour cent d’inspiration, avec quatre-vingt-dix-neuf pour cent de transpiration.” Ou “Ceux qui vivent sont ceux qui luttent.” C’est de Victor Hugo, dans Les Châtiments . »
15
QUAND JE SERAI VIEUX, JE SERAI INSUPPORTABLE
Dans la petite case immaculée où, par manque de brise, il vit dans l’attente de s’installer vraiment chez lui, sur les hauteurs accueillant « quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin », Jacques Brel avance, laborieusement, dans l’écriture et la composition de ses nouvelles chansons. Ce sont d’abord des bribes, en cours de création, dont profitent les oreilles du voisinage et jusqu’aux sœurs du collège ; puis des esquisses, enregistrées sur bandes ou sur cassettes, qu’il fait écouter, timidement et avec un brin d’anxiété, le soir à ses invités.
Premier semestre 1977 : débarrassé du souci de son bateau, Jacques peut donner libre cours à sa passion autrement plus forte et irréversible pour l’avion, qui l’attend chaque jour ou presque dans son petit hangar à quelques kilomètres au-dessus d’Atuona. Ouverte un an plus tôt, la piste d’atterrissage n’est qu’un plateau herbeux de six cent quinze mètres de long, comme un porte-avions régulièrement noyé sous la pluie ou perdu dans les nuages, perché à 450 mètres d’altitude. « Quel que soit le temps, rappelle Serge Lecordier [251] Ancien de la Marine nationale, Serge Lecordier est arrivé en Polynésie française en 1967, à l’âge de vingt ans, « pour être affecté aux travaux de préparation des tirs aériens atmosphériques sur les atolls de Mururoa et Fangataufa ». Revenu à la vie civile, il s’est installé en 1980 à Hiva Oa, travaillant dans le tourisme (il loue aujourd’hui des bungalows haut de gamme) et a publié un ouvrage autobiographique, Hanakéé, la baie des Traîtres, Parcours d’une vie aux Marquises (L’Harmattan, 2012), où il témoigne notamment des essais nucléaires auxquels il a participé et de l’irradiation dont il a lui-même été victime.
, ancien directeur du Comité du tourisme d’Atuona, dans la plus pure tradition de l’Aéropostale, il s’envolait, indifférent aux imprévisibles tempêtes du Pacifique ; l’un de ses plaisirs favoris étant d’aller se poser sur Ua Pou [252] L’une des îles du groupe Sud de l’archipel, où Jacques Brel se rendait chaque semaine pour transporter le courrier ou des passagers.
, sur une piste excessivement dangereuse. Il s’agit d’un terrain improvisé, sans balisage, avec la montagne devant et sur les côtés ! De plus, le terrain est en pente et légèrement courbé en bout ! Si on rate la manœuvre, il est impossible de se représenter : “Je me flanque la trouille !”, disait-il en décollant et en atterrissant à Ua Pou. »
Son fameux principe d’imprudence ! Jacques Brel était persuadé depuis toujours que le risque devait être inhérent à la vie — « Vivre, c’est très mauvais pour la santé, il n’y a rien qui use plus un homme que vivre ; alors autant vivre en ayant des sensations que vivre sans en avoir » —, mais « le risque calculé, pas fou du tout, avait-il expliqué avant de larguer totalement les amarres [253] Au journaliste Henry Lemaire, lors d’un entretien réalisé à Knokke-le-Zoute, le 8 janvier 1971, dans le club The Gallery d’un grand ami de Jacques, Franz Jacobs (d’où le titre, Franz , de son film avec Barbara).
. J’ai horreur de faire du cent quatre-vingts à un carrefour pour voir si quelqu’un va arriver ou pas ; la roulette russe, ça ne m’amuse pas du tout. J’aime beaucoup chiader un risque, mais je le prends tout de même, en calculant très sérieusement. Parfois je me casse la gueule, eh bien ça fait partie des sensations de la vie… L’avion c’est ça, mais c’est extrêmement chiadé ».
Читать дальше