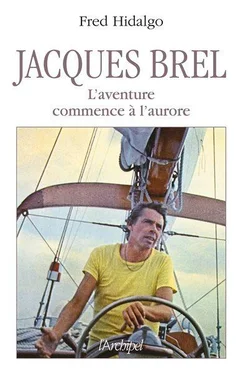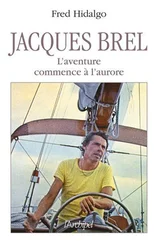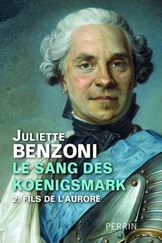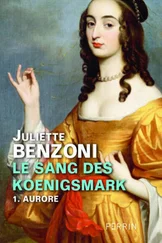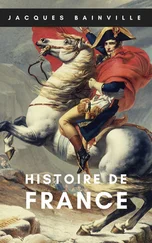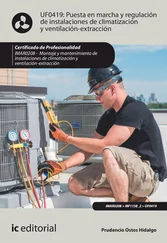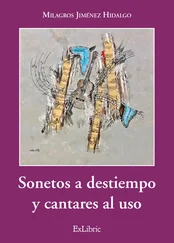Cette nuit de novembre, dans la douceur polynésienne, le léger clapotis de la houle pour seul bruit de fond, la discussion démarre sur Jean Ferrat. Sans raison particulière, sinon pour évoquer l’actualité plus ou moins récente (à Tahiti comme aux Marquises, le temps s’immobilise…) des grands de la chanson française, que Brel connaît bien. Ferrat aussi a fait ses adieux à la scène, en 1972, onze ans seulement après son premier album, cinq ans après Brel, peut-être inspiré par son exemple ; ce qui ne l’empêche pas de continuer à écrire, composer et enregistrer. Claude Lemesle : « Il vient de sortir [234] En fait, l’album éponyme était paru un an plus tôt, en novembre 1975.
une chanson qui s’appelle La femme est l’avenir de l’homme , d’après une phrase d’Aragon. » Jacques Brel : « Il a fait ça, le con ! » Commentaire de Lemesle : « C’est péremptoire, injuste, mais il a l’air sincère. »
Sans doute, mais que voulait dire exactement le Grand Jacques ? Simple différence d’appréciation sur le rôle de la femme ? Féminisme affiché chez l’un et misogynie patente chez l’autre ? Pas aussi simple… Outre que cette prétendue misogynie lui permettait d’échapper à une explication de texte approfondie, si Brel a souvent parlé des femmes en termes tranchants et trop généraux — genre « Les femmes sont toujours en dessous de l’amour dont on rêve » —, c’était surtout, comme le soutient Maddly, « parce qu’il aimait trop les femmes pour supporter qu’elles se “vendent”, qu’elles descendent du piédestal sur lequel il les plaçait ». Séquelles logiques d’un romantisme absolu remontant à l’enfance ; couplé peut-être à une certaine peur du sexe opposé due à l’absence de toute fréquentation féminine de son âge, époque et milieu catholico-bourgeois aidant, jusqu’à la fin de l’adolescence.
C’est encore Maddly Bamy qui touchera le plus près à la vérité, lorsqu’on lui rappellera ces propos de celui qu’elle a connu mieux que quiconque, du moins dans des circonstances exceptionnelles, que personne d’autre qu’elle n’a partagées ; à ces affirmations du Grand Jacques (« Je n’ai jamais très bien compris les femmes ; là, j’ai bien conscience d’être passé à côté de quelque chose d’important par paresse ou par pudeur », etc.), elle répondra simplement, avec un sourire entendu, que c’était « avant ». Avant de la connaître, elle. Avant qu’ils ne partent, ensemble, au bout du monde.
« Si tous les hommes de la terre se tenaient le cœur, ils ne t’aimeraient pas plus que moi. » Ces mots d’amour d’un homme en fin de vie étaient-ils ceux d’un individu haïssant les femmes ? « Je sais bien que je ne chanterai plus jamais, que je n’écrirai plus jamais, que je ne ferai plus jamais la cuisine. Je sais bien que je ne volerai plus. Je sais bien tout ça. Mais je suis heureux parce que tu es là. C’est peut-être idiot de dire cela ici [235] À la clinique Hartmann de Neuilly, en septembre 1978.
, mais je suis heureux et c’est à cause de toi [236] Maddly Bamy, Tu leur diras, op. cit.
. » Et que penser, alors, de ces paroles de la femme qui lui a tenu la main jusqu’à la fin ? « Il aimait qu’on ait besoin de lui, pour servir un peu à quelque chose. Je l’ai reconnu tout de suite, cet homme qui me tendait la main, me déposait son cœur [237] Ibid.
… »
Mais revenons-en au poète qui aurait « toujours raison », parce qu’il « voit plus haut que l’horizon » :
Et le futur est son royaume
Face à notre génération
Je déclare avec Aragon
La femme est l’avenir de l’homme [238] Jean Ferrat, La femme est l’avenir de l’homme , 1975 © Productions Alleluia.
Claude Lemesle : « Quelques mois plus tard, lorsque j’écouterai son nouveau disque, je découvrirai qu’il a ajouté un pont à La ville s’endormait , qu’il était en train d’écrire au moment où nous avons eu ce dialogue : “Mais les femmes toujours / Ne ressemblent qu’aux femmes / Et d’entre elles les connes / Ne ressemblent qu’aux connes / Et je ne suis pas bien sûr / Comme chante un certain / Qu’elles soient l’avenir de l’homme…” Alors, je me dirai : “Tu aurais mieux fait de fermer ta gueule [239] Claude Lemesle, op. cit.
!” » Sans doute, car dans le brouillon de cette chanson — brouillon enregistré que nous retrouverons, miraculeusement préservé, lors de notre séjour polynésien —, le pont en question, Claude Lemesle parle vrai, est encore absent.
À la sortie du disque, cela donna en tout cas du grain à moudre aux médias, qui ne manquèrent pas d’utiliser ce passage pour stigmatiser à nouveau « la misogynie de Jacques Brel ». Comme si la « connerie » évoquée dans ces vers ne pouvait concerner que le genre masculin et non le genre humain dans son ensemble. Comme si Brel — c’était lui faire injure — ne maîtrisait pas assez la langue française pour déceler la différence entre une affirmation sans appel et une expression d’ordre dubitatif : « Je ne suis pas bien sûr… »
Qui sait, du reste, s’il ne voulait pas simplement signifier par cette objection à une belle formule poétique (qui elle-même n’avait peut-être d’autre dessein qu’un effet esthétique immédiat) son désaccord avec l’idée que l’avenir de l’humanité dût forcément découler d’une seule moitié de celle-ci ? Comme j’aurais voulu pouvoir en discuter avec l’intéressé ! Éventualité tout sauf illusoire, car « s’il était un homme qui aimait les contacts, c’était bien Jacques Brel. En aucune circonstance, rapportera Maddly, je ne l’ai vu éviter l’homme qui souhaitait s’adresser à lui… quand ce n’était pas lui-même qui prenait les devants. Le fait d’être Jacques Brel, le grand Jacques Brel, ne lui était pas monté à la tête et il n’attendait pas que l’on se prosterne sur son passage. Il aimait susciter l’intérêt par ce qu’il disait et, même sans sa célébrité, anonyme dans la foule, il en aurait fait autant car c’était un de ses traits de caractère [240] Pour le jour qui revient…, op. cit.
». Mais, contrairement à Lemesle, l’occasion de le rencontrer ne m’aura jamais été donnée, n’ayant débuté dans le journalisme qu’après ses adieux à la scène et n’étant rentré de mes Afriques qu’après sa disparition. Du jeu de la chance et du hasard… En revanche, j’aurai eu le privilège de connaître, voire côtoyer de près, la plupart des grands auteurs-compositeurs que j’écoutais, ébloui, durant mon enfance. Des grands et des géants de celle-ci, tels Charles Trenet, « le père de la chanson française moderne », ou… « un certain » Jean Ferrat, que je rencontrerais régulièrement dès 1980.
Cette année-là justement — l’année de la création de Paroles et Musique auquel l’homme d’Antraigues, solidaire de ses objectifs de promotion de la chanson vivante, s’était aussitôt abonné —, il avait accepté de me recevoir, sans limite de durée [241] Souvent, dans le show business, les artistes reçoivent les représentants de la presse à la suite, pour ne pas dire à la chaîne, « évacuant » ainsi la plupart des périodiques nationaux et régionaux en une ou deux journées seulement, à raison de courts entretiens standardisés de promotion. Avec Ferrat, rien de tel ce jour de décembre 1980 (ni les nombreuses fois suivantes), mais plusieurs heures de conversation sans tabou et dans une ambiance chaleureuse. À la fin, il m’accorda même tout le temps nécessaire à une séance photo en vue de la couverture du numéro concerné ( Paroles et Musique n° 7, février 1981).
, pour un premier et long entretien. Le motif en était son retour discographique avec Le Bilan — un album qui ferait couler beaucoup d’encre et de salive et deviendrait avec plus d’un million d’exemplaires le disque le plus vendu en France… depuis celui de Brel —, mais notre discussion, dépassant largement ce cadre, donnerait lieu en définitive à un autre bilan, celui de sa carrière.
Читать дальше