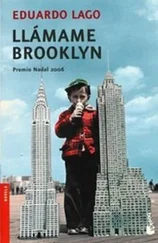— Tout est limpide, Alan, dis-je en rouvrant les yeux avant de dérouler pour lui mon scénario. Ce samedi-là, le gouverneur, Zorah et Blunt quittent Philadelphie en voiture en début d’après-midi. Copeland a rendez-vous avec Joyce. L’entretien se passe mal. La conversation dégénère en dispute. Copeland panique et la tue. Puis il découvre que Florence l’a enregistré à son insu. Il revient à Philadelphie seul, sans garde du corps, pour assister au match de basket et donner le change. Pendant ce temps, Blunt et Zorah restent à New York et s’occupent du sale boulot : déplacer le corps de Joyce et maquiller la scène de crime pour faire croire à une overdose et mettre Florence hors d’état de nuire. Tout se tient, bon sang !
Accablé, Alan posa la tête entre ses mains. J’avais l’impression d’être dans son crâne. Un chaos bourdonnant où la colère se mêlait au chagrin. Peut-être repensait-il aux mois de bonheur avec Florence. Ce moment où tout était encore possible : avoir des enfants avec elle, se projeter dans l’avenir, avoir la sensation grisante d’être un acteur et non un figurant de sa propre vie. Peut-être se représentait-il la mort atroce qu’avait endurée la seule femme qu’il eût jamais aimée. Peut-être songeait-il au temps qui, depuis, avait filé. Un temps passé à s’abrutir dans le travail. Peut-être se disait-il que finalement Marilyn Monroe n’avait pas tort lorsqu’elle affirmait qu’une carrière réussie était une chose merveilleuse, mais qu’on ne pouvait pas se pelotonner contre elle la nuit quand on avait froid.
— Qu’est-ce que vous allez faire ? me demanda-t-il en me regardant comme s’il émergeait d’un lourd sommeil.
— Vous êtes prêt à m’aider, Alan ?
— Je ne sais pas si j’y suis prêt, mais je vais le faire, en souvenir de Florence.
— Est-ce que vous avez un moyen de joindre Zorkin ?
— Oui, j’ai un numéro de portable. Celui que j’ai utilisé pour négocier avec elle l’interview de Copeland.
Tandis qu’il cherchait dans le carnet d’adresses de son téléphone, je composai un bref SMS qui disait seulement : Je sais ce que vous avez fait à Florence Gallo, à Joyce Carlyle et à sa fille.
— Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, Raphaël. Ils traceront facilement votre téléphone. Vous serez localisé en moins de dix minutes.
— Mais c’est bien ce que j’espère, répondis-je. Moi aussi, je sais jouer aux échecs.
Les animaux à sang froid sont les seuls venimeux.
Arthur SCHOPENHAUER
1.
Dix-sept ans plus tôt
Printemps 1999
Je m’appelle Tad Copeland. J’ai trente-neuf ans. Je suis professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à l’université de Pennsylvanie. En ce samedi matin du printemps 1999, je reviens d’une partie de pêche, mais, comme souvent, ce n’était qu’un prétexte pour passer quelques heures tranquilles, au milieu de la nature.
Tandis que j’amarre ma barque au ponton de bois qui s’avance sur les eaux frémissantes du lac, Argos, mon labrador, se précipite vers moi et me tourne autour en jappant et en remuant la queue.
— Allez, viens mon chien !
Il me dépasse et fonce en direction d’un grand chalet de construction moderne, alliage harmonieux de mélèze, de pierre et de verre. Mon refuge de chaque week-end.
Une fois à la maison, je me prépare un café en écoutant à la radio le saxophone de Lester Young. Puis je m’installe sur la terrasse en rondins et savoure une cigarette en parcourant les journaux et en corrigeant quelques copies. Sur mon téléphone, un message de ma femme, Carolyn, retenue à Philadelphie et qui doit venir me rejoindre en milieu de journée. Je compte sur toi pour me préparer tes pâtes au pesto ! Des bises ! C.
Un bruit de moteur me fait lever la tête. Je chausse mes lunettes de soleil et plisse les yeux. Même de loin, je reconnais immédiatement cette silhouette menue à la démarche vive : Zorah Zorkin.
Comment l’oublier ? Elle a été mon élève il y a quatre ou cinq ans, et ce n’était pas n’importe quelle élève. C’était même de loin la meilleure étudiante de toute ma carrière d’enseignant. Un esprit vif, implacable, une capacité hors du commun à développer des raisonnements intelligents sur tous les sujets. Une culture phénoménale sur la politique et l’histoire des États-Unis. Une vraie patriote qui défendait pied à pied des positions que je partageais et d’autres sur lesquelles je n’étais pas d’accord. Un esprit brillant, donc, mais rien d’autre : pas d’humour, peu d’empathie, et, à ma connaissance, ni copain ni copine.
Je me souviens que j’éprouvais toujours un vrai plaisir à discuter avec elle, ce qui n’était pas le cas de tous mes collègues. Beaucoup d’enseignants étaient mal à l’aise avec Zorah. La faute à son intelligence froide qui avait parfois quelque chose de flippant. La faute à son regard, souvent absent lorsqu’elle était perdue dans ses réflexions, et qui, d’un seul coup, pouvait s’allumer avant de vous planter une saillie affûtée comme une banderille.
— Bonjour, professeur Copeland.
Elle est debout devant moi, mal fagotée, flottant dans un jean usé et un pull informe et pelucheux, tenant sur son épaule la lanière d’un sac à dos qu’elle doit avoir depuis le lycée.
— Salut, Zorah. Qu’est-ce qui me vaut ta visite ?
Nous échangeons quelques banalités, puis elle me raconte ses débuts dans la vie professionnelle. J’ai entendu parler de son parcours. Je sais que, ces dernières années, après la fac, elle a fait ses armes en travaillant sur plusieurs campagnes électorales locales, obtenant des résultats plutôt flatteurs avec des candidats qui n’avaient pourtant que peu d’envergure, se forgeant une petite réputation de conseillère politique qu’il est préférable d’avoir avec soi que contre soi.
— Je pense que vous valez mieux que ça, dis-je en lui servant une tasse de café. Si vous voulez faire de grandes choses, il faut que vous trouviez un candidat à la mesure de votre intelligence.
— Justement, répondit-elle. Je crois que j’en ai trouvé un.
Je la regarde souffler sur son café. Un teint de lune éclaire son visage dont toute beauté est gommée par la frange épaisse et mal coupée qui lui retombe sur les yeux.
— Vraiment, dis-je. Je le connais ?
— C’est vous, Tad.
— J’ai du mal à comprendre.
Elle ouvre la fermeture Éclair de son sac pour en sortir des projets d’affiches, un slogan, des pages imprimées et reliées décrivant une stratégie électorale. Alors qu’elle déballe son matériel sur le vieil établi en bois qui me sert de table de jardin, je l’arrête avant qu’elle n’aille plus loin :
— Attends, Zorah, je n’ai jamais voulu faire de politique.
— Vous en faites déjà : votre association, votre mandat de conseiller municipal…
— Je veux dire : je n’ai pas de plus hautes ambitions.
Elle me regarde avec ses grands yeux serpentins.
— Je pense que si.
– À quel poste voudrais-tu que je me présente ?
— Pour commencer, à la mairie de Philadelphie. Ensuite, au poste de gouverneur de Pennsylvanie.
Je hausse les épaules.
— Tu racontes n’importe quoi, Zorah. Philadelphie n’a jamais élu un républicain à sa tête.
— Si, répond-elle du tac au tac. Bernard Samuel, en 1941.
— Bon, peut-être, mais c’était il y a soixante ans. Ça ne serait plus possible aujourd’hui.
Elle ne trouve pas mon argument convaincant.
— Vous n’êtes pas un vrai républicain, Tad, et votre femme descend d’une vieille famille démocrate et très respectée.
Читать дальше