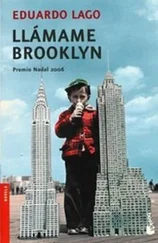— Si, justement ! Il a même été réédité plusieurs fois, mais, dans les nouvelles éditions, les deux photos de Joyce avaient disparu.
Je me fis l’avocat du diable :
— Il peut y avoir mille raisons à cela. Vous l’avez dit vous-même : si ces clichés sont équivoques, il n’est pas anormal que l’homme politique ait cherché à les faire disparaître d’une biographie. D’autant qu’il était marié.
— Sauf que ça ne s’est pas arrêté là, assura Alan en se retournant vers Chris & Cross.
La rousse flamboyante expliqua :
— On a un peu fouillé dans les arcanes du Web, notamment sur les sites de vente de livres d’occasion. Chaque fois qu’un exemplaire de l’édition originale refait surface, par exemple sur Amazon ou sur eBay, il est presque instantanément racheté pour une grosse somme.
— Par qui ?
Elle haussa les épaules.
— Difficile de le savoir avec certitude, mais pas très compliqué à deviner.
Pour la première fois, Chris, l’androgyne timide, sollicita la parole :
— Il y a autre chose. À l’époque, certaines médiathèques ou bibliothèques municipales de Pennsylvanie avaient acquis la biographie. J’ai réussi à en contacter quelques-unes. On trouve bien la trace du livre sur leurs catalogues en ligne, mais, concrètement, le bouquin n’est jamais sur les rayons. Soit il a été perdu, soit il a été emprunté et jamais rendu.
D’un geste de la tête, Alan demanda à ses assistants de nous laisser. Il attendit que nous fussions seuls pour me parler franchement :
— Bon, on ne va pas tourner autour du pot, Raphaël. Si Copeland s’est donné tant de mal pour faire disparaître ces photos, c’est que non seulement il a eu une aventure avec Joyce Carlyle, mais surtout qu’il est le père de Claire. Tout concorde : les dates de sa liaison supposée avec Joyce, le fait que la petite soit métisse…
— J’y ai pensé, bien sûr, c’est une possibilité.
— Ce qui me surprend, en revanche, c’est que vous m’assuriez que Florence enquêtait sur Joyce et Copeland peu de temps avant sa mort.
— Pourquoi ?
— Florence et moi pensions la même chose à propos de la vie privée des hommes politiques : elle ne nous intéressait pas. Nous considérions que le journalisme actuel était justement en train de crever à cause de ce voyeurisme hypocrite. Je me fous de savoir que le prochain président des États-Unis a peut-être eu une aventure extraconjugale il y a plus de vingt ans. ça ne le disqualifie pas à mes yeux pour diriger le pays.
— Attendez, Alan, vous n’y êtes pas : je pense que c’est Joyce elle-même qui, à l’époque, avait l’intention de révéler que Copeland, le nouveau gouverneur de Pennsylvanie, était le père de sa fille.
— Si elle voulait de la publicité, pourquoi avoir attendu si longtemps ?
— Parce que sa fille venait d’être enlevée et que l’enquête piétinait. C’est en tout cas ce que j’aurais fait à sa place : médiatiser l’affaire à outrance dans l’espoir que l’on retrouve ma fille.
Le silence se fit dans la pièce.
— Qu’est-ce que vous êtes en train d’essayer de me dire, Raphaël ?
— Que Tad Copeland a sans doute tué, ou fait tuer, son ancienne maîtresse.
Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée…
Respires-en sur moi l’odorant souvenir.
Marceline DESBORDES-VALMORE
1.
Midwest
Le soleil tirait ses derniers feux lorsque Caradec arriva chez la veuve Kowalkowsky.
Le bâtiment principal était une maison trapue qui s’élevait sur deux étages. Une ferme typique du Midwest comme il en avait vu des centaines en remontant de Columbus jusqu’à Fort Wayne. Mais ce que Marc n’avait pas vu ailleurs et qui faisait la singularité de la propriété, c’était la grange. Un hangar à grain à la façade cramoisie et au toit blanc en forme d’ogive dont la silhouette imposante se détachait dans le ciel embrasé.
Marc s’avança vers la maison, les yeux fixés sur le porche à la peinture écaillée qui se prolongeait tout le long de la façade. Il grimpa les quatre marches qui menaient à l’entrée. Sans doute à cause de la chaleur, la porte était ouverte sur une moustiquaire qui battait dans le vent tiède. Marc écarta le rideau de gaze et annonça sa présence :
— Madame Kowalkowsky !
Il tambourina contre la vitre et, après avoir attendu une minute, il se décida à pénétrer dans la maison.
L’entrée donnait directement dans le salon, une pièce qui respirait l’abandon : murs décrépits, papier peint décollé, tapis élimé, meubles rafistolés.
Recroquevillée sur un canapé en tissu vert amande, une femme dormait. À ses pieds, le cadavre d’une demi-flasque de gin bon marché.
Marc soupira et s’approcha d’Helen Kowalkowsky. À cause de sa position, il ne parvenait pas à voir son visage. Mais peu importait son visage. Cette femme, c’était lui. Une déclinaison de lui : un être brisé par le chagrin qui n’arrivait plus à émerger du plus profond de la nuit.
— Madame Kowalkowsky, chuchota-t-il en lui secouant doucement l’épaule.
Il fallut plusieurs minutes à la propriétaire des lieux pour se réveiller. Elle le fit avec lassitude, sans sursaut ni stupeur. Elle était ailleurs. Sur un territoire que rien ne pouvait atteindre.
— Je suis désolé de vous déranger, madame.
— Qui êtes-vous ? demanda-t-elle en essayant de se mettre debout. Je vous préviens, il n’y a rien à voler ici, même pas ma vie.
— Je suis le contraire d’un voleur. Je suis policier.
— Vous venez m’arrêter ?
Non, madame. Pourquoi viendrais-je vous arrêter ?
Helen Kowalkowsky chancela et retomba dans son canapé. Dire qu’elle n’était pas dans son état normal était un euphémisme. Ivre sans doute. Peut-être même un peu stone. Malgré son apparence actuelle — elle n’avait plus que la peau sur les os, son visage était décharné et marqué de cernes grisâtres —, on devinait la jolie fille qu’elle avait été autrefois : une silhouette longiligne, des cheveux cendrés, des yeux clairs.
— Je vais vous préparer du thé, ça vous fera du bien, d’accord ? proposa Caradec.
Pas de réponse. Le flic était décontenancé par son face-à-face avec ce spectre. Mais comme il se méfiait du réveil des fantômes et ne voulait pas se laisser surprendre, il vérifia qu’il n’y avait pas d’armes visibles dans le salon avant de passer dans la cuisine.
C’était une pièce aux vitres tachetées qui donnaient sur un champ envahi d’herbes hautes. La vaisselle s’accumulait dans l’évier. Le frigo était presque vide à l’exception d’une boîte d’œufs et du compartiment congélateur qui était garni de flasques de gin. Sur la table, des tubes de médicaments : Valium, somnifères et compagnie. Marc soupira. Il était en terrain connu. Depuis longtemps, lui-même arpentait ce no man’s land — le véritable enfer sur terre — où transitaient ceux qui ne supportaient plus la vie, mais qui, pour des raisons diverses, n’étaient pas résolus à la quitter tout à fait.
Il mit de l’eau à chauffer et prépara une infusion avec ce qu’il avait sous la main : du citron, du miel, de la cannelle.
Lorsque Marc revint dans le salon, Helen était toujours assise sur le canapé. Marc lui tendit la tasse de citron chaud. Il ouvrit la bouche puis se ravisa. Expliquer à cette femme ce qu’il faisait chez elle lui apparut pour l’instant comme une tâche insurmontable. Helen avait trempé ses lèvres dans la tasse et buvait l’infusion par gorgées minuscules. Les yeux vides, le dos voûté, entre accablement et lassitude, elle était à l’image de la maison : fanée, figée, desséchée. Caradec pensa aux modèles torturés du peintre Egon Schiele, à leurs visages maladifs, à leur couleur de peau jaunâtre qui en faisait des êtres plus morts que vivants.
Читать дальше