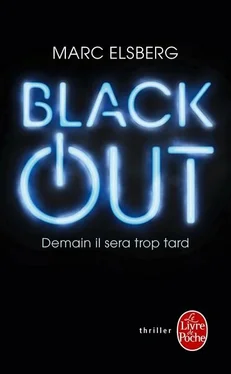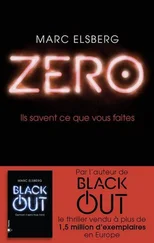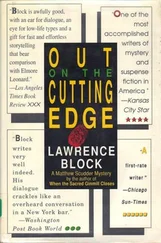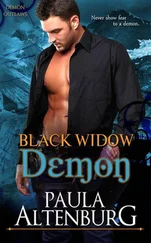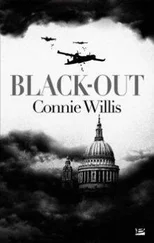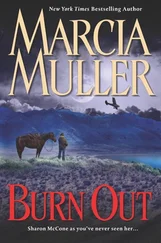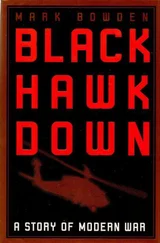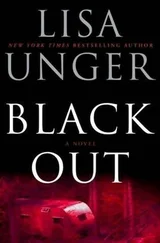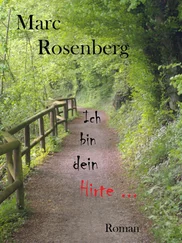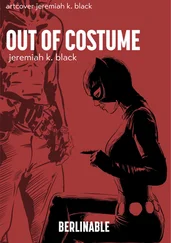Il le tira par la manche.
Une ferme dans les environs de Dornbirn
« Ah ! Que c’est bon ! »
Terbanten était collée au poêle en faïence de la cuisine de la ferme. Angström et les autres étaient installées à la grande et vieille table, mangeant ce que la fermière y avait déposé. Du pain noir, du beurre, du fromage, du lard. Et un verre de lait frais. Toutes se servaient copieusement, seule van Kaalden ne toucha pas au lait encore chaud, comme le remarqua Angström. Elle-même avait du mal à tenir le verre. Elles devisaient avec les habitants du lieu et les personnes venues leur prêter main-forte, elles s’amusaient de leur maladresse à traire, le paysan mimait leurs gestes engourdis et en riait aux éclats. Elles réfléchissaient également à la suite de leur périple. Lorsque le voisin comprit qu’elles n’avaient pas suffisamment d’essence pour arriver à bon port, il leur demanda : « C’est encore loin ?
— Peut-être une heure, environ soixante kilomètres.
— Dix litres devraient suffire pour cette voiture. Mon réservoir est plein. Je peux t’en donner quelques litres. » Dès le début, il les avait tutoyées. Angström traduisit pour les autres et fit de la tête un oui enjoué.
« Bien volontiers ! On paye bien sûr.
— C’est bien comme ça que je voyais les choses, fit l’homme, sans sourciller. Quatre euros par litre. »
Angström avala de travers. C’était plus de deux fois le prix en vigueur. Elle échangea un regard avec Bondoni. Elles pensaient la même chose. Ne pas s’énerver maintenant. Offre et demande n’ont rien à voir avec justice ni éthique. Et puis, surtout, il leur fallait cette essence.
Barrage d’Ybbs-Persenbeug
Lentement et imperturbablement, le Danube suivait son cours à travers le paysage. Les champs des deux rives étaient blancs, figés, parfois on voyait une ferme, ailleurs des arbres sans feuilles sous un ciel sans couleur. Le mur du barrage de la centrale n’est que l’illusion d’un pouvoir humain, pensa Oberstätter. On peut ralentir le fleuve, l’obstruer, mais pas l’arrêter. Ni même le contrôler vraiment, ainsi que les crues des années passées l’avaient prouvé.
Il avait cessé de pleuvoir. Le regard d’Oberstätter suivait les méandres du fleuve tandis qu’il tirait une bouffée sur sa cigarette et qu’il pensait aux dernières vingt-quatre heures. Il n’était pas retourné chez lui, bien que l’équipe suivante soit arrivée. Ils avaient un peu dormi sur des lits de camp. Ils n’avaient cessé d’essayer de relancer la centrale. En permanence, des messages d’erreur les en avaient empêchés. Systématiquement, toute une équipe devait partir pour contrôler l’élément incriminé. Jamais personne n’avait décelé le moindre problème. Les pièces semblaient en état de fonctionner. Oberstätter écrasa sa cigarette dans le cendrier puis regagna la salle de contrôle.
« Ça doit venir des logiciels, fit-il au chef de quart.
— C’est aussi ce que je me suis dit, répondit-il. La question, c’est de savoir par où commencer. »
On utilise plusieurs programmes informatiques au sein d’une centrale. Les plus compliqués sont ceux du Supervisory Control and Data Acquisition, ou encore système SCADA. Ils servent à piloter la centrale et sont composés de différents éléments, des hardwares très spécifiques, comme les contrôleurs logiques programmables, jusqu’à des postes tout à fait communs tournant sous Windows. Les systèmes SCADA contrôlent les installations et les procédés techniques de plus en plus complexes du monde moderne. Qu’il s’agisse des process de fabrication industriels, de l’organisation d’infrastructures ou du management de ports, d’aéroports, de gares, de sièges d’entreprises, de centres commerciaux ou de stations spatiales. Ils permettent à une poignée d’hommes de piloter un pétrolier à travers les mers, à une usine automobile de ne tourner qu’avec une dizaine de salariés, à des millions de passagers d’atterrir et de décoller tous les jours dans les aéroports.
« Aucune idée. Les systèmes SCADA ont été entièrement testés durant la phase préparatoire de leur mise en service. Par ailleurs, nous n’y avons pas accès. Je commencerais plutôt par les ordinateurs tournant sous Windows. »
Le chef de quart regardait dans le hall des machines à travers les épaisses vitres. Oberstätter savait ce qu’il se passait dans sa tête. S’il se décidait à mettre fin aux tentatives de redémarrage jusqu’à ce que l’informatique ait été examinée, il pouvait s’écouler des jours avant que la centrale ne délivre de nouveau de l’énergie. En dernier recours, c’est l’exploitant qui prendrait la décision.
« Espérons que nous n’avons pas été infiltrés par Stuxnet, observa Oberstätter.
— Rigole pas avec ça.
— C’était pas une blague. »
Le ver avait attiré l’attention en automne 2010 après avoir infecté une centrale nucléaire iranienne.
« Quoi qu’il en soit, continuer ainsi n’a pas de sens…, fit soudain le supérieur d’Oberstätter. Nous arrêtons les tentatives de redémarrage. J’en informe la hiérarchie. »
Ratingen
Sur la vaste étendue du parking, il n’y avait que quelques voitures isolées, c’était tout de même beaucoup pour un samedi de février. De grandes surfaces étaient recouvertes d’une fine couche de neige. Les rafales de vent balayaient l’endroit, faisant tourbillonner des flocons blancs dans les airs et affleurer l’asphalte gris. Au milieu de ce paysage hivernal désolé, le cube étiré, haut de dix étages de verre et de béton, avait l’air un peu perdu. Au-dessus du bâtiment, l’enseigne en grandes lettres pointait vers le ciel gris : « Talaefer AG ». Quelques fenêtres étaient éclairées.
James Wickley gara son SLS Roadster sur la place marquée du numéro d’immatriculation de la voiture de fonction qu’il conduisait pendant la semaine, une imposante berline. Mais comme on était samedi, il s’autorisait à venir au siège au volant d’une voiture de sport qui coûtait plusieurs années du salaire d’un employé moyen de Talaefer AG.
Il sauta du véhicule, passa son manteau pour les quelques pas qui le séparaient de l’entrée. Il regarda son reflet dans la porte vitrée, une figure mince, une raie bien nette que même les rafales les plus violentes n’étaient pas parvenues à défaire.
Heureusement, la cave du bâtiment abritait des générateurs de secours alimentés au diesel, qui lui permirent d’utiliser l’ascenseur et de chauffer son bureau du dernier étage.
Il jeta son manteau sur une chaise et alluma son ordinateur. James Wickley, né à Bath, ayant grandi à Londres, Singapour et Washington en tant que fils de diplomate, formé à Cambridge et Harvard, depuis quatre ans P-DG de Talaefer AG, misait sur un boom futur, favorable à son business de systèmes de contrôle. Suite à la dérégulation du marché européen dans les dernières décennies, le prochain bouleversement était imminent. L’introduction de ce qu’on appelle les « smart grids » avait enflammé les imaginations dans les entreprises du monde entier, prêtes à saisir l’aubaine. L’idée fondamentale en était simple : jusqu’alors, les producteurs d’énergie, de grandes compagnies centralisées, faisaient du courant et le distribuaient aux consommateurs finaux via des réseaux internationaux qui s’étaient développés simultanément. Ce système fonctionnait encore, dans une certaine mesure. On pouvait évaluer les besoins énergétiques. Les centrales hydroélectriques, à charbon ou nucléaires livraient constamment de l’électricité ; pour les besoins fluctuants, comme aux heures de pointe, on avait plus particulièrement recours aux centrales thermiques, avant tout celles au gaz.
Читать дальше