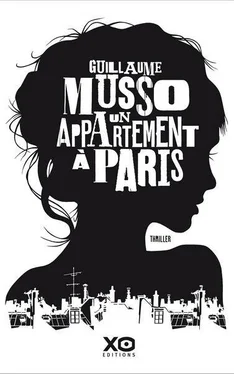— Vous aimez ?
Madeline sursauta en se retournant. Absorbée dans la contemplation des œuvres, elle n’avait pas entendu Bernard Benedick arriver.
— Je n’y connais rien, mais a priori ce n’est pas ma came.
— Et c’est quoi votre « came » au juste ? demanda le galeriste, amusé, en lui tendant une enveloppe qu’elle enfouit dans la poche de son jean.
— Matisse, Brancusi, Nicolas de Staël, Giacometti…
— Je vous accorde bien volontiers qu’on n’est pas ici au même niveau de génie, sourit-il en désignant notamment la forêt multicolore de sexes en érection. Vous allez rire, mais c’est ce que je vends le mieux en ce moment.
Madeline eut une moue dubitative.
— Vous avez des œuvres de Sean Lorenz ici ?
Jusqu’alors jovial, le visage de Benedick se ferma.
— Non, malheureusement. Lorenz était un artiste qui peignait peu. Ses œuvres sont presque introuvables aujourd’hui et valent des fortunes.
— Quand est-il mort exactement ?
— Il y a un an. Il avait à peine quarante-neuf ans.
— C’est jeune pour mourir.
Benedick acquiesça :
— Sean a toujours eu une santé fragile. Il souffrait de problèmes cardiaques depuis longtemps et avait déjà subi plusieurs pontages.
— Vous étiez son galeriste exclusif ?
L’homme grimaça tristement :
— J’ai été son premier galeriste, mais j’étais surtout son ami, même si on se fâchait souvent.
— Les toiles de Lorenz ressemblent à quoi ?
— À rien de connu justement ! s’exclama-t-il. Lorenz, c’est Lorenz !
— Mais encore ? insista Madeline.
Benedick s’anima :
— Sean était un peintre inclassable. Il n’appartenait à aucune école et n’était prisonnier d’aucune chapelle. Si vous cherchez une analogie avec le cinéma, disons qu’on peut le rapprocher de Stanley Kubrick : un artiste capable de créer des chefs-d’œuvre dans des genres très différents.
Madeline hocha la tête. Elle aurait dû partir, aller régler cette histoire avec son colocataire indésirable. Mais quelque chose la retenait ici ; elle avait vécu la découverte de la maison du peintre comme une telle rencontre qu’elle voulait en savoir davantage.
— C’est à vous qu’appartient l’atelier de Lorenz aujourd’hui ?
— Disons que j’essaie de le préserver des créanciers de Sean. Je suis son héritier et son exécuteur testamentaire.
— Ses créanciers ? Vous disiez que les œuvres de Lorenz étaient hors de prix.
— C’est le cas, mais son divorce lui avait coûté cher. Et il ne peignait plus depuis plusieurs années.
— Pourquoi ?
— À cause de sa maladie et de problèmes personnels.
— Quels problèmes ?
Benedick s’agaça :
— Vous êtes de la police ?
— Oui, justement, sourit Madeline.
— C’est-à-dire ? s’étonna-t-il.
— J’ai été flic pendant plusieurs années, expliqua la jeune femme. À la brigade criminelle de Manchester puis à New York.
— Vous enquêtiez sur quoi ?
Elle haussa les épaules.
— Les homicides, les enlèvements…
Benedick plissa les yeux, comme si une idée venait de lui traverser l’esprit. Il regarda sa montre puis désigna, à travers la vitre, le restaurant italien de l’autre côté de la rue dont la devanture noire et les lambrequins dorés rappelaient la voilure d’un bateau pirate.
— Vous aimez le saltimbocca ? demanda-t-il. J’ai un rendez-vous dans une heure, mais, si vous voulez en savoir plus sur Sean, je vous invite à déjeuner.
2.
Une brise tiède faisait frémir et onduler les branches d’un vieux tilleul planté au milieu de la cour intérieure. Assis sur la table de la terrasse, Gaspard Coutances savoura une gorgée de vin. Le gevrey-chambertin était délicieux : équilibré, intense, ample et souple en bouche avec des arômes fruités de cerise noire et de cassis.
Pourtant, le plaisir de la dégustation était gâché par l’incertitude qui pesait sur la location de la maison. Bon sang , ragea-t-il, il est impossible que je me laisse déloger par cette fille ! Il voulait écrire sa pièce de théâtre ici. Ce n’était même plus une question de principe, mais de nécessité. Pour une fois qu’il avait un coup de foudre, il se refusait à rendre les armes alors qu’il était dans son bon droit. Mais cette Madeline Greene avait l’air coriace. Elle avait insisté pour lui prêter son téléphone afin qu’il puisse appeler son agent. Bien qu’elle ne fût pas directement responsable de la situation, Karen s’était confondue en excuses et l’avait rappelé dix minutes plus tard, l’informant qu’elle lui avait réservé une suite au Bristol en attendant que les choses s’arrangent. Mais Gaspard avait refusé tout net et posé un ultimatum : c’était cette maison ou rien. Soit Karen trouvait une solution, soit elle pouvait dire adieu à leur collaboration. Généralement, ce type de menaces avait le pouvoir de transformer Karen en guerrière. Mais, cette fois, il craignait que ce ne soit pas suffisant.
Nouvelle gorgée de bourgogne. Chant des oiseaux. Douceur de l’air. Soleil d’hiver qui réchauffe le cœur. Gaspard ne put s’empêcher de sourire tant il y avait quelque chose de comique dans cette situation. Un homme et une femme qui, à cause d’une erreur informatique, se retrouvaient à louer la même maison pour Noël. Ça ressemblait à un début de pièce de théâtre. Pas aux trucs intellos et cyniques qu’il écrivait lui-même, mais à quelque chose de plus joyeux. Une de ces pièces des années 1960 et 1970 écrites par Barillet et Gredy qu’affectionnait son père et qui avaient fait les grandes heures du Théâtre Antoine ou des Bouffes-Parisiens.
Son père…
Ça ne manquait jamais. Chaque fois que Gaspard venait à Paris, les souvenirs de son enfance, des braises qu’il croyait éteintes, se ravivaient. Pour ne pas se brûler, Gaspard chassa cette image de son esprit avant qu’elle ne devienne trop douloureuse. Avec le temps, il avait appris qu’il valait mieux garder ce genre de souvenirs à distance. Question de survie.
Il se resservit du vin et, son verre à la main, quitta la terrasse pour déambuler dans le salon. Il fut d’abord attiré par la collection de 33 tours : des centaines de disques de jazz, soigneusement rangés et classés sur des étagères en chêne naturel. Il posa sur la platine un vinyle de Paul Bley dont il n’avait jamais entendu parler et, pendant un moment, se laissa porter par le son cristallin du piano en détaillant les cadres accrochés aux murs.
Il n’y avait ni dessins ni peintures, seulement des photos de famille en noir et blanc. Un homme, une femme, un petit garçon. L’homme, c’était Sean Lorenz. Gaspard le reconnut parce qu’il se souvenait d’avoir vu son portrait — pris par l’artiste anglaise Jane Bown — dans la nécrologie parue dans Le Monde en décembre dernier. L’original grand format de la photographie se trouvait devant lui : une haute silhouette, une stature imposante, un visage émacié en lame de couteau, un regard énigmatique qui semblait tour à tour inquiet et déterminé. La femme de Lorenz n’était présente que sur deux clichés. Ses poses ressemblaient à celles que prenaient Stephanie Seymour ou Christy Turlington sur les couvertures des magazines de mode il y a vingt-cinq ans. Une beauté des années 1990 : élancée, sensuelle, rayonnante. Mince sans être squelettique. Radieuse sans paraître inaccessible. Mais les photos les plus nombreuses étaient celles de Lorenz avec son fils. Le peintre était peut-être un homme austère, mais, quand il était avec son enfant — un blondinet à la bouille craquante et au regard pétillant —, sa morphologie se métamorphosait, comme si la joie de vivre du gamin déteignait sur le père. Derniers clichés de cette exposition familiale, deux tirages plutôt joyeux montraient Lorenz en train de peindre avec des enfants de cinq ou six ans, parmi lesquels on reconnaissait son fils, dans ce qui devait être une école ou un cours de peinture à destination des plus jeunes.
Читать дальше