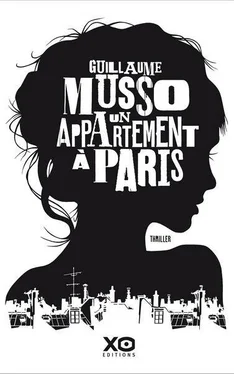Je m’appelle Bianca Sotomayor.
J’ai soixante-dix ans et, depuis cinq ans, je suis pensionnaire de l’enfer.
Croyez-en mon expérience : la véritable caractéristique de l’enfer, ce n’est pas les souffrances qu’on vous y fait subir. La souffrance est banale, inhérente à l’existence. Depuis sa naissance, l’être humain souffre partout, tout le temps, pour tout et pour rien. La véritable caractéristique de l’enfer, outre l’intensité de vos souffrances, c’est surtout que vous ne pouvez pas y mettre fin. Parce que vous n’avez même plus le pouvoir de vous ôter la vie.
Je ne vais pas vous retenir longtemps, je ne vais pas chercher à vous convaincre. D’abord parce que votre avis ne m’importe guère. Et puis parce que vous ne pouvez rien ni pour moi ni contre moi. Vous préférerez de toute façon écouter les souvenirs partiels et partiaux de ceux qui vous jureront le cœur sur la main qu’Adriano était un petit garçon calme et aimant et que nous, ses parents, étions des monstres.
Voici donc, pour moi, la seule vérité qui tienne : j’ai sincèrement essayé d’aimer mon fils, mais cela n’a jamais été une évidence. Même dans les premières années. La personnalité d’un enfant se discerne très vite. À quatre ou cinq ans, Adriano me faisait déjà peur. Ce n’est pas tant qu’il était turbulent, ingérable, colérique — il était tout cela —, c’était surtout qu’il était insaisissable et sournois. Personne n’avait de pouvoir sur lui. Ni moi, par mon amour, ni son père, par sa violence. Adriano ne voulait pas seulement de votre affection, il voulait vous soumettre sans rien vous donner. Il voulait vous asservir et rien ne pouvait le faire renoncer : ni mes sermons ni les coups de ceinture que nous donnait son père, à lui pour le mater, à moi pour me punir d’être la mère de ce rejeton raté. Même dans la souffrance, ses yeux me glaçaient : j’y voyais la cruauté et la rage d’un démon. Bien sûr, vous allez penser que tout cela n’existait que dans ma tête. Peut-être, mais cela m’était insupportable. Alors, dès que j’ai pu, je suis partie.
J’ai tourné la page. Vraiment. On n’a qu’une vie et je ne voulais pas passer la mienne en courbant constamment l’échine. Quel est le sens d’une existence réduite à un chapelet de tâches qui vous débectent ? Déambuler tous les jours dans une ville merdeuse qui empeste le poisson, avoir une vie conjugale qui se résume à prendre des roustes et à tailler des pipes pour assurer le repos du guerrier, être l’esclave d’un fils taré…
Je n’ai pas continué ma vie ailleurs, j’en ai véritablement recommencé une autre : un autre mari, un autre enfant — à qui je n’ai rien dit de son frère —, un autre pays, d’autres amis, un autre milieu professionnel. De ma première vie, j’ai tout brûlé, tout refoulé, sans aucun regret.
Je pourrais vous dire des choses qu’on lit dans les livres à propos de l’instinct maternel et des remords que j’aurais éprouvés. Je pourrais vous dire que mon cœur se serrait à chaque anniversaire de la naissance d’Adriano, mais ça ne serait pas la vérité.
Je n’ai jamais cherché à savoir ce qu’il était devenu. Je n’ai jamais tapé son nom sur Google et j’ai méthodiquement coupé tous les ponts avec ceux qui auraient pu me donner de ses nouvelles. J’étais sortie de sa vie et il était sorti de la mienne. Jusqu’à ce samedi de janvier où quelqu’un a sonné à ma porte. C’était la fin d’une belle journée. Le soleil déployait ses derniers rayons. À contre-jour, derrière la moustiquaire, j’ai distingué l’uniforme bleu marine d’un policier.
— Bonjour maman, m’a-t-il lancé dès que j’ai ouvert la porte.
Je ne l’avais pas vu depuis plus de trente ans, mais il n’avait pas changé. La même flamme malsaine brillait toujours au fond de ses yeux. Mais après toutes ces années, la flammèche était devenue brasier.
À cet instant-là, j’ai pensé qu’il était revenu pour me tuer.
J’étais loin d’imaginer que ce qui m’attendait était bien pire.
Nul n’a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé que pour sortir en fait de l’enfer.
Antonin ARTAUD
[32] Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société, Gallimard, 1990.
1.
Désemparée, Madeline luttait pour ne pas s’affaisser. Gaspard avait le regard dans le vide du boxeur sonné. Ils avaient quitté la masure après l’avoir fouillée de fond en comble une nouvelle fois. En vain. Déboussolés et fatigués, ils étaient revenus vers Tibberton et s’étaient garés sur le port. À cause du froid mordant qui les tétanisait, ils avaient vite abandonné leurs velléités de se dégourdir les jambes sur la jetée et avaient trouvé refuge dans le seul restaurant encore ouvert à 23 heures un soir de réveillon de Noël. The Old Fisherman était un pub local qui servait à une dizaine de convives, manifestement des habitués, des fish and chips et de la soupe aux palourdes accompagnée de pintes d’une lourde bière brune.
— Qu’est-ce qu’on peut faire de plus ? s’interrogea Gaspard.
Madeline l’ignora. Assise devant une clam chowder qu’elle n’avait pas touchée, elle s’était replongée dans l’analyse des mouvements financiers de Sotomayor. Pendant un bon quart d’heure, elle resta prostrée, à s’user les yeux sur des lignes de chiffres, avant d’admettre qu’elle ne trouverait rien qu’elle ne savait déjà. Ce n’est pas que son cerveau refusait de mouliner, c’est tout simplement qu’il n’y avait plus de grain à moudre. Plus de piste à suivre, plus de sillon à creuser.
L’espoir n’avait même pas duré une heure, mais il avait existé. À présent, en refaisant le film de ses erreurs, Madeline se reprochait de n’avoir pas suffisamment cru à cette histoire.
— Si j’avais été là lorsque Sean est venu me voir à New York, les choses auraient été différentes. Nous aurions gagné un an. Un an, vous vous rendez compte !
Derrière son plateau d’huîtres, Gaspard se sentit soudain coupable et chercha à la réconforter :
— Ça n’aurait rien changé.
— Bien sûr que si !
Elle avait vraiment l’air anéantie. Gaspard laissa passer un silence, puis se décida, et avoua :
— Non, Madeline, ça n’aurait rien changé, parce que Sean Lorenz n’est jamais venu vous voir à New York.
La jeune femme le regarda sans comprendre.
— Lorenz ignorait tout de votre existence, précisa-t-il.
Madeline fronça les sourcils. Elle était perdue.
— Vous m’avez montré cet article sur moi qu’il avait dans ses tiroirs.
Gaspard croisa les bras et affirma calmement :
— C’est moi qui ai téléchargé cet article sur Internet avant-hier. Et c’est moi qui l’ai annoté.
Une pause. Madeline convoqua ses souvenirs et balbutia :
— Vous… vous m’avez dit que mon numéro revenait plusieurs fois sur ses relevés téléphoniques.
— Là encore, c’est moi qui ai trafiqué grossièrement ces documents avec Karen. D’ailleurs, je me suis donné du mal pour rien, car vous n’avez jamais cherché à les vérifier.
Abasourdie, Madeline refusait d’accepter ce qu’elle prenait pour une énième provocation de Coutances.
— Lorenz est mort sur la 103 e Rue, à quelques pâtés de maisons de mon ancien bureau. C’est un fait acquis. Tous les médias du monde entier l’ont évoqué. Il était là parce qu’il voulait me rencontrer.
— Lorenz était là, c’est vrai, mais uniquement parce que le laboratoire Pelletier & Stockhausen se trouve à deux pas. Ce n’est pas vous qu’il venait voir, c’était Stockhausen.
Читать дальше