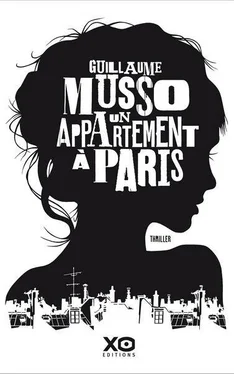— Pas du tout, le coupa-t-elle sèchement. À propos de la maison, je voulais vous prévenir : je vous la laisse. Je vais aller habiter ailleurs. Le propriétaire m’a proposé de me dédommager et je vais accepter son offre.
Il la regarda, surpris.
— Sage décision.
— Mais je vous demande de me donner deux jours pour m’organiser. En attendant, je dormirai à l’étage. Nous nous partageons la cuisine et vous pouvez disposer du reste de la maison.
— Ça me convient, approuva Gaspard.
Avec la lame du couteau, il fit glisser dans une poêle l’oignon qu’il venait d’émincer.
— Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?
Elle hésita un instant, puis lui balança la vérité :
— Je n’ai pas le courage de passer quatre semaines dans un endroit encore hanté par un enfant décédé.
— Vous parlez du petit Julian ?
Madeline confirma d’un hochement de tête. Dans le quart d’heure qui suivit, au fil d’une discussion animée, chacun raconta à l’autre ce qu’il avait appris sur la vie et l’œuvre fascinante de Sean Lorenz, et sur ses derniers tableaux disparus.
Après avoir refusé un verre de vin, Madeline ouvrit le frigo pour y prendre la trousse en plastique qu’elle avait laissée là quelques heures plus tôt. Puis elle prétexta une grande fatigue et monta se coucher.
2.
L’escalier de bois qui menait à l’antre de Lorenz débouchait directement dans l’atelier et sa verrière. La plus belle pièce de la maison se prolongeait par une chambre de taille modeste, mais confortable et agrémentée d’une salle de bains. Madeline rangea quelques affaires, trouva des draps propres dans une armoire et fit son lit. Puis elle se lava les mains et s’assit à un petit bureau en bois cérusé qui tournait le dos à la fenêtre. D’abord, elle enleva son pull et son chemisier. Elle sortit ensuite de sa trousse une fiole ainsi qu’une seringue qu’elle retira de son emballage. Elle fixa l’aiguille, en retira le capuchon, joua avec le piston de la seringue comme elle commençait à en avoir l’habitude pour prélever le produit en faisant remonter les bulles d’air avant de les expulser. Avec un coton imbibé d’alcool, elle nettoya sur son ventre la zone où elle avait prévu de se piquer. Le chauffage avait beau être allumé, tout son corps tremblait. Ses os lui faisaient mal, sa peau était hérissée de chair de poule. Elle prit une grande inspiration puis pinça un morceau de peau, insérant l’aiguille dans le gras, ni trop près du muscle ni trop près des côtes. Elle essaya de ne pas trembler pendant qu’elle poussait le piston pour injecter le produit. Ce truc brûlait, un véritable supplice. Bordel ! Lorsqu’elle était flic, elle s’était retrouvée dans des situations de danger absolu : un flingue sur la tempe, des balles qui lui avaient frôlé la nuque, des face-à-face avec la pire racaille de Manchester. Alors que chaque fois elle était parvenue à dominer sa peur, là, elle faisait sa chochotte pour une petite aiguille !
Madeline ferma les yeux. Nouvelle respiration. Compresse. Retrait de l’aiguille. Coton pour stopper le saignement.
Elle s’allongea sur son lit en tremblant. Comme ce matin à la gare, elle avait l’impression d’être à l’article de la mort. Elle avait la nausée, des crampes d’estomac, elle manquait d’air et une migraine lui vrillait le crâne. En grelottant, elle remonta sur elle la couverture. Derrière ses yeux clos, elle vit à nouveau les images du petit Julian, les couleurs de sang, la ville en flammes. Puis, comme à rebours, le tableau plus serein de la maternité. Et, peu à peu, elle se sentit moins mal. Son corps dégonfla. Comme elle ne parvenait pas à trouver le sommeil, elle se leva, s’aspergea le visage d’eau froide. Elle avait même faim. Les effluves gourmands du risotto à la truffe montaient jusque dans l’atelier.
Alors, elle ravala sa fierté et redescendit l’escalier pour rejoindre Gaspard dans le salon.
— Dites, Coutances, votre invitation à dîner, ça tient toujours ? Vous allez voir si j’ai une tête de mangeuse de quinoa…
3.
Contre toute attente, le repas fut joyeux et agréable. Deux ans plus tôt, à Broadway, Madeline avait assisté à une représentation de Ghost Town , une des pièces de Gaspard qui s’était jouée pendant deux mois au Barrymore Theatre avec Jeff Daniels et Rachel Weisz. Elle en gardait un souvenir en demi-teinte : des dialogues brillants, mais une vision cynique du monde qui l’avait mise mal à l’aise.
Heureusement, Coutances n’était pas le personnage persifleur et sarcastique que laissaient présager ses écrits. À vrai dire, c’était un ovni : une sorte de gentleman misanthrope et pessimiste, mais qui, le temps d’un dîner, pouvait se révéler un agréable compagnon. Presque naturellement, l’essentiel de leur conversation porta sur Sean Lorenz. Ils partagèrent leur enthousiasme neuf pour sa peinture et revinrent plus longuement sur les informations et les anecdotes que chacun avait glanées dans l’après-midi. Avec appétit, ils mangèrent jusqu’à la dernière bouchée de risotto et terminèrent une bouteille de saint-julien.
Après le repas, la discussion continua au salon. Dans la discothèque, Gaspard avait choisi un vieux vinyle d’Oscar Peterson, allumé une flambée dans la cheminée et découvert un Pappy van Winkle de vingt ans d’âge. Madeline avait retiré ses bottines, étendu ses pieds sur le canapé, posé un plaid sur ses épaules et sorti de sa poche une cigarette roulée à la main qui ne contenait pas que du tabac. Le mélange herbe et whisky alanguit les corps et détendit encore l’atmosphère. Jusqu’à ce que la conversation prenne un tour plus personnel.
— Vous avez des enfants, Coutances ?
La réponse fusa :
— Dieu merci, non ! Et je n’en aurai jamais.
— Pourquoi ?
— Je refuse d’infliger à quiconque le fracas du monde dans lequel nous sommes obligés de vivre.
Madeline tira une bouffée sur sa cigarette.
— Vous n’en faites pas un peu trop là ?
— Je ne trouve pas.
— Certaines choses vont mal, j’en conviens, mais…
— Certaines choses vont mal ? Mais ouvrez les yeux, bon sang ! La planète est à la dérive et l’avenir sera épouvantable : encore plus violent, plus irrespirable, plus angoissant. Il faut être sacrément égoïste pour vouloir infliger ça à quelqu’un.
Madeline chercha à lui répondre, mais Gaspard était lancé. Pendant un quart d’heure, les yeux fous, l’haleine chargée d’alcool, il dévida un argumentaire d’un pessimisme profond quant à l’avenir de l’humanité, décrivant une société apocalyptique, asservie à la technologie, à la surconsommation, à la pensée médiocre. Une société prédatrice qui, en se livrant à l’extermination méthodique de la nature, avait pris un billet sans retour pour le néant.
Elle attendit d’être certaine qu’il en avait terminé avec sa diatribe avant de constater :
— En fait, ce n’est pas juste les cons que vous détestez, c’est l’espèce humaine dans son ensemble.
Gaspard ne chercha pas à le nier :
— Vous connaissez le mot de Shakespeare : « Même la bête la plus féroce connaît la pitié. » [9] William Shakespeare, The Life and Death of Richard the Third, 1592.
Mais l’homme ne connaît pas de pitié. L’homme est le pire des prédateurs. L’homme est une vermine qui, sous couvert d’un vernis de civilisation, ne prend son pied qu’en dominant et en humiliant. Une espèce mégalomaniaque et suicidaire qui hait ses semblables parce qu’elle se déteste elle-même.
— Et vous, Coutances, vous êtes différent, bien sûr ?
— Non, bien au contraire. Vous pouvez m’inclure dans le lot si ça vous fait plaisir, lança-t-il en terminant sa dernière gorgée de whisky.
Читать дальше