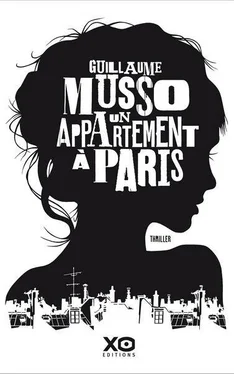La vie ne repasse pas les plats. Les occasions perdues le sont pour toujours. La vie ne fait pas de cadeau. La vie est un rouleau compresseur, un despote qui tient son royaume en y faisant régner la terreur par son bras armé : le Temps. Et le Temps gagne toujours à la fin. Le Temps est le plus grand exterminateur de l’histoire. Celui qu’aucun flic ne parviendra jamais à mettre sous les verrous.
3.
Gaspard se leva du canapé. Un téléphone portable — sans doute oublié par Madeline — venait de se mettre à vibrer sur le comptoir de la cuisine. Ayant toujours refusé de posséder l’un de ces appareils, il le regarda un instant avec méfiance, mais il se décida tout de même à prendre l’appel. C’était Madeline. Il commença une phrase pour lui répondre, mais interrompit par mégarde la conversation en effleurant l’écran au mauvais endroit.
Il lâcha un juron et fourra l’appareil dans sa poche.
Il soupira. Sa migraine s’était calmée, mais son esprit était encore embrouillé. Plus la peine de tergiverser : il lui fallait du café ! Et pas seulement une tasse.
Il s’empara d’un des grands crus qu’il avait achetés la veille et sortit de la maison pour aller retrouver sa voisine préférée.
Cette fois, Pauline Delatour répondit dès le premier carillon. Comme si c’était le printemps, elle portait à nouveau une tenue légère : un short en jean effilé et une chemise militaire kaki ouverte sur un débardeur.
— Un pinot noir contre un double expresso ? proposa-t-il en agitant sa bouteille.
Elle sourit et d’un signe de la main l’invita à entrer.
4.
Après ses examens médicaux, Madeline avait trouvé refuge rue du Faubourg-Saint-Honoré dans le confort rassurant de la Caravella, l’italien que lui avait fait connaître Bernard Benedick. La prise de sang nécessitant d’être à jeun, elle n’avait rien avalé depuis la veille et la tête commençait à lui tourner. Elle commanda un café au lait et des biscotti et s’apprêtait à appeler la clinique de fertilité lorsqu’elle s’aperçut qu’elle avait oublié son téléphone rue du Cherche-Midi.
Manquait plus que ça ! se désola-t-elle en frappant la table avec la paume de sa main.
— Un souci ? demanda le serveur en lui apportant son petit déjeuner.
Elle reconnut Grégory, le jeune patron que lui avait présenté la veille le galeriste.
— J’ai oublié mon portable et j’ai un appel important à passer.
— Je vous prête le mien ? proposa-t-il en sortant de sa poche un étui aux couleurs du Milan AC.
— Merci, c’est très gentil !
Elle appela Madrid et demanda à parler à Louisa. Au service de coordination de la clinique, elle avait sympathisé avec cette infirmière dont le frère était flic. Elle connaissait toujours ses horaires et, au besoin, l’appelait directement sur son portable pour éviter que la moitié de la Castille ne soit au courant de la taille de ses ovaires. Louisa nota les résultats qu’elle transmettrait à un médecin qui évaluerait la réponse ovarienne et, le cas échéant, modifierait la dose d’hormones à injecter. C’est sûr, on était loin du médecin de famille. On était dans une médecine 2.0, mondialisée, uberisée, un peu low cost et un peu triste. Mais s’il fallait passer par là pour avoir un enfant, elle était prête.
Madeline profita du téléphone de Grégory pour appeler son propre numéro. Heureusement, Coutances lui répondit :
— Gaspard, où êtes-vous ? Pouvez-vous me rapporter mon téléphone ?
Le dramaturge marmonna des propos incompréhensibles puis la communication se coupa. Comprenant qu’elle ne gagnerait rien à insister, Madeline composa plutôt un SMS : Pouvez-vous me rapporter mon téléphone ? Si ça vous convient, rendez-vous à midi au restaurant Le Grand Café de la rue Delambre. Je vous remercie. Maddie.
Comme son café était froid, elle en commanda un autre qu’elle avala d’un trait. Elle avait très mal dormi. Les toiles ensorcelantes de Lorenz avaient peuplé son sommeil. Toute la nuit, elle avait voyagé en songe dans des horizons aux couleurs intenses, des forêts sensuelles aux lianes vivantes, des falaises qui donnaient le vertige, des villes balayées par un vent brûlant. Au réveil, elle aurait été incapable de dire si cette longue divagation tenait du rêve ou du cauchemar. Mais elle commençait à comprendre que c’était justement dans cette ambivalence que résidait la clé de l’œuvre de Sean Lorenz.
Elle aperçut Bernard Benedick qui, de l’autre côté du trottoir, remontait son rideau de fer. Elle toqua contre la vitre du café pour lui signaler sa présence et, comme elle l’espérait, le galeriste ne fut pas long à venir la rejoindre.
— J’étais certain de vous revoir ! triompha-t-il en prenant place en face d’elle. On ne résiste pas à la peinture de Sean Lorenz, n’est-ce pas ?
Madeline lui répondit par un reproche :
— Vous ne m’aviez pas dit que le fils de Lorenz avait été assassiné.
— C’est vrai, admit-il d’une voix blanche, mais c’est parce que je déteste en parler. Julian était mon filleul. Ce drame nous a tous dévastés.
— Que s’est-il passé exactement ?
— Tout a été écrit dans les journaux, souffla-t-il.
— Justement. Ce qui est écrit dans les journaux est rarement la vérité.
Benedick considéra l’argument d’un hochement de tête.
— Pour bien comprendre les choses, soupira-t-il, il faut remonter longtemps en arrière. Très longtemps, même…
Il leva le bras pour commander à son tour un café et se donner du courage.
— Je vous l’ai déjà expliqué : dès ma rencontre avec Sean, j’ai mobilisé tout mon réseau pour faire connaître son travail et le mettre en lumière. Sean était ambitieux et avide de rencontres. Je l’ai mis en contact avec des personnes très différentes à Londres, Berlin, Hong Kong… Mais il y a un endroit dans lequel il ne voulait jamais mettre les pieds : New York.
— Je ne comprends pas.
— Chaque fois que je lui proposais de lui faire rencontrer des collectionneurs à Manhattan, il bottait en touche, expliqua Benedick. Si incroyable que ça puisse paraître, de 1992 à cette funeste année 2014, Sean Lorenz n’est jamais retourné dans sa ville natale.
— Il y avait encore de la famille ?
— Seulement sa mère, mais il l’a fait venir à Paris dès la fin des années 1990. Elle était déjà très malade à l’époque et elle est morte peu après.
Benedick trempa un crostini dans son café.
— Au bout d’un moment, à force d’insister, Sean n’a pas pu faire autrement que de me lâcher quelques bribes de vérité.
— Ça remontait aux circonstances de son départ ? demanda Madeline.
Le galeriste approuva de la tête.
— À l’automne 1992, après son « été de l’amour » avec Pénélope, Sean s’était retrouvé seul à New York. Il déprimait et n’avait d’autre objectif que de rejoindre la jeune femme à Paris. Le hic, c’est qu’il n’avait pas un sou en poche. Pour trouver de quoi s’acheter un billet d’avion, il s’est mis à commettre de petits larcins avec la complicité de LadyBird .
— L’élément féminin des Artificiers , se souvint Madeline.
— De son vrai nom Beatriz Muñoz. C’était la fille d’immigrés chiliens qui trimaient dans les usines du North Bronx. Une drôle de femme, renfermée, sauvage, presque autiste, emmurée dans un physique de catcheur. Il ne faisait aucun doute qu’elle était amoureuse de Sean et qu’elle se serait jetée par la fenêtre s’il le lui avait demandé.
— Vous pensez qu’il en a abusé ?
Читать дальше