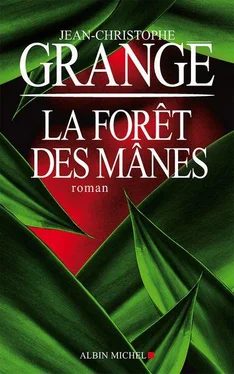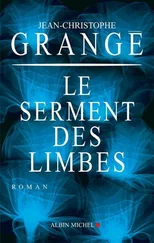Jean-Christophe Grangé - La Forêt des Mânes
Здесь есть возможность читать онлайн «Jean-Christophe Grangé - La Forêt des Mânes» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2009, ISBN: 2009, Издательство: Éditions Albin Michel, Жанр: Триллер, Ужасы и Мистика, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Forêt des Mânes
- Автор:
- Издательство:Éditions Albin Michel
- Жанр:
- Год:2009
- Город:Paris
- ISBN:978-2226194008
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Forêt des Mânes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Forêt des Mânes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La Forêt des Mânes — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Forêt des Mânes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Pour ne rien arranger, conclut Arias, Plasma Inc. exporte ses stocks aux États-Unis. Ce qui revient plus ou moins à pactiser avec le diable.
Jeanne leva les yeux. Cette dernière phrase éveilla en elle une réminiscence :
— Niels Agosto avait déjà été agressé par des fanatiques d’extrême droite. Selon vous, ce sont les mêmes qui ont frappé ce soir ?
Eva ignora la question :
— Parlez-moi de vos agresseurs. Étaient-ils tatoués ?
— Au moins un, oui. Celui qui m’a tenu en respect.
— Quel tatouage ?
— Un serpent. Sur le bras.
— C’est la signature des gangs. Les maras.
Jeanne connaissait le nom. Les maras étaient des gangs aux pratiques brutales et sanguinaires apparus en Amérique centrale à la fin des guerres civiles. Les plus célèbres étaient les maras du Salvador : la mara 18 et la mara Salvatrucha. Les bandes se livraient une guerre sans merci. Leurs différents membres s’exprimaient à travers leurs tatouages, leurs habitudes vestimentaires, des gestes spécifiques.
— Je croyais que les maras se trouvaient surtout au Salvador.
— Au Guatemala, aussi. Et maintenant, chez nous.
Jeanne se souvint d’une anecdote. Au Salvador, le gouvernement avait pratiqué un gigantesque coup de filet. La police avait arrêté près de 100 000 jeunes tatoués pour n’en garder que… 5 %. Les bavures avaient été innombrables. Des sourds-muets, utilisant le langage des signes, avaient été emprisonnés par erreur.
— Le tatouage joue un rôle important pour eux, continua Eva Arias. Une sorte de langage symbolique.
— Que signifie le serpent ?
— Aucune idée. On dit qu’à chaque tatouage, correspond un meurtre. Ou une peine de prison. On ne sait pas trop. Certains tatouages désignent des grades. Comme en Russie ou au Japon.
— Quel rapport avec le sang ?
— Certains gangs d’origine guatémaltèque croient à la pureté de notre race. Ce qui est ridicule. Depuis quatre siècles, la population d’Amérique centrale est fondée sur le croisement du sang indien et du sang espagnol.
— Mais ces gangs d’extrême droite, vous les connaissez ?
— Souvent, ce sont d’anciens militaires d’élite, engagés par les cartels mexicains pour faire passer la drogue entre les deux continents américains. Pas précisément des êtres purs. Pourtant, ils ont cette obsession de la race, de l’origine des peuples. De vrais nazis.
Jeanne se leva et se posta près de la magistrate. La géante dégageait une fraîcheur bienfaisante. Un peu comme les statues de marbre de Rome, qui semblent retenir le froid de leurs origines, même en plein soleil.
— Quand l’agresseur a poignardé Agosto, reprit-elle, il a murmuré des phrases incompréhensibles.
— Quelles phrases ?
— Il a parlé d’un homme de glaise. D’un homme de bois. D’un homme de maïs. Il avait l’air de s’acharner sur sa victime au nom de ces hommes. Ça vous dit quelque chose ?
La magistrate écrasa sa canette d’une main. La balança dans la poubelle. Au fond du parc, les flics tendaient des rubans jaunes où était inscrit : « PRECAUCIÔN. »Leurs gestes paraissaient épuisés. La couleur de leur uniforme aussi. Ils faisaient corps avec le crime, la poussière, la lassitude.
— Bien sûr, répondit enfin Eva. Tout ça, c’est la faute aux Mayas.
— Pourquoi les Mayas ?
— Allez signer votre déposition au poste. Je passe vous chercher dans une heure.
— Pour aller où ?
— Chez moi. Dîner entre filles.
48
La villa d’Eva Arias ressemblait à celle d’Eduardo Manzarena. En plus modeste. C’était le même assemblage de terrasses et de vérandas qui s’immisçaient dans le plan même du jardin, ouvrant la maison aux feuillages, à l’air brûlant, à la nuit traversée de moustiques… L’autre différence était que la baraque grouillait d’enfants. On les lui avait présentés : Laetizia, neuf ans, Anton, sept ans, Manuela, treize ans, Minor, quatre ans… Eva avait conduit la troupe vers la cuisine et promis de revenir dans quelques minutes.
Debout dans le salon, Jeanne contemplait les portraits photographiques posés sur une commode de bambou. Eva Arias brandissant une mitraillette, vêtue d’un treillis, en pleine jungle. Eva Arias, toujours en costume militaire, embrassant un autre guérillero aux allures de Che Guevara. Eva Arias recevant son diplôme de juge…
Jeanne enviait cette existence, sous le signe de l’amour et de la révolution. Eva était une vraie guérillera qui avait combattu à la fois pour son pays et son destin de femme. Tout cela réchauffait le cœur de Jeanne. Sans compter la rumeur des enfants, à quelques mètres de là. Après l’enfer du pavillon 34, elle était au paradis…
Surtout, elle était vivante. Encore une fois, elle avait échappé au pire. Ces contacts répétés avec la mort comportaient un avantage. Ils redoraient le blason de chaque seconde. Renforçaient la saveur de chaque minute. Jeanne sentait un fourmillement précieux dans ses artères. Chaque sensation lui paraissait merveilleuse. Inestimable.
— J’aimerais vous dire que c’était le bon temps. Mais je n’en suis pas si sûre…
Eva Arias était revenue dans le salon. Jeanne tenait une photo la représentant bras levés, dans la liesse générale, assise sur un tank.
— Tout de même, la révolution, l’amour…
— Il fallait voir d’où nous sortions. La dictature. La répression. La violence. On ne peut souhaiter à personne de vivre sous le joug d’un Somoza. Moi, par exemple, j’y ai perdu toute ma famille.
Jeanne reposa le cadre.
— Somoza, qu’est-il devenu ?
— Il a fui au Paraguay, en 1978. Le président, Alfredo Stroessner, était un de ses amis. Il l’a protégé contre nos tentatives d’assassinat. Pas jusqu’au bout. En un sens, sa fin est presque drôle.
— Pourquoi drôle ?
— Somoza avait un défaut — en dehors des autres, j’entends —, c’était un homme à femmes. Quand il a commencé à draguer l’épouse de Stroessner, le président n’a pas apprécié. Il a ouvert ses frontières aux sandinistes, qui ont tué Somoza à coups de lance-roquette. Comme on dit chez vous : « Cherchez la femme. »
Jeanne saisit une autre photo — Eva et son « Che », en costume de mariage.
— Mon mari, Alberto. Mort il y a deux ans. Cancer.
— Je suis désolée.
— A l’époque de la révolution, nous nous croyions immortels, invincibles. Depuis, nous n’avons pas cessé d’atterrir. La politique, la maladie, la corruption, toutes les vicissitudes de la nature humaine nous ont rattrapés…
— Vous avez l’air de vous aimer… très fort.
— Oui. Mais Alberto aimait plus encore la révolution, la politique. Il était, au sens le plus dur, un héros.
— Qu’est-ce que vous entendez par « dur » ?
— Vous n’avez pas lu les Mémoires de Henry Kissinger ?
— Non.
— Quand il parlait de son alter ego vietnamien, Lê Duc Tho, avec qui il avait tenté de négocier la paix au Vietnam, il disait :
« Lê Duc Tho était de la trempe des héros. Ce que nous avions du mal à concevoir, c’est que ces héros sont faits de volonté monomaniaque. Ce sont rarement des hommes plaisants : leur intransigeance confine au fanatisme, et ils ne cultivent pas en eux les qualités requises pour négocier la paix. » Alberto était de ce genre-là.
Eva avait prononcé la citation en anglais et conclu en espagnol. Elle revint sur l’enquête, sans prendre la peine d’annoncer son virage :
— Nous avons retrouvé les gardes du corps et les domestiques de Manzarena.
— Ils savent quelque chose ?
— Non. Ils n’étaient plus là quand le meurtre s’est produit.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Forêt des Mânes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Forêt des Mânes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Forêt des Mânes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.