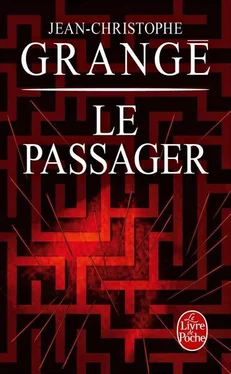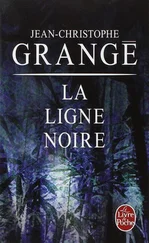— En novembre, nous descendons les vins en barrique. Nous faisons alors un peu de fermentation malolactique. L’élevage en barrique dure environ 12 à 13 mois…
Anaïs frissonna encore. Cette sensation lui fit penser à ses bras — et à ses cicatrices. Elle avait toujours l’impression qu’ils étaient nus, exhibés, grelottants. Aucun tissu, aucune matière ne pouvait atténuer ce froid-là. Il venait de l’intérieur .
— Nous ne cherchons pas ici à faire des vins surboisés. Notre objectif, c’est un vin bien équilibré, entre le fruité, l’acidité et l’alcool. Ce sont des vins ronds, agréables, et qui surtout possèdent de la fraîcheur…
Anaïs n’était plus là. Elle était au fond de son corps. Au fond de sa souffrance. Malgré elle, elle se tenait les bras et pensait déjà au pire. Je ne tiendrai jamais… Ses jambes tremblaient. Son corps vibrait. En même temps, elle se sentait pétrifiée. Durant ses crises d’angoisse, elle pouvait s’écrouler par terre ou sur un banc et ne plus bouger durant des heures. C’était une paralysie. Un étau de terreur qui la maintenait dans un bain de glace.
— Nous allons déguster aujourd’hui notre millésime 2005, une grande année en Médoc. Nous n’aurons aujourd’hui qu’un aperçu de ce que sera, dans quelques années, ce millésime. Pour tout dire, cette dégustation est prématurée. Nous avons fait un prélèvement sur barrique et…
Le groupe plongeait maintenant dans les caves du château. Face à l’escalier, elle hésita puis se décida à suivre le mouvement. Avec effort, elle réussit à descendre les marches. Odeurs de moisissure. Travail intime de la fermentation. Anaïs aimait le vin, mais le vin lui faisait toujours penser à son père. Dans ce domaine, il lui avait tout appris. À goûter. À déguster. À collectionner. Quand le voile s’était déchiré, elle aurait dû renoncer à tout ce qui touchait, de près ou de loin, à son mentor. Mais justement, non. Il lui avait tout volé. Il ne lui volerait pas ça.
— Encore une fois, il est un peu tôt pour déguster…
Soudain, Anaïs tourna les talons et abandonna le cortège. Elle remonta l’escalier, trébuchant plusieurs fois. Se frottant toujours les bras, elle courut à travers la salle des cuves. Sortir. Respirer. Hurler. Son reflet passait sur les parois bombées, difforme, horrible. Elle sentait monter les souvenirs. Le raz de marée d’atrocités qui allait exploser au fond de sa tête. Comme chaque fois.
Il fallait qu’elle atteigne la cour, la nuit, le ciel.
Le parvis du château était désert. Ralentissant le pas, elle dépassa les bâtiments des chais et s’orienta vers les vignobles. Tout était bleu. La terre et le ciel avaient pris des couleurs lunaires. Les graves ressemblaient à des allées de cendre, sur lesquelles se crispaient les pieds de vigne.
LE VIN…
LE PÈRE…
Ses lèvres crachaient de la vapeur, fusionnant avec la gaze argentée qui montait de la terre. Les coteaux ici descendaient vers l’estuaire de la Gironde. Elle suivit la pente. Elle sentait les cailloux rouler sous ses bottes. Les branches et les tuteurs lui griffer les jeans, comme s’ils lui voulaient du mal.
LE VIN…
LE PÈRE…
Elle s’enfonça encore parmi les plants et lâcha, enfin, la bride aux souvenirs. Jusqu’à la fin de son adolescence, elle n’avait eu qu’un seul homme dans sa vie. Son père. Ce qui était normal pour une gosse qui avait perdu sa mère à huit ans. Ce qui l’était moins, c’était que son père lui-même n’avait qu’une femme — sa fille. Ils formaient à eux deux un couple parfait, platonique, fusionnel.
Le père modèle . C’était lui qui lui faisait répéter ses devoirs. Lui qui allait la chercher au centre équestre. Lui qui l’emmenait à la plage de Soulac-sur-Mer. Lui qui lui parlait de sa mère chilienne, éteinte dans sa clinique comme une fleur étouffée dans une serre. Il était toujours là. Toujours présent. Toujours parfait…
Parfois, Anaïs éprouvait un malaise. Inexplicable. Des crises d’angoisse la submergeaient. Des vagues de terreur la saisissaient alors qu’elle se trouvait auprès de son père. Comme si son corps savait quelque chose qui échappait à sa conscience. Quoi ?
Elle eut la réponse le 22 mai 2002.
En première page de Sud-Ouest .
L’article s’intitulait : « Un tortionnaire dans nos cépages ». Curieusement, il avait été rédigé par un journaliste TV. L’homme venait de visionner un documentaire programmé sur Arte, portant sur le rôle des militaires français dans les dictatures sud-américaines des années 70. Parmi ces formateurs, il y avait eu aussi des activistes d’extrême droite, des anciens de l’OAS, des ex-barbouzes du SAC. D’autres Français avaient participé directement à la répression. Au Chili, un œnologue réputé avait joué un rôle prépondérant dans les activités des escadrons de la mort. L’homme ne s’était jamais caché. Jean-Claude Chatelet, originaire d’Aquitaine. Spécialiste du vin le jour. Spécialiste du sang la nuit.
Dès la parution de l’article, le téléphone de la maison n’avait plus arrêté de sonner. La nouvelle s’était répandue comme une flaque d’essence embrasée. À la fac, on murmurait sur son passage. Dans les rues, on la suivait du regard. Le documentaire était passé sur Arte. La vérité avait explosé. Le film montrait un portrait de son père, plus jeune, moins beau que celui qu’elle connaissait. « Un personnage clé dans la pratique de la torture à Santiago ». Des témoins évoquaient sa silhouette svelte, ses cheveux déjà argentés, ses yeux clairs — et sa fameuse claudication, reconnaissable entre toutes. Jean-Claude Chatelet avait toujours boité, reliquat d’un accident équestre dans son enfance.
Les torturés évoquaient sa voix douce — et ses pratiques terrifiantes. Décharges électriques, mutilations, énucléations, injections d’huile de camphre… « Le Boiteux » (« El Cojo »), c’était son surnom, était connu pour une spécialité : il éliminait les prisonniers inutiles en leur enfonçant un serpent vivant dans la gorge. D’autres témoins, des militaires, expliquaient comment Chatelet, jeune disciple du général Aussaresses, en poste en Argentine, avait beaucoup fait pour la formation des équipes…
Anaïs avait regardé l’émission chez une amie. Abasourdie. Elle avait perdu sa voix ce soir-là. Les jours suivants, les articles s’étaient multipliés dans la presse locale. Face aux attaques, son père s’était réfugié dans le silence et l’eau bénite — il avait toujours été catholique pratiquant. Anaïs, en état de choc, avait fait ses valises. Elle avait 21 ans et disposait d’un capital hérité de sa mère — des terres vendues au Chili dont les bénéfices placés lui revenaient exclusivement.
Elle s’était installée dans un deux-pièces de la rue Fondaudège, artère commerçante du centre-ville, et n’avait jamais revu son père. Elle ne cessait de penser aux paroles des témoins qui décrivaient le Boiteux. Ses mots. Ses gestes. Ses mains.
Ces mains qui avaient appliqué la pointe électrique de la picana . Qui avaient coupé, sectionné, mutilé des chairs. C’étaient ces mains-là qui l’avaient lavée lorsqu’elle était bébé. Qui l’avaient guidée jusqu’à l’école. Qui l’avaient protégée envers et contre tout.
Au fond, elle l’avait toujours pressenti. Comme si sa propre mère, murée dans sa folie, lui avait chuchoté mentalement son secret : elle avait épousé le diable. Et maintenant, Anaïs était la fille de ce diable. Son sang était maudit.
Peu à peu, elle avait récupéré sa voix — et retrouvé une vie normale. Fac de droit. Licence. ENSOP. À la sortie de l’École des officiers de police, Anaïs avait demandé un mois de disponibilité. Elle était partie au Chili. Elle parlait couramment espagnol, cela aussi, ça coulait dans ses veines. Pour trouver les traces de son père, elle n’avait pas eu à courir beaucoup. Le Serpent était une célébrité à Santiago. En un mois, elle avait bouclé son enquête. Elle avait regroupé les pièces, les témoignages, les photos. De quoi faire extrader son père de la France au Chili. Ou au moins enrichir les plaintes des exilés chiliens en France.
Читать дальше