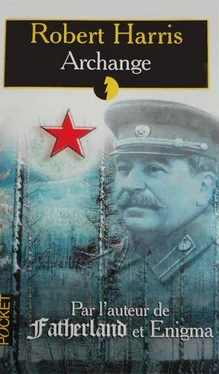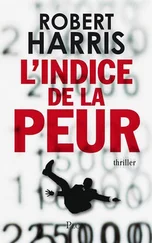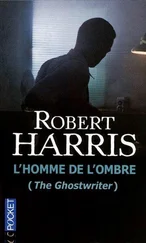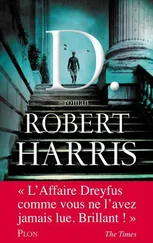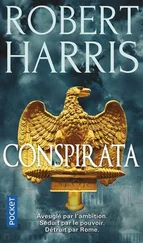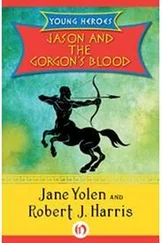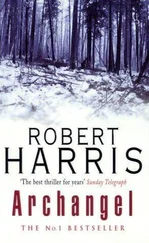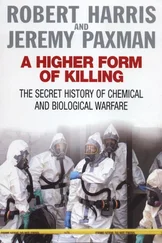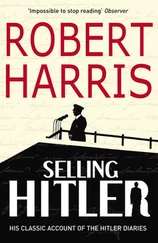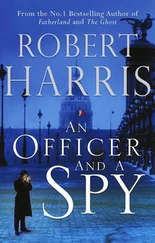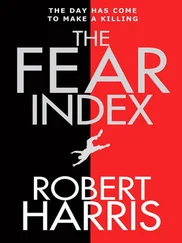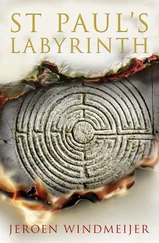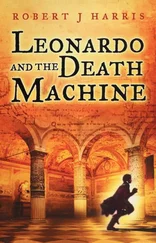Je ne suis pas en train de dire que Staline était fou. Au contraire. On pourrait même prétendre que l’homme qui faisait fonctionner le gramophone était la personne la plus sensée de la pièce. Quand Svetlana lui a demandé pourquoi sa tante Anna était détenue en isolement, il lui a répondu : « Parce qu’elle parle trop. » Avec Staline, il y avait généralement une logique derrière toute action. Il n’avait pas besoin d’un philosophe anglais du XVI e siècle pour savoir que « le savoir est pouvoir ». Cette notion est l’essence même du stalinisme. Elle explique entre autres pourquoi Staline a assassiné tant de ses proches parents et collègues : il voulait détruire quiconque le connaissait trop.
Et force nous est de constater que cette politique s’est révélée remarquablement efficace. Nous voici maintenant, quarante-cinq ans après la mort de Staline, rassemblés à Moscou pour discuter des archives nouvellement ouvertes de l’ère soviétique. Il y a au-dessus de nos têtes, dans des chambres fortes à l’épreuve du feu maintenues à une température constante de 18 °C avec un taux de 60 % d’humidité, un million et demi de dossiers : les archives complètes du Comité central du Parti communiste d’Union soviétique.
Et cependant, qu’est-ce que ces archives nous disent vraiment de Staline ? Que pouvons-nous voir aujourd’hui que nous ne pouvions pas voir quand les communistes étaient au pouvoir ? Les lettres de Staline à Molotov… nous pouvons les lire, et elles ne sont pas dépourvues d’intérêt. Mais elles ont été de toute évidence largement censurées. Et non seulement cela, mais elles s’arrêtent en 1936, précisément à l’époque où la grande tuerie a commencé.
Nous pouvons aussi consulter les listes d’exécutions signées par Staline. Et nous avons également ses agendas. Nous savons donc que le 8 décembre 1938 Staline a signé trente listes d’exécutions, soit un total de cinq mille arrêts de mort, beaucoup de ces noms étant ceux de prétendus amis à lui. Et nous savons aussi, grâce à son agenda, que ce même soir il s’est rendu dans la salle de projection du Kremlin pour regarder, pas un Tarzan cette fois-ci, mais une comédie intitulée Happy Guys.
Mais entre ces deux événements, entre les arrêts de mort et le rire, qui y a-t-il eu ? Ou quoi ? Nous ne le savons pas. Pourquoi ? Parce que Staline a fait en sorte d’assassiner pratiquement tous ceux qui auraient été en position de nous dire à quoi il ressemblait vraiment…
La nouvelle adresse de Mamantov se trouvait juste de l’autre côté de la Moskova, dans le grand complexe résidentiel de la rue Serafimovitch, connu sous le nom de « La Maison sur le Quai ». Il s’agissait en fait de l’immeuble où le camarade Staline, avec la générosité qui le caractérisait, avait insisté pour que les hauts dignitaires du Parti aillent vivre avec leur famille. Il y avait dix étages et vingt-cinq entrées distinctes au rez-de-chaussée ; devant chacune d’elles, le Guensec avait eu l’attention de poster un garde du NKVD — simplement pour votre sécurité, camarades.
À la fin des purges, six cents des locataires de l’immeuble avaient été liquidés. Les appartements étaient aujourd’hui privatisés, et les plus beaux, ceux qui donnaient sur la Moskova et le Kremlin, se vendaient plus d’un demi-million de dollars. Kelso se demanda comment Mamantov pouvait se payer ça.
Il descendit les marches du pont et traversa la route. Devant l’entrée de l’escalier de Mamantov, une grosse Lada blanche était garée, vitres baissées, avec deux hommes à l’intérieur qui mâchaient du chewing-gum. L’un d’eux avait une vilaine cicatrice blanchâtre qui courait presque du coin de l’œil jusqu’au bord de la bouche. Ils regardèrent Kelso passer devant eux avec un intérêt non dissimulé.
À l’intérieur de l’immeuble, près de l’ascenseur, quelqu’un avait écrit en anglais, soigneusement, en majuscules et minuscules : Fuck Off, « Allez vous faire foutre ». Hommage au système scolaire russe, songea Kelso. Il sifflota nerveusement un air inventé. L’ascenseur s’éleva sans à-coups pour s’arrêter au neuvième étage, où Kelso fut accueilli par le martèlement distant d’une musique rock occidentale.
L’appartement de Mamantov était équipé d’une porte blindée, et un svastika rouge avait été peint à la bombe sur le métal. La peinture en était déjà vieille et passée, mais on n’avait visiblement jamais essayé de le faire disparaître. Une petite caméra de télévision isolée se trouvait fixée au mur, au-dessus de la porte.
Tout cela ne plaisait guère à Kelso — le dispositif de sécurité, les types qui attendaient dans la voiture —, et il crut un moment pouvoir sentir la terreur qui avait régné ici soixante ans plus tôt, comme si la sueur s’était infiltrée dans les murs de brique, les bruits de pas aussi, les coups à la porte, les adieux précipités, les sanglots, le silence. Il leva la main vers la sonnette. Quelle idée de s’installer ici.
Il appuya sur le bouton.
Après une longue attente, une vieille femme vint ouvrir la porte. M me Mamantova était telle qu’il se la rappelait : grande et forte, pas grosse mais solidement bâtie. Elle portait une blouse à fleurs informe et l’on aurait dit qu’elle venait de pleurer. Ses yeux rouges se posèrent sur lui brièvement, distraitement, mais elle s’écarta avant qu’il puisse ouvrir la bouche, laissant soudain apparaître Vladimir Mamantov dans le couloir obscur, vêtu comme s’il allait toujours au bureau — chemise blanche, cravate bleue, costume noir avec une petite étoile rouge épinglée au revers de la veste.
Il ne dit rien, mais tendit la main. Il avait une poignée de main à vous, broyer les doigts, forgée, disait-on, en pétrissant des balles de caoutchouc pendant les réunions du KGB. (On disait beaucoup de choses sur Mamantov : par exemple — et Kelso le répétait dans son livre — que lors de la fameuse réunion à la Loubianka, le soir du 20 août 1991, lorsque les instigateurs du coup d’État avaient pris conscience que c’était fichu, Mamantov avait proposé de se rendre en avion à la datcha que Gorbatchev avait à Foros, sur la mer Noire, pour tuer lui-même le président soviétique ; Mamantov avait nié, protestant que cette histoire n’était qu’une « provocation ».)
Un jeune homme en chemise noire portant un étui à pistolet en bandoulière apparut dans la pénombre, derrière Mamantov, qui, sans même se retourner, lui dit : « Ça va, Viktor. Je me charge de la situation. » Mamantov avait un visage de bureaucrate : des cheveux gris acier, des lunettes cerclées de fer et des joues tombantes évoquant celles d’un chien méfiant. Dans la rue, on aurait pu passer cent fois devant lui sans le remarquer. Mais il avait des yeux brillants, des yeux de fanatique, pensa Kelso : il imaginait très bien Eichmann ou quelque autre assassin bureaucrate nazi ayant ces yeux-là.
La vieille femme s’était mise à émettre une curieuse plainte de l’autre côté de l’appartement, et Mamantov pria Viktor de s’occuper d’elle.
« Vous faites donc partie de cette bande de voleurs, lança-t-il à Kelso.
— Quoi ?
— Le symposium. La Pravda a publié la liste des historiens étrangers invités à s’exprimer. Votre nom y était.
— Les historiens ne sont guère des voleurs, camarade Mamantov. Même les historiens étrangers.
— Vraiment ? Il n’y a rien de plus important pour une nation que son histoire. C’est la terre qui porte toute société. Et la nôtre nous a été volée, abîmée et salie par les calomnies de nos ennemis, au point que notre peuple ne sait plus où il en est. »
Читать дальше