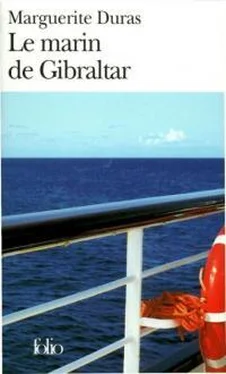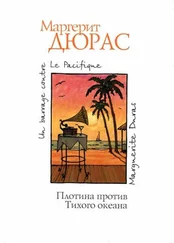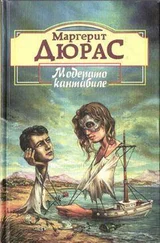— A quoi ça sert ? demanda-t-elle.
— A rien, dis-je. Rien ne sert à rien.
Epaminondas s'en alla, peut-être un peu vexé que je ne lui aie pas proposé de nous accompagner. Je descendis avec elle dans sa cabine et je l'aidai à s'habiller. Pour la première fois depuis que je la connaissais elle mit une robe d'été. Je me souviens de cette robe, en cotonnade verte et rouge. Et elle mit un chapeau, un peu petit pour contenir tous ses cheveux, qu'elle posa haut sur sa tête. Dessous son visage chavirait. Un peu celui d'une femme endormie les yeux entrouverts. Elle voulut descendre la passerelle toute seule. Mais elle n'y arriva pas, elle fut prise de peur et elle s'arrêta au milieu. Je la pris fortement sous le bras et je la conduisis. Je ne sais pas combien elle avait bu de whiskys, mais elle était vraiment très saoule. Lorsqu'elle était seule avec Epaminondas elle buvait sans arrêt. Dès qu'on fut à terre, elle voulut s'arrêter dans un café pour boire encore. Mais il n'y avait pas de café. Je le lui dis, et je la forçai à marcher. On remonta la rue transversale et on arriva sur le boulevard. Là, elle s'arrêta et voulut encore aller dans un café. Mais il n'y avait toujours pas de café. Alors elle dit qu'elle voulait s'asseoir sur un banc. Je ne le voulus pas parce que je craignais qu'une fois assise elle ne s'endormît. Elle résista. Elle fit le geste de s'asseoir et je la tirai si fort, et elle était tellement décidée à me résister que son chapeau tomba et que ses cheveux se dénouèrent complètement. Elle s'en aperçut à peine. Je ramassai le chapeau. Elle se remit à marcher, les cheveux dénoués. Les gens s'arrêtaient pour nous regarder passer. Elle ne s'en apercevait pas. Parfois elle était si lasse qu'elle fermait les yeux. Je ne l'avais jamais vue dans un pareil état. J'étais en nage. Mais j'avais beaucoup plus de force que tout à l'heure et je réussissais à la traîner. On mit peut-être une demi-heure pour atteindre le milieu du boulevard. La pente devint plus douce. Il était quatre heures de l'après-midi. Le vent s'était levé et retournait sur elle ses cheveux dénoués. Ils étaient longs et ils lui recouvraient le haut du ventre et les seins. Je la traînais si fort qu'on aurait pu croire que je la traînais dans un commissariat, ou qu'elle avait perdu la raison. Moi je la trouvais belle au-delà de ce que je pourrais jamais dire. J'étais aussi saoul qu'elle, de la regarder. Elle me répétait sans arrêt de la laisser tranquille.
— Laisse-moi.
Elle ne criait pas. Elle me le demandait avec une douceur constante, parfois mêlée d'une certaine surprise, parce que je m'obstinais à ne pas l'écouter.
— Il faut que tu marches, disais-je.
Je lui répétais qu'il le fallait sans lui dire pourquoi, le savais-je moi-même ? non, qu'il le fallait absolument. Sur le moment elle le croyait et, pendant quelques minutes, elle avançait ses pieds. Puis son ivresse reprenait le dessus et elle me redemandait une nouvelle fois de la laisser tranquille, tout en essayant de freiner ma marche. Alors je recommençais à la persuader qu'il fallait absolument qu'elle avançât. Pas une seule fois je ne désespérai d'arriver sur la place. Nous y arrivâmes. Elle aussi, elle s'assit machinalement à la première terrasse de café, celle où précisément une heure plus tôt je m'étais arrêté. Elle renversa la tête sur son fauteuil et resta ainsi, calme, les yeux fermés. Le garçon arriva. C'était le même que le matin. Il me reconnut et me dit bonjour. Il se planta devant nous et nous la regardâmes lui et moi. Il comprit, et me sourit gentiment.
— Une minute, dis-je.
Il s'éloigna. Je l'appelai doucement :
— Anna.
Elle ouvrit les yeux et je ramenai ses cheveux en arrière. Elle se laissa faire. Elle avait très chaud ; ses cheveux étaient collés sur son front.
— On va prendre une glace, dis-je.
Je rappelai le garçon qui, à quelques mètres de nous, ne cessait pas de nous lorgner avec curiosité. Je lui commandai deux glaces.
— Quel parfum ?
Cette question me fit rire. Il comprit encore.
— Vanille, dit-il. Ce sont les meilleures.
— Non, dit-elle, pas de glace.
Le garçon m'interrogea du regard.
— Deux glaces à la vanille, répétai-je.
Elle ne protesta pas. Elle regardait les passants. Il y en avait maintenant beaucoup. L'après-midi tirait vers sa fin. Mais les camions passaient toujours. Des cars aussi, à cette heure. Le garçon revint avec les glaces. Ce n'était pas une très bonne glace. Elle en prit une cuillerée, fit la grimace et la laissa. Puis elle me regarda manger la mienne avec une sorte de vague intérêt. Je la finis complètement. Il y eut un embouteillage sur le boulevard et la place fut remplie de camions et de cars arrêtés. Deux cars s'arrêtèrent devant le café, l'un plein de petites filles, l'autre, de petits garçons. Toutes les autos klaxonnèrent en même temps. Les petits garçons chantaient « Auprès de ma blonde » et les petites filles chantaient en même temps un chant anglais. Devant le car des petits garçons, il y en avait un autre, de vieilles Américaines qui regardaient, émues, le car des petits garçons. Le bruit était extraordinaire. Elle plissait les yeux, le supportait mal. Ne comprenait rien à ce qui se passait, et s'y résignait cependant un peu comme si je l'avais transportée du yacht, à cette terrasse, pendant qu'elle dormait. Son visage était toujours triste. Mais elle était moins saoule.
— Tu ne manges pas ta glace ?
— Elle n'est pas très bonne.
Elle fit une grimace en essayant de sourire.
— Il ne faut pas la laisser, dis-je, à cause du garçon.
Elle essaya encore puis, non, elle y renonça.
— Je ne peux pas.
Il passait pas mal de marins et de soldats de toutes nationalités. Ils marchaient deux par deux. Devant le café, ils ralentissaient le pas et regardaient cette femme aux cheveux dénoués, d'un air effaré et stupide.
— Tu vas boire un café, un bon café, dis-je.
— Pourquoi un café ?
— Un bon café, ça fait du bien.
A quelques mètres de nous se tenait le garçon, toujours planté face au port, mais qui ne cessait pas de nous regarder. Je lui commandai le café.
— Pourquoi ? dit-elle encore.
Le garçon apporta un café. Il n'était pas très bon, à peine chaud. Elle le goûta et dit sur le ton de la plus grande détresse, prête à pleurer :
— Dans ce café, tout est mauvais. La glace ne valait rien.
Je lui pris la main et lui expliquai :
— C'est comme ça, dans toute la ville. Quand, dans un café, les glaces sont mauvaises, elles sont mauvaises dans toute la ville, dans tous les cafés de la ville. Tous les cafés se fournissent au même glacier.
— Et pour le café ?
— Pour le café, dis-je, c'est différent. Si tu veux, on peut commander un filtre.
— Oh non, dit-elle.
Elle alluma une cigarette. Mais son briquet ne marcha pas. Elle gémit longuement. Je lui pris la cigarette de la bouche et je la lui allumai. Elle ne s'impatientait jamais, d'habitude, de ce genre d'inconvénients, ne se plaignait jamais de rien. Elle fuma sa cigarette, les lèvres crispées par le dégoût.
— On aurait mieux fait de rester à bord, dit-elle, elle ajouta : C'est toujours comme ça quand on descend.
Je sentis ma figure chavirer dans un rire invincible. Elle ne le vit pas.
La rue filait, pleine, devant nous. Les autocars, les autos et les camions longeaient la terrasse, en files compactes, dans un bruit d'enfer.
— Je ne descendrai plus jamais, dit-elle.
— Il faudra bien, dis-je, au Dahomey, chez les Éoués d'Epaminondas.
Elle me sourit aussi gentiment qu'elle pouvait.
— Je suis sûr qu'on va réussir, dis-je, on va chasser le koudou et on va se marrer. Le tort des gens, c'est en général de ne pas assez se marrer. On va se déguiser, je mettrai un casque à double fond, des lunettes noires, des culottes de cheval et je te donnerai une petite gibecière qui sera très utile si jamais nous flanchons.
Читать дальше