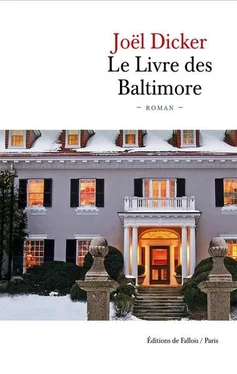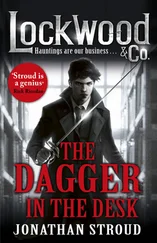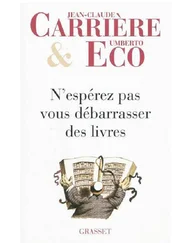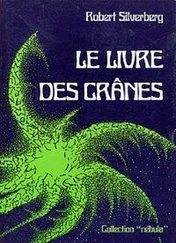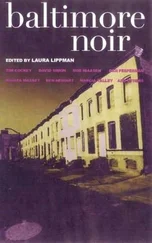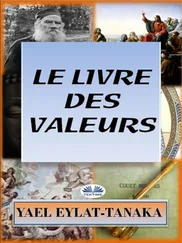— Avez-vous déjà vu Alexandra et Marcus ensemble ?
— Non, avait solennellement répondu Alvarez. Et le journal de titrer :
UN AMI DE MARCUS AFFIRME
NE L'AVOIR JAMAIS VU AVEC ALEXANDRA.
Des voisins et des paparazzis du dimanche passaient régulièrement devant chez moi pour prendre des photos de ma maison. Je ne pouvais pas sortir les chasser sans être pris moi-même en photo, et du coup, j'appelais sans cesse la police pour m'en débarrasser. À force, je sympathisai même avec toute une équipe de policiers qui vinrent un dimanche faire des grillades chez moi.
J'étais venu à Boca Raton pour avoir la paix et je ne m'étais jamais fait autant enquiquiner, y compris par mes propres amis à qui je n'osais rien confier des sentiments secrets qui m'animaient, de peur qu'ils en parlent autour d'eux. Je réclamais une intimité à laquelle j'avais renoncé en cherchant la gloire. Je ne pouvais pas tout avoir.
Je finis par prendre le pli d'aller à Coconut Grove, dans la maison d'Oncle Saul. C'était un sentiment étrange d'y être sans lui. C'était la raison pour laquelle j'avais acheté la maison de Boca Raton rapidement après son décès. Je voulais venir en Floride mais je ne pouvais plus venir chez lui. Je n'en étais plus capable.
À force de m'y rendre, j'apprivoisai à nouveau cette maison. Je trouvai le courage de commencer à mettre de l'ordre dans les cartons d'Oncle Saul. C'était difficile de faire le tri, d'envisager de se débarrasser de certaines de ses affaires. Cela me forçait à regarder une réalité encore trop dure à accepter : les Baltimore n'existaient plus.
Woody et Hillel me manquaient. Je réalisai qu'Alexandra avait raison : une partie de moi pensait que j'aurais pu les sauver. Que j'aurais pu empêcher le Drame.
*
Hamptons, New York.
1997.
Il est certain que le Drame trouva ses racines lors du dernier été que je passai avec Hillel et Woody dans les Hamptons. L'enfance merveilleuse du Gang des Goldman ne pouvait pas être éternelle : nous avions dix-sept ans, et l'année scolaire qui allait suivre serait la dernière pour nous au lycée. Nous entrerions ensuite à l'université.
Je me souviens du jour de mon arrivée là-bas. J'étais à bord du Jitney [3] Nom de la ligne de bus desservant les Hamptons.
, dont je connaissais le trajet par cœur.
Chaque virage, chaque ville traversée, chaque arrêt m'étaient familiers. Après trois heures et demie de route, j'arrivai dans la rue principale d'East Hampton où m'attendaient, impatients, Hillel et Woody. Le bus n'était pas encore arrêté qu'ils étaient déjà en train de hurler mon nom, excités comme jamais, se prosternant devant l'autocar en train de manœuvrer pour mieux m'accueillir. Je me collai contre la vitre du bus et ils y collèrent leurs deux visages, avant de taper contre la vitre pour que je vienne à eux encore plus vite, comme s'ils ne pouvaient plus attendre.
Je les vois encore tous les deux comme s'ils étaient devant moi. Nous avions grandi. Ils étaient devenus aussi dissemblables physiquement qu'ils étaient proches sentimentalement. Hillel, toujours très maigre, faisait moins que son âge, la bouche encore encombrée par un appareil dentaire compliqué. Woody, par sa taille et sa carrure, semblait beaucoup plus âgé qu'il ne l'était : grand, beau, gonflé de muscles et rayonnant de santé.
Je sautai en bas de l'autocar et nous nous jetâmes dans les bras les uns des autres. Et pendant de longues secondes, nous serrâmes du plus fort que nous pûmes l'amas de corps, de muscles, de chair et de cœurs que nous formions ensemble.
— Ce putain de Marcus Goldman ! s'écria Woody, les yeux brillants de joie.
— Le Gang des Goldman est à nouveau réuni ! exulta Hillel.
Nous avions à présent tous les trois le permis de conduire. Ils étaient venus me chercher avec la voiture d'Oncle Saul. Woody attrapa ma valise et la jeta dans le coffre. Puis nous montâmes à bord pour parcourir la route triomphale de nos dernières vacances.
Pendant les vingt minutes que dura le trajet jusqu'à la maison, ils me racontèrent, insatiables, les promesses de l'été, élevant la voix pour couvrir le bruit de l'air chaud qui entrait par les fenêtres ouvertes. Woody, lunettes de soleil sur les yeux, cigarette aux lèvres, conduisait ; j'étais assis à la place du mort et Hillel, sur la banquette arrière, avait passé sa tête entre nos deux sièges pour mieux participer à la conversation. Nous atteignîmes la côte, longeâmes l'océan, traversâmes East Hampton jusqu'au quartier coquet où se trouvait la maison. Woody fit crisser les pneus sur le gravier et klaxonna pour annoncer notre arrivée.
Je retrouvai Oncle Saul et Tante Anita là où je les avais laissés une année plus tôt : sous le porche, confortablement installés, en train de lire. La même musique classique s'échappait par la fenêtre ouverte du salon. C'était comme si nous ne nous étions jamais quittés et comme si East Hampton durerait toujours. Je me revois les retrouvant, et lorsque je repense au moment où je les embrassai et les serrai contre moi — ce qui était au fond la seule preuve tangible que nous avions véritablement été séparés —, je me rappelle combien j'aimais leurs étreintes. Celles de ma tante me faisaient me sentir homme, celles de mon oncle me faisaient me sentir fier. Il me revient aussi en mémoire toutes ces odeurs qui les accompagnaient : leur peau qui sentait le savon, leurs vêtements qui sentaient la buanderie de la maison de Baltimore, le shampoing de Tante Anita et le parfum d'Oncle Saul. Chaque fois, la vie me dupait un peu plus et me faisait croire que le cycle de nos retrouvailles serait éternel.
Sur la table à l'abri de l'auvent, je retrouvai la pile habituelle des suppléments littéraires du New York Times, qu'Oncle Saul n'avait pas encore lus et épluchait dans un ordre chronologique douteux. Je remarquai aussi quelques brochures de différentes universités. Et notre précieux carnet, dans lequel nous notions nos pronostics pour la saison à venir, couvrant toutes les disciplines : baseball, football, basket-ball et hockey. Nous ne nous limitions pas à jouer les oracles du dimanche en décrétant qui remporterait le Superbowl ou qui soulèverait la coupe Stanley. Nous allions beaucoup plus loin : vainqueurs de chaque conférence [4] Les équipes qui composent la Ligue nationale de football sont regroupées en deux conférences au sein desquelles elles s'affrontent durant le championnat.
, scores finaux, meilleurs joueurs, meilleurs marqueurs et transferts. Nous notions nos noms et juste à côté, nos pronostics. Et l'année suivante, nous reprenions le cahier pour voir lequel d'entre nous avait eu le meilleur nez. C'était l'une des occupations de mon oncle : collecter et noter au fil de la saison les différents résultats sportifs et les comparer ensuite avec nos prophéties. Si l'un de nous était tombé juste ou tout près, il en restait stupéfait. Il disait : « Ça alors ! Ça alors ! Comment vous avez pu deviner un truc pareil ? »
Par souci de fraternité, nous avions, vers l'âge de dix ou douze ans, décidé d'un choix neutre et acceptable des équipes que le Gang des Goldman soutiendrait officiellement. Le compromis s'était axé sur nos affinités géographiques. Pour le baseball, les couleurs des Orioles de Baltimore (choix de Woody et Hillel). Pour le basket-ball, le Miami Heat (en l'honneur des grands-parents Goldman). Pour le football, les Cowboys de Dallas et enfin, pour le hockey, les Canadiens de Montréal, probablement parce qu'à l'époque où nous avions arrêté nos choix, ils venaient de remporter la coupe Stanley, ce qui avait achevé de nous convaincre.
Читать дальше