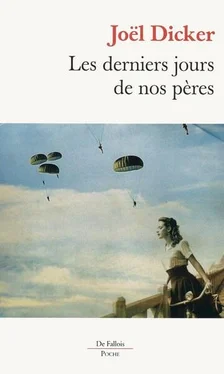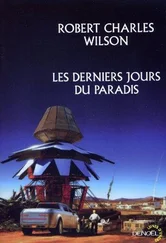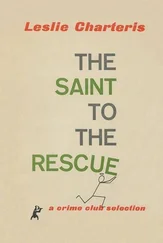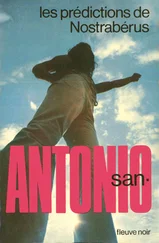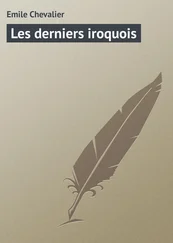— Il a été parachuté seul ?
— Oui, un pianiste devait le rejoindre plus tard.
— C’est vrai. Mais, d’après Laura, Faron avait dit que c’était officiellement un appartement sûr. La Section F aurait dû être au courant.
— Quoi d’autre ?
— Pal était à Paris. Il n’avait rien à y faire, il avait été parachuté dans le Sud. Que diable faisait-il là ? C’était pas son genre de désobéir aux ordres…
Stanislas acquiesça.
— Il devait avoir une bonne raison d’aller à Paris, mais laquelle ?… Le dossier mentionne-t-il les interrogatoires de Laura ?
— Oui. Apparemment Faron avait préparé un attentat contre le Lutetia, dit Doff.
— Le Lutetia ?
— Comme je te dis, il aurait montré des plans à Laura. Y avait un attentat de prévu ?
— Non, pas que je sache…
— Selon l’ordre de mission, Faron avait été envoyé à Paris pour préparer des cibles en vue de bombardements.
— Peut-être un bombardement du Lutetia ? suggéra Stanislas.
— Non. Il préparait un attentat à l’explosif.
— Bigre.
— Qu’est-ce que tout ça signifie selon toi ? demanda Doff.
— Je n’en sais rien.
— Quand je le pourrai, j’irai à Paris pour enquêter, dit Doff. Est-ce que le père de Pal est au courant que son fils est…
— Non, je ne crois pas. Son père… Tu sais, pendant les écoles de formation, il en parlait souvent. C’était un bon fils ce Pal.
Doff acquiesça et baissa la tête, triste.
— Dès qu’on pourra le prévenir, on le fera, déclara-t-il.
— Il faudra le faire bien.
— Oui.
Ils n’avaient pas vu Laura qui venait vers eux, Philippe toujours dans ses bras.
— Vous parliez de Pal, hein ?
— On disait que son père n’était pas courant de son décès, expliqua tristement Stanislas.
Elle les dévisagea tendrement et s’assit entre eux deux.
— Il faudra aller à Paris alors, dit-elle.
Les deux agents acquiescèrent et passèrent les bras derrière elle, en signe de protection. Puis, sans qu’elle le remarque, ils se regardèrent mutuellement ; ils en avaient parlé plusieurs fois dans le secret de Baker Street. Ils voulaient comprendre ce qui s’était passé à Paris, ce jour d’octobre.
*
Assis à son pupitre, Kunszer fixait le téléphone, épouvanté par la nouvelle : Canaris, le chef de l’Abwehr, avait été arrêté par le contre-espionnage du Sicherheitsdienst. Depuis l’attentat contre Hitler, huit jours plus tôt, les hauts officiers allemands étaient tous surveillés ; on avait tenté de tuer le Führer en plaçant une bombe dans une salle de réunion du Wolfsschanze , son quartier général près de Rastenburg. La répression au sein de l’armée était terrible, les soupçons pesaient sur tout le monde, le Contre-espionnage avait mis les téléphones sur écoute. Et Canaris qui avait été arrêté. Faisait-il partie des conspirateurs ? Qu’adviendrait-il de l’Abwehr ?
Il avait peur. Pourtant, il n’avait pas participé à la conspiration, il n’avait rien fait, et c’était justement pour cette raison qu’il avait peur : il y avait des mois qu’il n’avait plus rien fait pour l’Abwehr ; si on se penchait sur son cas, on prendrait sa passivité pour de la trahison. Mais, s’il était inerte, c’est parce qu’il ne croyait plus depuis longtemps à la victoire allemande. Et maintenant, les Alliés avançaient en France ; dans quelques semaines, ils seraient aux portes de Paris. Bientôt la fière Allemagne fuirait, il le savait. Les armées se replieraient, et le Reich aurait alors tout perdu, ses fils et son honneur.
Il avait peur. Peur qu’on vienne l’arrêter pour haute trahison lui aussi. Mais jamais il n’avait trahi. Tout au plus avait-il eu ses propres opinions. Si ça ne tenait qu’à lui, il resterait barricadé dans son bureau du Lutetia, son Luger à la main, prêt à abattre les SS qui lui donneraient l’assaut, prêt à se faire sauter la cervelle lorsque les Britanniques qu’il avait tant combattus rentreraient en char dans Paris. Mais il y avait le père ; on n’abandonne pas son père. S’il sortait encore, c’était pour lui.
Les armées allemandes ne pouvaient plus rien contre l’inexorable avancée alliée, redoutablement appuyée par la Résistance. Dans les premiers jours d’août, les Américains prirent Rennes ; à la fin de la première semaine, la Bretagne entière était libérée. Puis les blindés de l’US Army entrèrent au Mans et, le 10 août, à Chartres.
Key et son groupe, qui en avaient terminé avec le Nord à présent libéré, furent déployés avec une unité de SAS dans la région de Marseille, en prévision du débarquement en Provence.
Dans le maquis, Claude poursuivait son enquête, à la recherche du conspirateur qui avait livré Pal aux Allemands. Mais si Pal avait été trahi par un maquisard, comment l’Abwehr était-elle parvenue à remonter jusqu’à l’appartement de Faron ? En le suivant ? Celui qui avait donné Pal était peut-être indirectement responsable de la capture de Faron. Il fallait trouver le coupable. Sur les quatre personnes à avoir réceptionné Pal à son atterrissage, Claude n’avait aucun doute sur Trintier, et ses investigations avaient mis Donnier hors de cause. Restaient Aymon et Robert. Après avoir longuement réfléchi à la question, ce dernier lui apparaissait comme le principal suspect, car rien ne le disculpait vraiment : Robert était chargé de faire la liaison entre le maquis et l’extérieur, il vivait dans un village proche et assurait notamment l’approvisionnement des combattants en nourriture ; il avait pu traiter avec les Allemands sans éveiller de soupçons. Claude avait longuement observé le comportement de Robert et Aymon ; ils étaient tous deux de braves résistants et de fiers patriotes. Mais cela ne voulait plus rien dire.
*
Le 15 août, l’opération Dragoon fut lancée ; les forces américaines et françaises débarquèrent en Provence depuis l’Afrique du Nord. Les réseaux, alertés la veille par un message de la BBC, participèrent aux combats.
De nombreux volontaires se pressèrent vers les maquis pour prendre les armes. Les Allemands n’opposaient que très peu de résistance. Dans les villages, se mêlant aux uniformes des soldats français et américains, les combattants de tous bords et de toutes factions exhibaient leurs insignes et leurs armes, pour marquer leur fierté de participer à la libération. Cet engouement populaire donna lieu aux premières tensions entre Claude et Trintier : Claude se méfiait de l’afflux de combattants de la dernière heure, il voulait que Trintier y mette un terme. Les nouveaux arrivants n’étaient pas formés, il n’y avait pas suffisamment de matériel, et surtout, il soupçonnait des collaborateurs, voyant le vent tourner, de se mêler aux maquisards. La France devrait les juger.
— C’est beau tous ces Français volontaires ! protestait Trintier. Ils veulent défendre leur pays.
— Il y a quatre ans qu’ils auraient dû s’y mettre !
— Tout le monde n’a pas la carrure d’un héros de guerre…
— C’est pas la question ! On va pas prendre des gens qui ne connaissent rien au combat. Ta responsabilité, c’est aussi que tes hommes survivent.
— Et qu’est-ce que je leur dis, moi, à ceux dont on ne veut pas ?
— Envoie-les dans les hôpitaux, où ils seront plus utiles qu’ici. Ou chez les FFI… ils ont toujours besoin de monde.
Après une journée particulièrement éprouvante et une énième dispute avec Trintier, Claude s’isola sur une petite butte ; il était de très mauvaise humeur. Il venait d’inspecter les vivres et le matériel : il manquait des outils et de la nourriture de la dernière livraison de la RAF. Il soupçonnait Robert, plus que jamais ; seul lui pouvait quitter le maquis avec du matériel. Si c’était lui, que devait-il faire ? Claude était nerveux, agacé. Après quelques minutes, Gros vint le trouver. Il faisait très chaud, et Gros lui apportait une bouteille d’eau. Claude le remercia.
Читать дальше