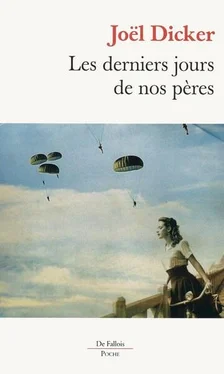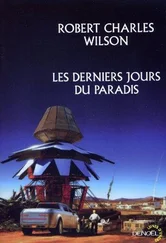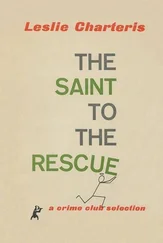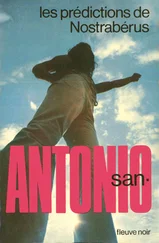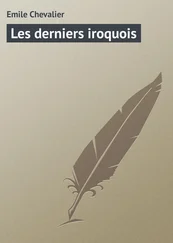*
Gros vivait désormais dans un petit immeuble, tout proche de la mer, dans une petite ville du nord-est de la France. Il avait rejoint un groupe d’agents au sein duquel il était le seul à mener des activités de propagande noire, parfois aidé de quelques résistants. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il pensait à ses parents. Il se sentait mélancolique. Sa famille venait de Normandie, ses parents habitaient dans les faubourgs de Caen : il se demandait ce qu’ils étaient devenus. Il était triste. Pour se donner du courage, il pensait à l’enfant de Laura et il se disait qu’il était peut-être né pour veiller sur cet enfant.
Il se sentait seul, la clandestinité l’angoissait. Il avait besoin de tendresse. Il avait entendu dire par les autres agents qu’il y avait un bordel dans une ruelle proche, fréquenté par des officiers allemands. Ils s’étaient tous demandé s’il ne fallait pas y planifier un attentat. Gros, lui, s’était demandé s’il ne fallait pas aller y chercher un peu d’amour. Que dirait Laura si elle savait qu’il se livrait à ce genre d’activité ? Une après-midi, il céda au désespoir : il avait tant besoin d’amour.
*
Le 21 mars, jour du printemps, Kunszer convoqua Gaillot au Lutetia. Il le fit venir dans son bureau. Il y avait longtemps qu’il ne l’avait pas vu.
Gaillot fut ravi d’être reçu au quartier général, c’était la première fois ; et cette joie n’étonna pas Kunszer. Si Gaillot s’était offusqué de devoir pénétrer au vu et au su de tous dans les bureaux de l’Abwehr, il l’aurait épargné ; car, au moins, ç’aurait été un bon soldat. Si au premier contact, trois ans plus tôt, Gaillot s’était refusé à collaborer, s’il avait fallu le menacer et le contraindre, il l’aurait épargné, car au moins ç’aurait été un bon patriote. Mais Gaillot n’était rien d’autre qu’un traître à sa patrie. Sa patrie, sa seule patrie, il l’avait trahie. Et, pour ce motif, Kunszer détestait Gaillot : il représentait à ses yeux le pire de ce que la guerre pouvait produire.
— Je suis si excité d’être là, déclara Gaillot, frétillant, en entrant dans le bureau.
Kunszer le dévisagea sans répondre. Il ferma la porte à clé.
— Comment se passe la guerre ? demanda le visiteur pour combler le silence.
— Très mal, nous allons la perdre.
— Ne dites pas ça ! Il faut garder espoir !
— Savez-vous, Gaillot, ce qu’ils vous feront lorsqu’ils auront gagné la guerre ? Ils vous tueront. Ce qui sera toujours moins dur que ce que nous-mêmes leur avons infligé.
— Je partirai avant.
— Et ou donc ?
— En Allemagne.
— L’Allemagne… pfff. Mon petit Gaillot, l’Allemagne, ils la raseront.
Gaillot resta muet, abasourdi. Il fallait que Kunszer y croie. Il se ranima lorsque l’Allemand lui tapota l’épaule comme un vieil ami.
— Allons, Gaillot. Pas d’inquiétude à avoir, nous vous mettrons à l’abri.
Gaillot sourit.
— Trinquons. Au Reich, proposa Kunszer.
— Oui, trinquons au Reich ! hurla Gaillot comme un enfant.
Kunszer installa son visiteur dans un fauteuil confortable, puis il se tourna vers son bar. De dos au Français, il versa de l’eau dans un verre, illusion d’un quelconque alcool, et y ajouta le contenu d’une fiole opaque : une matière blanche et granuleuse qui ressemblait à du sel. Du cyanure de potassium.
— Santé ! s’écria Kunszer en apportant le verre à Gaillot, qui n’avait rien vu.
— Vous ne buvez pas ?
— Plus tard.
Gaillot ne se formalisa pas.
— Au Reich ! répéta-t-il une dernière fois avant de vider son verre d’un trait.
Kunszer observa sa victime enfoncée dans le fauteuil, elle lui faisait pitié. Il allait peut-être avoir des convulsions ; puis son corps serait paralysé, ses lèvres et ses ongles deviendraient violets. Avant que son cœur ne cesse de battre, Gaillot serait conscient pendant quelques minutes, figé comme une statue. Une statue de sel.
Le Français, livide, semblait déjà immobilisé, il respirait difficilement. Alors Kunszer ouvrit son armoire secrète et en sortit sa Bible. Et au traître qui mourait lentement, il lut les versets de Sodome et Gomorrhe.
C’était le printemps. La campagne du SOE en France, en préambule à Overlord, battait son plein. Le Débarquement était prévu pour le 5 mai. En quatre ans, le Service avait constitué, formé et armé des Réseaux de résistance à travers toute la France, à l’exception de l’Alsace. Mais à six semaines de l’offensive alliée, ils manquaient de tout, car la météo exécrable des derniers mois avait fortement perturbé les ravitaillements. La priorité du SOE était à présent de les approvisionner en armes et en munitions avant l’ouverture du front normand : depuis janvier, la RAF, désormais appuyée par l’US Air Force, avait déjà effectué plus de sept cents sorties, contre une centaine pour le dernier trimestre de l’année 1943.
*
Le maquis se préparait à la tempête. L’une des premières opérations que dirigea Claude avec son réseau fut le sabotage d’un dépôt de locomotives. Minutieux, il fit placer une charge sous chacune des machines : l’opération dura plus d’une heure. Mais les minuteries des détonateurs ayant été mal coordonnées, il en résulta des explosions en chaîne qui semèrent le chaos parmi les soldats allemands dépêchés sur place, ce qui valut au curé d’être considéré par les résistants comme un chef de guerre au génie innovateur.
Malgré quelques autres opérations réussies, menées avec Trintier, Claude était préoccupé : ils étaient mal équipés. Ils avaient de quoi tenir un peu, mais les munitions partaient vite. Il avait déjà passé commande auprès de Londres, mais les livraisons étaient encore trop rares et incomplètes, car les réseaux du nord du pays avaient la priorité. On prépara donc des réserves d’armes, on ordonna de tirer peu ; il ne fallait rien gaspiller.
Les maquisards connaissaient la plupart des armes, sauf les pistolets-mitrailleurs Marlin : Claude les initia à leur maniement. Le curé leur recommanda d’utiliser les Marlin plutôt que des Sten aussi souvent que possible, car ils étaient à la fois plus précis et plus économes en munitions. Le maquis avait également reçu, à l’automne, des armes lourdes : des lanceurs antichar PIAT.
— Comment on utilise ces machins ? demanda Trintier à Claude pendant une inspection du matériel.
Claude prit un air embarrassé : il n’en avait pas la moindre idée.
— Je suppose qu’on vise… et…
Trintier rit jaune. Claude, empirique, lui suggéra de faire ses propres essais. En revanche, lorsque de simples combattants lui posèrent la même question, le curé, qui ne voulait pas perdre la face, répondit en prenant des airs importants et affairés : « On est la guérilla, oui ou merde ? La guérilla, c’est le fusil. Concentrez-vous sur vos fusils et ne venez pas m’emmerder avec toutes vos questions ! » Puis il demanda à son pianiste d’envoyer d’urgence un message à Londres pour obtenir, en plus des armes, un instructeur ou n’importe qui d’autre capable de former au plus vite les hommes de Trintier à utiliser ses PIAT.
*
À Londres, Stanislas, au sein du groupe SOE/SO, préparait intensément les opérations associant les services alliés. Si la période creuse du SOE en France s’était achevée en février, grâce notamment à la reprise des vols de ravitaillement, il fallait à présent faire face aux vifs débats qu’engendrait la question du support aérien au SOE ; l’Intelligence Service anglais, l’Office of Strategic Service (OSS) américain et d’autres entités des services secrets professionnels alliés, voyaient d’un mauvais œil le ballet incessant des avions qui ne faisait qu’attirer l’attention de la Gestapo et mettait en danger les agents de tous les services secrets opérant sur le terrain, tout ça, selon eux, pour appuyer les agents amateurs du SOE et quelques résistants mal aguerris.
Читать дальше