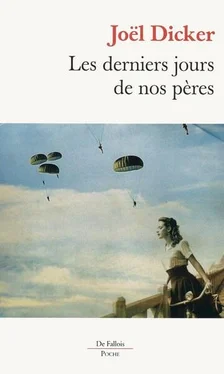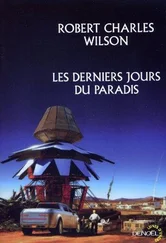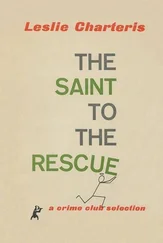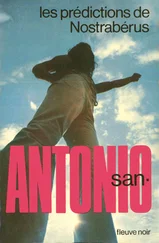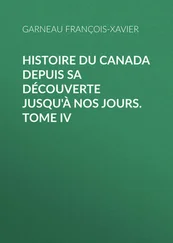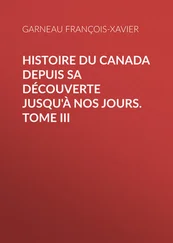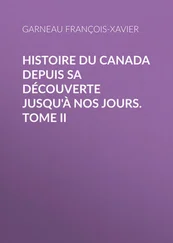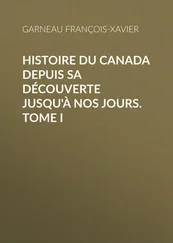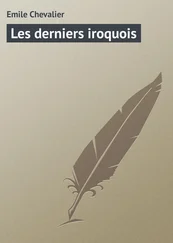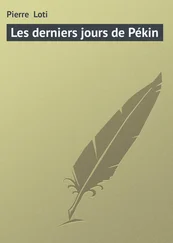*
Une dizaine de jours plus tard, Claude prit le départ pour la France. Puis ce furent les premiers jours de février ; Overlord aurait lieu dans quelques mois à peine. Pour la Section F, le début de l’année s’annonçait aussi mauvais que la fin de la précédente : les tempêtes avaient duré jusqu’à la mi-janvier, perturbant gravement les opérations aériennes, tandis que dans le nord de la France, des agents parachutés venaient d’être réceptionnés par la Gestapo. La Gestapo était redoutable, et son service de radiogoniométrie particulièrement efficace. En prévision d’Overlord, le commandement général du SOE allait bientôt déclencher l’opération Ratweek : l’élimination des cadres de la Gestapo à travers l’Europe ; mais la Section F n’était pas concernée.
Ce fut ensuite au tour de Key et Rear de quitter Londres. Avant de rejoindre un groupe commando près de Birmingham, dans les Midlands, ils furent envoyés à Ringway pour un bref stage de remise à niveau, car la technique de parachutage avait été légèrement modifiée. À présent, on sautait avec un sac de jambe : le matériel de mission était rangé dans un sac en toile, attaché à la jambe du parachutiste par une corde de plusieurs mètres de long. Au moment du saut, la corde se tendait, le sac pendant dans le vide ; dès qu’il touchait le sol, la corde s’assouplissait, et l’agent était ainsi averti que l’atterrissage était imminent.
Gros, enfin, fut appelé pour le départ. Il se prépara à l’immuable rituel, qui était presque devenu une routine : un dernier passage à Portman Square, puis le départ vers une maison de transit où il resterait jusqu’au décollage du bombardier, depuis l’aérodrome de Tempsford, le moment exact dépendant de la météo. Il ne craignait pas de repartir, mais il appréhendait de laisser Laura seule ; comment les protéger, elle et l’enfant, s’il n’était pas là ? Il y avait certes Stanislas, mais il ne savait pas si le vieux pilote saurait aimer l’enfant comme lui-même en avait décidé ; c’était important de l’aimer déjà. Il se rassura en songeant qu’il y aurait aussi Doff à Londres ; Gros l’aimait bien. Il lui faisait souvent penser à Pal, en plus âgé. Doff devait avoir dans les trente ans.
À la veille de quitter Londres, préparant sa valise dans sa chambre de Bloomsbury, Gros donna ses dernières indications à Doff ; il était des leurs à présent.
— Fais bien gaffe avec Laura, mon petit Adolf, déclara Gros, solennel.
Doff acquiesça, amusé par le géant. Laura entamait son quatrième mois de grossesse.
— Pourquoi tu ne m’appelles jamais Doff ?
— Parce qu’Adolf, c’est un beau prénom. C’est pas parce que Hitler-du-cul t’a piqué ton prénom qu’il faut en changer. Tu sais combien y a d’hommes dans la Wehrmacht ? Des millions. Alors crois-moi, tous les prénoms du monde sont dedans. Pour un peu que t’ajoutes les collabos et la Milice, notre compte est définitivement bon à tous. Est-ce qu’il faut qu’on s’appelle par des noms que personne n’a salis, comme Pain, Salade ou Papier de chiotte ? T’aimerais que ton gamin s’appelle Papier de chiotte , toi ? Papier de chiotte, mange ta soupe ! Papier de chiotte, as-tu fait tes devoirs ?
— On t’appelle bien Gros…
— Ça, c’est pas pareil, c’est un nom de guerre. T’es comme Denis et Jos, tu pouvais pas savoir… T’étais pas avec nous à Wanborough Manor.
— Tu mérites pas qu’on t’appelle Gros.
— C’est un nom de guerre, je te dis.
— Quelle différence ?
— Après la guerre, c’est terminé. Tu sais pourquoi j’aime bien la guerre ?
— Non.
— Parce que, quand ça s’arrêtera, on aura tous une deuxième chance d’exister.
Doff dévisagea l’obèse avec empathie.
— Prends soin de toi, Gros. Reviens-nous vite, l’enfant aura besoin de toi. Tu seras un peu son père…
— Son père ? Non. Ou alors son père secret, qui veille dans l’ombre. Mais rien de plus. Tu m’as bien regardé, moi ? Je ne serai pas un père, je serai un animal de cirque, avec mes affreux cheveux et tous mes doubles mentons. Mon faux enfant aura toujours honte de moi. Et on peut pas être un père qui fait honte, on ne fait pas ça à un enfant.
Il y eut un silence. Gros regarda Doff : c’était un bel homme. Et il soupira, plein de regrets. Il aurait aimé être comme lui. Ç’aurait été plus facile avec les femmes.
Il assistait depuis deux jours à une importante réunion au Lutetia entre des responsables des antennes espagnole, italienne et suisse de l’Abwehr. Deux jours enfermés dans le Salon chinois, emportés dans leurs intenses débats ; deux jours qu’il passa à bouillonner intérieurement d’impatience : pourquoi diable n’avait-il pas reçu sa commande ? Ce n’est qu’à la fin de l’ultime séance que le responsable de l’antenne suisse dit à Kunszer :
— Werner, j’allais oublier : j’ai votre paquet.
Kunszer fit semblant d’avoir oublié sa requête du mois dernier. Et il suivit son collègue jusqu’à sa chambre, fébrile.
Le paquet était une enveloppe en kraft, petite mais épaisse. Kunszer, pressé, l’ouvrit dans l’ascenseur : elle contenait des dizaines de cartes postales de Genève, vierges.
*
Chaque semaine depuis novembre, inlassablement, Kunszer allait trouver le père, avec ses victuailles et son champagne. Et il mangeait avec lui, pour s’assurer qu’il se nourrissait aussi. La cuisine pourtant embaumait toujours ; le père, tous les midis, préparait le déjeuner pour son fils. Mais il n’y touchait jamais, il s’y refusait : le repas du fils, si le fils ne venait pas, n’était pas mangé. Alors les deux hommes, silencieux, se contentaient des provisions froides. Kunszer, lui, touchait à peine à la nourriture, s’affamant de bon cœur : il voulait qu’il y ait des restes et que le père mange encore. Ensuite, il glissait discrètement de l’argent dans le sac à provisions.
Les week-ends, le petit homme ne sortait plus de chez lui.
— Vous devriez vous aérer un peu, lui répétait Kunszer.
Mais le père s’y refusait.
— Je ne voudrais pas rater Paul-Émile. Pourquoi ne me fait-il plus signe ?
— S’il le pouvait, il le ferait. La guerre, vous savez, c’est difficile.
— Je sais… soupirait-il. Est-il un bon soldat ?
— Le meilleur.
Lorsqu’ils parlaient de Pal, le visage du père prenait quelques couleurs.
— Avez-vous combattu à ses côtés ? demandait le père à chaque fin de repas, comme si le même jour se répétait sans cesse, empêchant le calendrier de s’égrener.
— Oui.
— Racontez-moi, suppliait le père.
Et Kunszer racontait. N’importe quoi. Pourvu que le père se sente moins seul. Il racontait de fantasques exploits, en France, en Pologne, partout où le Reich avait installé ses soldats. Paul-Émile terrassait les colonnes de blindés et sauvait ses camarades ; la nuit, au lieu de dormir, s’il ne lançait pas des obus de DCA dans le ciel, il œuvrait comme bénévole dans les hospices pour grands blessés. Le père était éperdu d’admiration pour son fils.
— Ne voulez-vous pas sortir un peu ? proposait Kunszer à chaque fois qu’il terminait son sempiternel récit.
Le père refusait toujours. Et Kunszer insistait.
— Cinéma ?
— Non.
— Concert ? Opéra ?
— Non deux fois.
— Promenade ?
— Non, merci.
— Qu’aimez-vous ? Le théâtre ? Je peux vous avoir ce que vous voulez, tout, tout, Comédie-Française si cela vous plaît.
Les comédiens venaient souvent dîner à la brasserie du Lutetia. Si le père avait envie de les rencontrer, ou s’il voulait assister à une représentation privée, il le lui obtiendrait. Oui, ils joueraient pour lui, dans son salon, si tel était son désir. Et s’ils refusaient de venir, il ferait fermer leur théâtre minable, il leur enverrait la Gestapo, et il les déporterait tous en Pologne.
Читать дальше