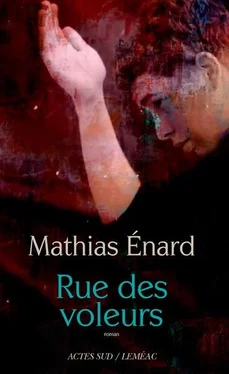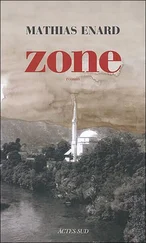J’ai quitté Algésiras avec la sensation que le monde était vide, peuplé exclusivement de fantômes qui apparaissaient la nuit pour mourir ou pour tuer, pour laisser ou prendre, sans jamais se voir ni communiquer entre eux, et dans la longue nuit d’autocar qui m’a amené jusqu’à Barcelone, ville du Destin et de la Mort, j’avais la terrible impression de traverser le Pays des Ténèbres, les vraies, les nôtres, et plus le bus avançait dans l’obscurité sur l’autoroute au milieu du désert, entre Almería et Murcie, plus l’horreur dont je venais d’être témoin s’insinuait en moi ; le visage de Cruz, humide et violet dans ses contractions, m’apparaissait parmi les éclairs des phares des camions, au milieu des reflets sur ma vitre.
Cruz était parmi les ombres, et moi aussi.
Incapable de fermer l’œil, poursuivi par les images funestes, les corps flétris par la mer et la figure de Cruz qui projetait son agonie vers moi, j’ai attendu la libération de l’aube, alors que l’autocar approchait déjà d’Alicante.
Je suis arrivé à Barcelone le 3 mars — j’avais quitté Tanger depuis plus de quatre mois. Je ne savais pas où aller. Dans ma parka verte avec mon sac de sport des années 1980 je devais avoir l’air d’un pauvre parmi les pauvres, les yeux cernés, la barbe noire — si jamais les flics m’arrêtaient et me fouillaient, j’aurais du mal à justifier les milliers d’euros en liquide que je portais sur moi. Après l’argent du Cheikh Nouredine, celui de Cruz, comme si Dieu s’arrangeait toujours pour me donner les moyens de mon voyage ; je mangeais dans la main du Destin.
L’autobus a descendu l’avenue Diagonal, les palmiers caressaient les banques, les nobles immeubles des siècles passés se reflétaient dans le verre et l’acier des bâtiments modernes, les taxis jaune et noir étaient d’innombrables guêpes qui s’égaillaient sous les coups de klaxon du car ; les piétons élégants et disciplinés attendaient patiemment aux carrefours, sans user de la supériorité que leur donnait le nombre pour envahir la chaussée ; les voitures elles-mêmes respectaient les passages cloutés et laissaient passer, soigneusement arrêtées devant un feu orange clignotant, ceux qui allaient à pied, leur tour venu. Les vitrines me paraissaient toutes luxueuses ; la ville était intimidante mais, malgré la fatigue, y arriver enfin me remplissait d’une énergie nouvelle, comme si le gigantesque phallus scintillant de cette tour colorée, là-bas au fond du paysage, divinité païenne, me transmettait sa force.
J’ai cligné des yeux dans la lumière de midi ; j’ai attrapé mon sac ; la gare du Nord, estació del Nord , jouxtait apparemment un grand parc ; un peu plus bas vers la mer se trouvait la gare de France et ensuite, à droite, le port. J’ai avisé une cabine téléphonique et j’ai appelé Judit, elle a décroché et en entendant sa voix je devais être à ce point épuisé que je me suis mis à pleurer comme un gosse. J’ai dit c’est moi, c’est Lakhdar, je suis à Barcelone. Elle a paru contente de m’entendre, malgré mes reniflements ; elle m’a demandé où je me trouvais, je lui ai répondu à l’estació del Nord ; elle m’a proposé de la retrouver non loin de là, dans un quartier appelé le Born, et puis elle a ajouté non, c’est compliqué, tu ne vas jamais trouver, ne bouge pas, je viens te chercher, donne-moi un quart d’heure. J’ai dit merci, merci, j’ai raccroché, j’ai eu comme un éblouissement, j’ai été obligé de m’asseoir par terre, au pied de la cabine. J’ai remercié Dieu, j’ai dit une courte prière, j’ai eu un peu honte de m’adresser à Lui.
Je suis resté comme ça, les yeux fermés, la tête dans les mains, de longues minutes, avant de reprendre mes esprits. Je voulais avoir l’air fort au moment de l’arrivée de Judit — je me sentais sale, j’avais l’impression de puer le cadavre, la morgue, la haine ; je ne l’avais pas vue depuis l’été précédent, est-ce qu’elle allait me reconnaître ?
Et puis l’énergie de la Tour Unique m’est revenue.
Celle du désir.
Les premières minutes ont été très étranges.
Nous ne nous sommes pas embrassés, mais souri ; nous étions aussi gênés l’un que l’autre. Nous avons échangé quelques banalités, elle m’a détaillé des pieds à la tête, sans rien en conclure — ou du moins, sans rien révéler de ses conclusions ; elle m’a juste dit tu veux déjeuner ? Ce qui m’a paru une question bizarre, j’ai répondu oui, pourquoi pas, et on s’est mis à marcher en direction du centre-ville.
Je lui ai raconté les dernières semaines chez Cruz, évidemment sans aborder leur fin horrible. Elle compatissait, et ma lâcheté était telle que j’avais envie qu’elle me plaigne, pour l’attendrir. La revoir me faisait battre le cœur ; je n’avais qu’une envie, c’était qu’elle me prenne dans ses bras ; je voulais m’allonger à ses côtés, tout contre elle, et dormir comme ça, dans sa chaleur, pendant au moins deux jours. Sur le chemin nous avons croisé un arc de triomphe en briques rouges qui ouvrait une large promenade bordée de palmiers et de bâtiments élégants. J’espérais secrètement que l’endroit où nous nous rendions ne soit pas trop chic, je ne voulais pas avoir honte de ma tenue. Heureusement elle m’a emmené dans un bar sur une jolie petite place calme et ombragée. J’ai dû me forcer à manger.
Je n’arrivais pas à poser de questions à Judit, du moins pas celles que j’aurais voulu lui poser ; je l’interrogeais sur Barcelone, sur la géographie de la ville, les quartiers, aucune question personnelle ; tout cela était terriblement artificiel. Elle évitait de me regarder dans les yeux. La tristesse commençait à m’envahir. J’avais l’impression que le sol se dérobait sous mes pieds, le temps devenait épais, matière lourde et tangible, le visage de Judit paraissait s’être assombri, elle s’était coupé les cheveux, ce qui lui donnait un air plus dur. Elle me parlait surtout de politique, à présent ; de la crise en Europe, de sa dureté, du chômage, de la misère qui remontait comme du fin fond de l’histoire de l’Espagne, disait-elle, des conflits, du racisme, des tensions, de l’insurrection qui se préparait. Elle était très liée au mouvement des Indignés, depuis quelques mois. Aussi très liée à celui des Okupas, disait-elle. La répression n’a jamais été aussi violente. L’autre jour un étudiant de vingt ans a encore perdu un œil à cause d’une balle en caoutchouc lorsque les flics ont délogé un sit-in pacifique, disait-elle. L’Espagne va vers sa fin, et l’Europe aussi. La propagande ultralibérale nous fait croire qu’on ne peut pas résister au diktat des marchés. Ici on ne soignera bientôt plus les pauvres, les vieux, les étrangers. Pour le moment la révolte n’éclate pas parce qu’il y a le football, le Real, le Barça ; mais quand ça ne suffira plus à compenser la frustration et la misère, ce sera l’émeute, disait-elle.
Je la regardais, j’avais envie de lui prendre la main, pas de parler de la crise. Par moments, le visage de Cruz me revenait en mémoire, s’immisçait entre Judit et moi ; il me fallait alors secouer la tête pour le faire disparaître.
Elle s’emmerdait à la fac. Elle était en dernière année, elle avait peu de matières, pas beaucoup d’heures de cours, et l’impression d’être toujours aussi nulle en arabe, disait-elle. Elle ne savait pas trop quoi faire, elle avait envie de passer du temps à l’étranger, peut-être en Égypte ou au Liban, puisque la Syrie était en flammes — j’ai été blessé qu’elle ne cite pas le Maroc, j’ai dû faire une drôle de tête, elle a changé de sujet immédiatement.
Читать дальше