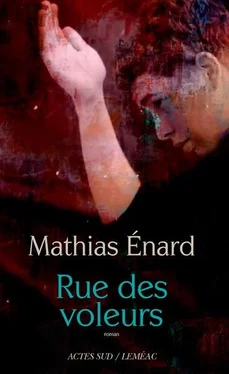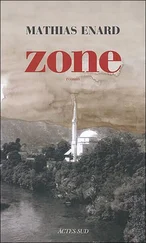J’ai hésité. C’était une façon de quitter Cruz ; ce serait aussi dire adieu à Judit. J’étais sûr que si je rentrais à Tanger il me serait presque impossible de revenir en Espagne.
Saadi a deviné la raison de mon hésitation, il n’a pas insisté.
Je lui ai raconté mes journées chez Cruz, la grande tristesse de ce travail horrible, il écoutait en ouvrant de grands yeux et en secouant sa tête grise ; il disait eh ben, fils, si j’avais su, je ne t’aurais pas envoyé dans ce cloaque — j’ai essayé de le rassurer, sans grande conviction, en lui disant que ça me faisait un peu de fric pour partir à Barcelone dans un mois ou deux.
On est restés jusqu’au soir, assis à la même terrasse, à profiter de la brise, du lent mouvement des palmes qui versaient un peu d’ombre sur la place. Et puis il est reparti. Il m’a pris dans ses bras, il m’a dit sûr que tu ne veux pas rentrer avec moi sur le bateau ? Ça me fait quelque chose de te renvoyer là-bas.
J’ai hésité une seconde, c’était tentant de rester avec lui, de retrouver la cage flottante de l’ Ibn Batouta , où rien ne pouvait vous arriver, à part écraser un cafard pieds nus par inadvertance.
Finalement j’ai refusé, j’ai promis de l’appeler très bientôt et après une dernière embrassade je suis parti prendre mon bus.
J’ai aussi profité de l’absence de mon patron pour échafauder un plan. Je savais qu’il conservait — du moins quand il était là — une certaine somme d’argent dans un petit coffre-fort, pour ce qu’il payait de la main à la main, que ce coffre-fort avait une clé et qu’il la gardait dans son trousseau.
L’idée du vol m’a été donnée par le polar que j’étais en train de lire, par tous les polars que j’avais lus ; après tout n’étais-je pas enfermé dans un roman noir, très noir — il était logique que ce soient ces lectures qui me suggèrent une façon d’en sortir.
Ibn Batouta raconte dans ses voyages que lors de sa visite à La Mecque, il croise un étrange personnage, un muet que les Mecquois connaissent tous et appellent Hassan le Fou, touché par la démence dans des circonstances étranges : lorsqu’il était encore sain d’esprit, Hassan accomplissait ses déambulations rituelles autour de la Kaaba la nuit et, chaque soir, il croisait un mendiant dans le sanctuaire — ils ne se voyaient jamais de jour, uniquement la nuit. Une nuit, donc, le mendiant s’adressa à Hassan : Hé, Hassan, ta mère s’ennuie de toi et pleure, tu n’aimerais pas la revoir ? Ma mère ? Bien sûr, répondit Hassan dont le cœur s’était serré à ce souvenir, bien sûr, mais ce n’est pas possible, elle est loin. Un jour le mendiant lui proposa de le retrouver au cimetière, et Hassan le Fou accepta ; le mendiant lui demanda de fermer les yeux et de s’agripper à son vêtement et lorsqu’il les ouvrit de nouveau, Hassan était devant chez lui, en Irak. Il passa quinze jours auprès de sa mère. Deux semaines plus tard, il croisa le mendiant au cimetière du village ; celui-ci lui proposa de le ramener à La Mecque, chez son maître Najm Ed-Din Isfahâni, par le même moyen, les yeux fermés, les mains accrochées à la robe de tiretaine, en lui faisant promettre de ne jamais rien révéler de ce voyage. Isfahâni s’inquiéta de la longue absence de son serviteur, quinze jours, ce n’est pas rien — Hassan finit par raconter l’histoire du mendiant et Isfahâni, dans la nuit, voulut voir l’homme en question : Hassan le mena à la Kaaba et désigna le vagabond d’un cri à son maître, c’est lui ! C’est lui ! Aussitôt le mendiant lui mit une main en travers de la gorge et dit Par Dieu, tu ne parleras jamais plus, et ainsi fut fait ; le mendiant disparut et Hassan, fou et muet, tourna autour du sanctuaire des années durant, sans dire de prières, sans faire d’ablutions : les gens de La Mecque prenaient soin de lui, le nourrissaient comme un saint étrange, car la bénédiction de Hassan augmentait les ventes et les bénéfices ; Hassan le Fou tournait, tournait autour de la pierre noire, en orbite, dans le silence éternel, pour avoir voulu revoir sa mère, pour avoir trahi un secret, et dans mes ténèbres, auprès des petits cadavres de Cruz, parmi les chiens, je priais pour qu’un mendiant magique me sorte quelque temps de l’obscurité, me ramène en arrière, dans la lumière de Tanger, chez ma mère, dans les bras de Meryem, de Judit, avant de me laisser tourbillonner comme une météorite fragile autour de la planète, des années durant. Je repense aujourd’hui à cette noire parenthèse, à cette première réclusion à Algésiras, cette antichambre, alors qu’autour de moi tournent les perdus, qu’ils déambulent, aveugles, sans le secours des livres ; Cruz en réalité profitait des possibilités du monde, des fastes de la mort ; il vivait comme ces bousiers, ces vers, ces insectes qui pullulent sur les cadavres et avait sa conscience pour lui, sans doute, il pensait faire le Bien ; il rendait service ; il parasitait la misère : autant reprocher à un chien de mordre. C’était le gardien du château, le batelier du Détroit, un homme perdu, lui aussi, au fond de sa forêt mortelle, qui tournait, à l’infini, dans le noir.
C’est peut-être cette longue fréquentation des cadavres qui m’a facilité les choses ; ces deux mois de mort ont fait que la perspective de dévaliser le señor Cruz ne me soit pas difficile à envisager — il était rentré comme prévu après trois jours, épuisé, disait-il, par le trajet en camion jusqu’au fond du Maroc. Il avait l’air content de me revoir.
Il m’a raconté son voyage, qui s’était très bien passé, il avait ramené ses cinq cadavres du côté de Beni Mellal, par chance au même endroit, c’était à la fois pratique et atroce. Comme d’habitude les femmes avaient pleuré horriblement, les youyous lui avaient vrillé les oreilles, les hommes avaient creusé les tombes et voilà. Il avait juste eu le temps de s’arrêter à Casa une nuit pour se taper un bon gueuleton, il disait ces mots avec une telle tristesse dans sa voix fluette, un bon gueuleton , qu’il aurait pu tout aussi bien s’agir de son dernier repas.
Cruz s’est servi un whisky.
Il m’a fait asseoir en face de lui dans un fauteuil, m’a proposé un verre que j’ai refusé.
Il ne disait rien, toute la scène semblait appeler la discussion, les confidences, mais il se taisait ; il buvait son Cutty Sark en me jetant de temps en temps un coup d’œil, je me sentais de plus en plus nerveux.
J’ai essayé de parler, de poser des questions sur son voyage au Maroc, mais ses réponses étaient monosyllabiques, quand il répondait.
Il a terminé son verre, m’en a proposé un autre poliment avant de se resservir.
Au bout d’un interminable quart d’heure de silence, à regarder tour à tour mes genoux et son visage impassible, je suis parti en lui demandant de m’excuser, il fallait que je donne à manger aux chiens ; il m’a fait un signe de tête, accompagné d’un bref sourire.
Une fois dans la cour j’ai soupiré, je tremblais comme une chose fragile. Par la vitre, j’ai vu la grosse figure de Cruz se nimber du bleu électrique de l’écran d’ordinateur et reprendre sa contemplation hébétée des formes de la mort.
Je me suis senti en danger ; la peur m’a pris, puissante, irrationnelle ; je suis allé m’agenouiller entre les clébards, leurs museaux fouillaient mes aisselles, la douceur de leur pelage et leur regard clair m’ont un peu réconforté.
Cruz semblait toujours vaciller ainsi au bord de la parole.
Je n’avais jamais rencontré la folie auparavant, si Cruz était fou — il ne se lançait pas dans des diatribes déraisonnables, ne se frappait pas la tête contre les murs, ne mangeait pas ses excréments, n’était pas pris de délire, de visions ; il vivait dans l’écran, et dans l’écran, il y avait des scènes terribles — de vieilles photos de supplices chinois, où des hommes saignaient, attachés à des poteaux, la poitrine découpée, les membres amputés par des bourreaux aux longs couteaux ; des décapitations afghanes et bosniaques ; des lapidations, des éventrations, des défenestrations et d’innombrables reportages de guerre — après tout la fiction était bien mieux filmée, bien plus réaliste que le documentaire ou les clichés du début du siècle et je me demandais pourquoi, dans ses images, Cruz cherchait surtout la mention “réel” ; il voulait la vérité, mais quelle différence cela pouvait-il bien faire : il avait de vrais cadavres plein sa chambre froide, il les connaissait intimement, il les fréquentait depuis des années et je me demande encore aujourd’hui ce qui pouvait le pousser à cette observation virtuelle maladive, il aurait dû être guéri de la mort et pourtant il ingurgitait des kilomètres d’images de tortures et de massacres, qu’y cherchait-il, une réponse à ses questions, aux questions auxquelles les macchabées ne répondaient pas, une interrogation sur le moment de la mort, sur l’instant du passage, peut-être — ou tout simplement peut-être avait-il été avalé par l’image, les corps lui avaient fait quitter le réel et il fouissait la réalité cybernétique pour y retrouver, en vain, quelque chose de la vie.
Читать дальше