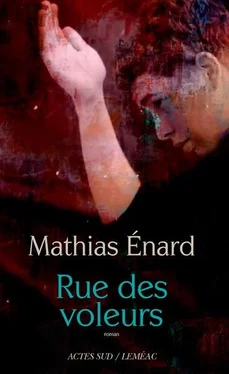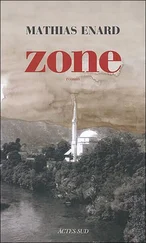C’était un pauvre type, et je ne savais pas s’il m’inspirait de l’horreur ou de la pitié ; il m’exploitait, m’enfermait comme un esclave ; il répandait une terrible tristesse, l’odeur de la pourriture de l’âme dans la solitude.
Il fallait que je m’en aille ; j’ai hésité, la première fois où il m’a laissé me promener un après-midi en ville, à disparaître sans laisser de traces, à monter dans un autobus partant vers le nord ou un ferry pour rentrer au Maroc — mais je n’avais rien, pas d’argent, pas de papiers, il avait conservé mon passeport, que j’avais été assez idiot pour lui donner, et il était probable qu’on m’arrête et me jette en taule avant de m’expulser si j’étais contrôlé.
Je me suis confié à l’Imam de la mosquée qui venait prier pour nos morts ; je lui ai expliqué que ce M. Cruz était plutôt bizarre, ce qu’il n’a pas nié, tout en haussant les épaules avec un air d’impuissance. Il m’a raconté qu’il pensait que mon prédécesseur s’était enfui pour cette excellente raison, parce que Cruz était un être étrange, mais qui avait du respect pour les morts et pour la religion. C’est tout.
Vu d’ici, les longues journées sur l’ Ibn Batouta avaient un goût de paradis.
J’ai envisagé de faire le mur, après tout ce n’était pas si difficile, Cruz n’irait pas jusqu’à me courir après ; mais il me fallait avant tout récupérer mes papiers et de l’argent.
Un jour, M. Cruz est parti à l’aube avec le corbillard ; il est revenu avec une cargaison de morts — dix-sept, une patera avait chaviré au large de Tarifa et le courant avait saupoudré les plages de cadavres. Il était bien content de cette moisson, d’un bonheur bizarre, surtout il ne voulait pas paraître heureux de s’engraisser sur le dos des pauvres crevés, mais je sentais, derrière son masque de circonstance, à sa façon de caresser ses chiens, de me dire mon petit Lakhdar , qu’il était ravi de la reprise des affaires, tout en en ayant honte.
Dix-sept. C’est un petit nombre gigantesque. On ne se rend pas compte, en entendant, à la radio ou à la télévision, le nombre de cadavres laissés par telle ou telle catastrophe ce que représentent dix-sept corps. On se dit ah, dix-sept, ce n’est pas beaucoup, parlez-moi de mille, de deux mille, de trois mille macchabées, mais dix-sept, dix-sept ce n’est rien d’extraordinaire, et pourtant, et pourtant, c’est une quantité énorme de vie disparue, de viande crevée, c’est encombrant, dans la mémoire comme dans la chambre froide, ce sont dix-sept visages et plus d’une tonne de chair et d’os, des dizaines de milliers d’heures d’existence, des milliards de souvenirs disparus, des centaines de personnes touchées par le deuil, entre Tanger et Mombassa.
J’ai enveloppé un par un ces types dans leurs linceuls, en pleurant ; la plupart étaient jeunes, de mon âge, voire moins ; certains avaient les membres brisés ou des ecchymoses sur le visage. La grande majorité paraissait arabe. Parmi ces corps se trouvait celui d’une fille. Elle s’était tatoué au henné un numéro de téléphone sur le bras, un numéro marocain. Elle avait les cheveux longs, très noirs, le visage gris. J’étais gêné ; je ne voulais pas entrevoir ses seins, son sexe ; normalement je n’aurais pas dû la mettre en bière moi-même, c’était une femme qui aurait dû s’en occuper. J’avais peur de mon propre regard sur ce corps féminin ; j’imaginais Meryem morte — c’était elle que je mettais en bière, elle que j’enterrais enfin, seul dans la nuit de mes cauchemars, j’ai imaginé la police appeler à ce numéro de téléphone tatoué, une mère ou un frère décrocher, une voix presque mécanique les informer, en répétant très fort pour être compris, de la fin de leur sœur, de leur fille, tout comme le téléphone avait dû retentir chez mon oncle, un jour, pour annoncer cette terrible nouvelle, comme il sonnera un jour aussi pour nous, les uns après les autres, et tendrement, fraternellement, j’ai disposé cette inconnue dans son sarcophage de métal avec honte et précaution.
Peut-être n’imagine-t-on vraiment la mort qu’en voyant son propre cadavre dans celui des autres, jeunes comme moi, marocains comme moi, candidats à l’exil comme moi.
Le soir j’écrivais des poèmes pour tous ces disparus, des poèmes secrets que je glissais ensuite dans leur cercueil, un petit mot qui disparaîtrait avec eux, un hommage, une ritha’ ; je leur donnais des noms, j’essayais de les imaginer vivants, de deviner leur vie, leurs espoirs, leurs derniers instants. Parfois je les voyais en rêve.
Je n’ai jamais oublié leurs visages.
Ma haine contre Cruz grandissait ; elle était irrationnelle ; à part ma semi-captivité, il n’était pas méchant ; il croulait sous le poids des cadavres ; il avait juste cette étrange perversion qui consistait à regarder, à scruter toute la journée des vidéos extraordinairement violentes ; des égorgements en Afghanistan, des pendaisons datant de la Seconde Guerre mondiale, des accidents de voiture en tout genre, des corps brûlés par un bombardement.
Il me fallait partir au plus vite.
Je regrettais Casanova et mes soldats tous les jours. Je pensais à Judit, je lui envoyais des SMS et je lui téléphonais parfois ; la plupart du temps elle ne répondait pas aux messages ni ne décrochait et j’avais l’impression d’être dans les limbes, dans le barzakh , inatteignable entre la vie et l’au-delà.
Pour tous livres je n’avais que le Coran et deux polars espagnols achetés d’occasion en ville, pas extraordinaires, mais bon, ça faisait passer le temps. Puis j’ai eu trois jours de vacances parce que Cruz est parti livrer un chargement de cadavres de l’autre côté du Détroit. Il ne pouvait pas me laisser enfermé tout ce temps, alors il m’a donné un peu d’argent de poche (jusque-là je n’avais pas encore vu la couleur de mon salaire) pour m’amuser en ville, comme il disait. J’ai passé mes journées aux terrasses des cafés, tranquille, à lire en buvant des petites bières .
Je suis allé relever mes mails et là, surprise : un message du Cheikh Nouredine. Il m’écrivait d’Arabie, où il travaillait pour une fondation pieuse ; il me demandait de mes nouvelles. Je lui ai répondu en lui disant que j’étais en Espagne, sans lui préciser ma triste activité. J’ai hésité à lui raconter l’incendie de la Diffusion de la Pensée coranique, je me demandais s’il était au courant. Sa lettre était sympathique, fraternelle même ; mes soupçons quant à sa possible participation à l’attentat de Marrakech me paraissaient maintenant ridicules, même si le mystère de sa disparition soudaine restait entier — je lui ai demandé s’il savait où se trouvait Bassam.
J’ai repensé avec nostalgie aux longues séances de lecture à la Diffusion, allongé sur les tapis. Tanger était loin, dans un autre monde.
J’ai écrit longuement à Judit pour lui expliquer un peu ma vie de forçat à Algésiras ; je n’ai pas mentionné les cadavres, juste l’entretien, le ménage et l’étrange Cruz. Je lui disais que j’espérais la voir bientôt.
J’ai téléphoné à Saadi, qu’il vienne prendre un café avec moi dans le centre d’Algésiras ; il avait un visa, lui, il pouvait aller et venir comme bon lui semblait, c’était l’injustice de l’administration : plus on était vieux et moins on en avait envie, plus il était facile de se déplacer.
Il était content de me retrouver, et moi aussi. Je lui ai demandé s’il y avait des nouvelles de la compagnie — il m’a expliqué que le gouvernement marocain allait trouver une solution d’un jour à l’autre maintenant. J’étais encore à temps d’en profiter, d’après lui.
Читать дальше