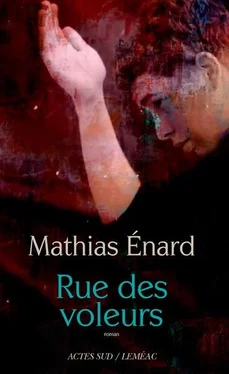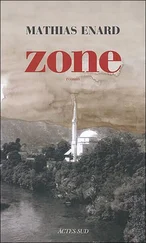De jour, l’activité putassière était présente, mais assez réduite ; de nuit à la belle saison, les touristes étrangers ivres morts se perdaient dans nos ruelles et se laissaient parfois tenter par une jolie négresse qu’ils prenaient par-derrière, dans un coin de porte, à la belle étoile : j’ai souvent vu, tard le soir, le reflet mouvant de fesses blanches déchirer la pénombre des encoignures.
Notre immeuble était au début de la rue des Voleurs, dans sa partie étroite, tout près de la rue Hospital ; c’était un bâtiment typique du quartier, ancien, ruiné ; un de ceux qui, malgré les efforts des propriétaires et de la mairie, paraissaient rétifs à toute rénovation : les marches d’escalier avaient perdu la moitié de leur carrelage, les menuiseries ployaient, les murs se débarrassaient de leur revêtement par grandes plaques dont les débris encombraient les paliers ; les câbles électriques pendaient du plafond, les vieilles douilles en céramique n’avaient plus vu le cul d’une ampoule depuis des lustres et les boîtes aux lettres rouillées, cabossées, bâillaient, disjointes ou grandes ouvertes, quand il leur restait une porte. La cage d’escalier était peuplée de cafards et de rats et il n’était pas rare, en montant la nuit, de surprendre un gros rongeur noir tétant l’aiguille d’une seringue abandonnée, pour en sucer la petite goutte de sang — la bestiole s’enfuyait par le trou d’un mur dans un appartement, et on frissonnait toujours en pensant qu’il pouvait se produire la même chose à notre étage.
Les drogués provenaient du centre d’aide sociale qui leur était réservé un peu plus loin dans la rue, et ils cherchaient un endroit pour se piquer ; beaucoup revendaient dans les rues adjacentes la méthadone que leur fournissait l’administration. Ils entraient dans les immeubles dont les portes fermaient mal, montaient jusqu’où leur condition physique leur permettait d’arriver, parfois jusqu’au toit terrasse, où ils ne risquaient pas d’être délogés par l’habitant, à coups de pied ou de manche à balai. Ils faisaient pitié. La plupart étaient des loques d’une maigreur stupéfiante ; ils avaient des abcès sur les bras, des pustules sur la gueule ; beaucoup parlaient tout seuls, maudissaient, juraient, frappaient dans les boîtes de bière qu’ils vidaient à la chaîne en attendant mieux ; parfois on les voyait tituber, silencieux, l’air béat, sortant d’un bâtiment quelconque, et on savait qu’ils venaient de s’injecter, à la va-vite, assis au milieu des cancrelats, leur dose de bonheur. Quand ils étaient en fonds, ils s’offraient une soupe au restaurant marocain un peu plus loin dans la rue, et y restaient longtemps, à regarder la télé, l’air absent ; les patrons du restau étaient généreux, ils toléraient ces fantômes qui payaient et ne volaient que les petites cuillères — ils leur interdisaient juste les toilettes. Les drogués avaient même un petit parc à eux, un recoin de verdure que personne ne leur disputait, pas même la mairie : un peu plus au sud, tout près du port, contre les remparts de l’Arsenal gothique, derrière un remblai qui devait protéger une ancienne douve se trouvait, deux mètres en contrebas, un carré d’herbe invisible de la rue — les préposés à la propreté municipale y descendaient peu souvent, et même les flics, partant du principe que tout ce qui est invisible n’est pas gênant et donc n’existe pas, n’y emmerdaient que rarement les toxicomanes. Il y avait des femmes et des hommes, même s’il était parfois difficile de savoir à quel sexe ils appartenaient ; ils vivaient entre eux, s’engueulaient entre eux, mouraient entre eux, et s’ils n’étaient pas les plus élégants ni les plus propres des habitants du quartier, ils comptaient, avec les rongeurs et les insectes, parmi les plus anodins.
Même si parfois, comme un chien acculé peut montrer les dents et essayer de mordre un agresseur, on en voyait certains devenir violents ; je me souviens d’une crise de folie incroyable, un jour, alors que j’étais tranquillement au balcon à observer l’animation de la rue, un de ces types est sorti du bocal à méthadone en rage ; il s’est mis à crier, puis à hurler des imprécations incompréhensibles, à frapper du poing contre le mur, puis contre un Pakistanais qui passait par là et qui n’a pas compris ce qui lui valait ce déluge de gnons ; deux personnes sont arrivées à sa rescousse : malgré sa maigreur, le drogué était d’une force incommensurable, presque divine, trois hommes jeunes ne parvenaient pas à le maîtriser mais juste à lui arracher, en essayant de le ceinturer, ses vêtements beaucoup moins résistants que lui — son tee-shirt s’est déchiré d’abord, puis sa ceinture a lâché, il se débattait comme un démon et envoyait bouler ses agresseurs à grands coups de pied vengeurs dans les tibias, dans les couilles, jusqu’à n’être plus qu’en slip, il se battait en slip comme un guerrier dérisoire, fin et maigre, les jambes couvertes de plaies, les bras bardés de croûtes et de tatouages, et il a fallu cinq personnes, deux flics et une ambulance pour en venir à bout : les cognes ont réussi à le menotter, les hommes en blanc l’ont piqué avant de l’attacher sur une civière et de l’emmener Dieu sait où — il y avait une vraie beauté triste dans ce dernier combat du pauvre homme nu dépossédé de son cerveau et de son corps par l’héroïne ; il se battait contre lui-même, contre Dieu et les services sociaux, qui pour lui étaient identiques.
Les putains aussi faisaient pitié, mais dans un autre genre. Certaines étaient de vraies teignes, des louves acides et dangereuses qui n’hésitaient pas à détrousser les clients ou à éborgner à coups d’ongles un mauvais payeur ; elles insultaient copieusement les mâles qui refusaient leurs avances, les traitaient de pédés, de lopettes, d’impuissants. La plupart venaient d’Afrique, mais il y avait aussi quelques Roumaines et même une ou deux Espagnoles, dont celle qui était assise sous un porche à l’entrée de la rue, Maria, un peu la concierge de notre palais. Maria avait la quarantaine, plutôt ronde, assez souriante, pas très jolie mais sympathique ; elle était assise là devant sa porte tous les après-midi et tous les soirs ; elle écartait les jambes et nous montrait son string en nous appelant ses petits chéris quand on passait devant elle : je répondais toujours poliment bonjour Maria en matant vite fait son con, ça ne faisait de mal à personne, c’étaient des relations de bon voisinage. Je n’ai jamais osé monter avec elle — à cause de la différence d’âge, d’abord, qui m’intimidait, et du souvenir de Zahra la petite pute de Tanger qui m’attristait. La plupart des clients réguliers étaient des immigrés, des étrangers fauchés qui marchandaient le prix de la passe, ce qui faisait hurler Maria : elle crachait par terre en gueulant comme un veau mais va donc voir les négresses, à ce prix-là ! Dans le cul aussi, c’était la crise, faut croire. Maria vivait avec un type qui était camionneur, ou marin, je ne sais plus — en tout cas il n’était pas là souvent. Les Africaines avaient des macs, des mafieux à qui elles avaient vendu leur corps dès leur pays d’origine, pour le prix du passage en Europe : j’ignore combien de temps elles devaient se faire mettre par les pauvres et les touristes avant de retrouver leur liberté — si elles la retrouvaient un jour.
Il y avait aussi un réparateur de vélos, un entrepôt de volailler, des frigos clandestins pour les Pakis vendeurs de bières, des entrepôts de roses pour les Pakis vendeurs de roses, des familles de Marocains pauvres, des familles de Bengalis pauvres, de vieilles dames espagnoles (qui connaissaient le quartier depuis avant-guerre et expliquaient qu’à part la nationalité des putains et des voleurs peu de choses avaient changé) et de jeunes clandestins comme nous, pour la plupart marocains, certains mineurs, des gosses qui traînaient dans l’attente d’un mauvais coup pour se désennuyer autant que pour se faire un peu de blé : dépouiller les touristes, leur vendre du faux hasch ou tirer un vélo.
Читать дальше