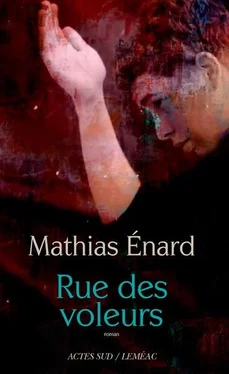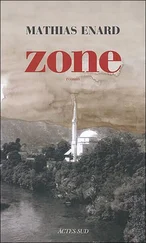alors que nous contemplions le Détroit, sans oser nous prendre par la main, et surtout la suite,

l’errance parmi les stations de la folie — les yeux de Judit étaient pour le coup, comme le disait ce poète pour dames, les derniers bateaux en partance. Je me souviens, Meryem s’inquiétait ; elle avait peur de notre relation, peur des conséquences, peur, peur de ce que je pouvais lui faire faire ; elle ne savait quelle solution trouver à cet amour adolescent, elle hésitait à se confier à sa mère, après tout elle-même n’était-elle pas mariée à son cousin germain et je me rappelle qu’un jour, alors que j’avais semé Bassam pour la retrouver, loin du quartier, elle me disait craindre que je l’abandonne pour émigrer, j’essayais alors de la rassurer avec les vers de Kabbani, et la vérité, si elle existe, c’est que je me souciais de Meryem comme d’une guigne, d’elle, je veux dire d’elle beaucoup moins que de la satisfaction de mon désir, de ma jouissance, de réussir à la déshabiller, à la caresser et lorsque j’ai enfin compris, après avoir lu sa dernière lettre, dans cette vieille enveloppe récupérée chez Bassam, lorsque j’ai enfin compris que j’étais responsable de sa mort, là-bas dans ce village perdu, de son hémorragie au cours d’un avortement paysan et clandestin, parce que je n’avais pas répondu à son désespoir, pas plus qu’à celui de sa mère, morte de tristesse quelques semaines après, dans ce paradis du Maroc moderne où en théorie aucune femme ne saigne à mort ni ne se suicide jamais ni même ne souffre jamais sous les coups d’aucun mâle car Dieu la famille et les traditions veillent sur elles et rien ne peut les atteindre, si elles sont décentes, si seulement elles étaient décentes, comme disait si bien le Cheikh Nouredine qui lui savait la vérité, comme tout le quartier l’avait apprise, Bassam en tête ; lorsque j’ai su que je ne pouvais plus échapper à cette réalité car elle était aussi sordide et tangible que le chiffre sur un billet de banque, aussi précise et réelle que l’abeille butinant la fleur de safran sur la nouvelle pièce de dix centimes que je rendais avec chacun des livres que je vendais ; quand la mort, figée et immuable tout autant que ces monnaies m’attrapa par l’oreille pour me dire ô mon gars, tu as raté une marche, voici dix-huit mois que tu vis en m’ignorant, il fallait que le monde, que mon monde, soit déjà bien détruit pour ne pas se ruiner encore plus, après cette déflagration ; il fallait qu’il y ait à mes côtés Judit pour que je ne me laisse pas aller aux sanglots, une fois la surprise passée : tout cela confirmait une intuition ; bien sûr moi aussi je savais, mon corps savait, mes rêves savaient même si à ce moment-là, au moment de la disparition de Meryem au bout du Rif, j’étais en train de me faire tabasser dans un commissariat à Casa ou de mendier une pomme sur un marché — mes cauchemars, élucidés, n’en sont devenus que plus douloureux, plus clairs, plus insupportables encore ; ma conscience, plus confuse et toujours moins sûre d’elle, pétrie de regrets et de cette terrible sensation, qui pouvait me tirer des larmes de peine honteuse, avoir, en rêve, pendant des mois, couché avec une morte : avec Meryem qui disparaissait dans le cercueil mangeur de chair quand je la voyais bien vivante au fil des saisons ; elle m’avait accompagné alors qu’elle n’était plus et cela était si mystérieux, si incompréhensible dans mon cœur encore jeune que j’y voyais une trahison dégueulasse, une saloperie plus grande que ma responsabilité dans son décès, une haine qui se retournait contre Bassam, contre ma famille, contre ceux qui m’avaient empêché de pleurer Meryem et m’avaient contraint à la désirer crevée — comme on retire doucement le linceul d’un cadavre pour observer ses seins. Sur la table de marbre, j’avais rêvé de son ventre et de son pubis froids. Elle était là, la honte, là, dans ce glissement du temps ; le temps est une femme de cimetière, une femme en blanc, qui lave des corps d’enfants.
Je m’achetais des chemises le dos courbé, pressentant une catastrophe, sans savoir qu’elle avait déjà eu lieu. J’attribuais ma fébrilité à l’incendie, à l’arrivée de Judit, à l’attentat et à la disparition de Bassam, sans sentir que le plus grave était déjà là ; j’hésitais devant un pyjama, longuement, en espérant que Judit me voie dedans ; j’avais une pensée fugace, un peu attristée tout de même, pour la seule femme qui ne m’avait jamais vu nu, sans savoir qu’elle n’existait plus.
La soirée fut des plus longues.
La solitude et l’attente.
Je traînais sur Internet pour avoir des nouvelles, des nouvelles de qui que ce soit, de Bassam, du Cheikh Nouredine, de Judit, du monde, de Libye, de Syrie. Les flammes étaient plus hautes que jamais. Je suis sorti faire un tour ; la nuit était tiède, il y avait foule en ville, Tanger savait, au printemps, être troublante et dangereuse. Tout y était tourné contre moi ; l’odeur de brûlé m’était restée dans les narines et cachait celle de la mer. Les jeunes gens marchaient trois par trois, quatre par quatre avec des airs fébriles, en roulant des épaules ; au détour d’une rue, j’ai vu un type de mon âge à moitié fou se mettre à attaquer violemment un arbre en pot, le balancer par terre en hurlant des insultes, sans raison, avant d’être à son tour pris à coups de poing par le propriétaire d’une boutique, sorti en trombe de son établissement — le sang a giclé sur son tee-shirt blanc, il a porté la main à son visage, l’air ébahi, avant de s’enfuir en criant. Je m’en souviens, l’arbre était un oranger ou un citronnier, il avait de petites fleurs blanches, le patron du magasin l’a redressé dans son pot en le caressant comme s’il s’agissait d’une femme ou d’un enfant, je crois même qu’il lui parlait.
J’étais à deux pas de la librairie française, j’y suis entré ; j’ai regardé un peu les rayonnages, ces livres sérieux étaient intimidants, chers et intimidants, on hésitait à les ouvrir de peur de tacher les couvertures crème, d’endommager la reliure. Il y avait une section de littérature tangéroise, et ils étaient tous là, les auteurs que Judit avait évoqués : Bowles, Burroughs, Choukri bien sûr, mais aussi un Espagnol du nom d’Ángel Vázquez, qui avait écrit un roman appelé La Chienne de vie de Juanita Narboni — ce que je cherchais dans les livres c’était plutôt oublier ma chienne de vie à moi, oublier Tanger ; j’ai trouvé le rayon “romans policiers”, il y avait surtout d’énormes bouquins dont le format me paraissait gigantesque, disproportionné par rapport à mes vieilles Série Noire parties en fumée, tout aussi intimidants que les romans sérieux. Je suis sorti un peu triste de ne pas avoir trouvé une compagnie, un livre inconnu qui ait le pouvoir de changer le cours des choses, de remettre le monde en ordre ; je me sentais minuscule face à la vraie littérature. Je suis descendu vers la mer, j’ai pensé à Bassam ; s’il était vraiment complice de l’attentat de Marrakech, je me suis demandé si je le reverrai jamais.
Les enseignes des bars me clignaient de l’œil, des types étaient assis sur des chaises et profitaient du printemps ; ils avaient des têtes de contrebandiers. Je n’aurais jamais pu être aussi loin de chez moi, même à Barcelone, à Paris ou à New York ; ces rues respiraient quelque chose d’interdit dans le soir dangereux, si loin des quartiers de mon enfance, si loin de cette enfance dont je sortais à peine et que les venelles en pente me remettaient en mémoire pour leur radicale différence. Je me demandais si j’oserais jamais entrer dans un de ces rades aux lumières rouges sentant la cigarette, le désir et la déréliction, si j’aurais jamais l’âge de ces endroits. Après tout j’avais un peu d’argent, maintenant, et bien envie de boire un coup, peut-être même de parler à quelqu’un. J’appréciais l’alcool pour l’image qu’il donnait de moi, celle d’un type dur, adulte, qui ne craint ni la colère de sa mère ni celle de Dieu, un personnage, comme ceux auxquels je souhaitais ressembler, les Montale, les détectives sans nom, les Marlowe, les privés et les flics de romans noirs. Pourquoi nous accrochons-nous à ces images qui nous fabriquent, ces exemples qui nous modèlent et savent nous briser tout en nous construisant, l’identité toujours en mouvement, l’être à jamais en formation, et ma solitude devait être si grande ce soir-là que je suis entré dans un bar minuscule appelé El Pirata , dont l’enseigne marronnasse avait dû connaître les temps glorieux du statut international, et la tenancière aussi, une dame aux cheveux défrisés teints en blond platine qui m’observait en se demandant sans doute si j’avais bien l’âge d’être là. J’ai salué, je me suis assis au comptoir sur un tabouret, j’ai commandé une bière. La patronne m’a regardé comme pour me gronder, mais m’a servi. Je me suis demandé ce qu’elle imaginait, comment un jeune plouc comme moi arrivait-il là, tout seul ; peut-être qu’elle n’imaginait rien du tout. À peine cinq minutes plus tard, une fille est sortie de derrière un rideau, elle était d’une maigreur de fouet, les jambes osseuses dans ses collants noirs, les joues pâles malgré le maquillage, elle s’est hissée sur un siège à mes côtés, j’étais entré dans ce rade, il fallait faire avec ; ou peut-être étais-je entré précisément pour ça, pour parler avec quelqu’un, entraîneuse ou putain, contrairement aux personnages de mes romans j’ai détourné les yeux, un peu honteux, elle s’appelait Zahra, du moins c’est ce qu’elle disait ; elle avait des marques sur le visage, des lèvres tout étroites, elle sentait le jasmin, et sous le parfum ses vêtements exhalaient l’encens de cèdre du salon où je me suis laissé entraîner par la main dix minutes plus tard, un sofa verdâtre luisait d’usure sous une lampe halogène réglée au minimum, Zahra s’est assise et a défait les boutons de son chemisier, elle portait un soutien-gorge blanc dont les dentelles bâillaient, découvrant ses seins minuscules aux aréoles très sombres, elle m’a dit donne-moi deux cents dirhams, fouiller dans ma poche m’a permis de ne pas la regarder un instant, je lui ai tendu l’argent elle l’a mis sous un coussin du divan, elle a écarté les jambes et relevé sa jupe pour me montrer son sexe rasé à la peau presque noire, assortie aux lisières des bas qui barraient ses cuisses osseuses, j’étais partagé entre la honte et le désir, elle m’a fait signe d’approcher, je n’ai pas bougé, elle a murmuré viens, n’aie pas peur, elle m’a attrapé la main pour la coller sur sa poitrine tout en me caressant l’entrejambe, son haleine remontait le long de mon ventre, elle a commencé à essayer de défaire ma ceinture j’ai reculé d’un pas en la repoussant ; elle m’a regardé d’un drôle d’air, c’est finalement la honte qui a pris le dessus, je suis sorti. La dame derrière le bar a ricané “déjà ?”, je ne me suis même pas retourné.
Читать дальше