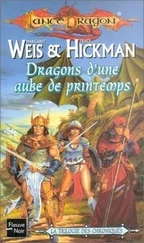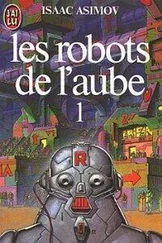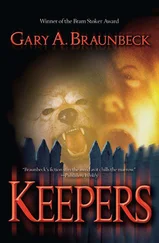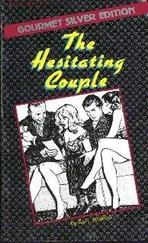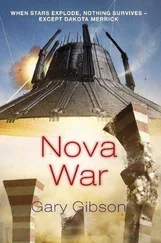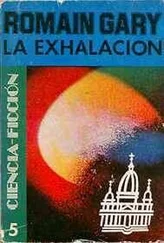L'escadre d'entraînement dont je faisais partie fut transférée à Bordeaux-Mérignac et je passai de cinq à six heures par jour en l'air comme instructeur de navigation sur Potez-540. Je fus vite nommé sergent, la solde était suffisante, la France tenait bon et je partageais l'opinion générale de mes camarades qu'il fallait profiter de la vie et avoir du bon temps, puisque la guerre n'allait pas durer éternellement. J'avais une chambre en ville et trois pyjamas de soie dont j'étais très fier. Ils représentaient à mes yeux la grande vie et me donnaient le sentiment que ma carrière d'homme du monde progressait favorablement; une camarade de la Faculté de Droit les avait volés exprès pour moi, après l'incendie d'un grand magasin où son fiancé était employé. Mes rapports avec Marguerite étaient purement platoniques et la morale avait donc été scrupuleusement respectée dans l'affaire. Les pyjamas étaient légèrement roussis et ils sentirent jusqu'au bout le poisson fumé, mais on ne peut pas tout avoir. Je pus également m'offrir de temps en temps une boîte de cigares, que je parvenais à présent à supporter sans avoir mal au cœur, ce qui me rassurait beaucoup en me prouvant que j'étais vraiment en train de m'aguerrir. Bref, ma vie prenait tournure. J'eus cependant à cette époque un accident d'avion assez ennuyeux, qui faillit bien me coûter mon nez, ce dont je me serais difficilement consolé. Ce fut, naturellement, la faute des Polonais. Les militaires polonais n'étaient pas alors très populaires en France: on les méprisait un peu, parce qu'ils avaient perdu la guerre. Ils s'étaient fait battre à plate couture et on ne leur cachait pas ce qu'on pensait d'eux. De plus, l'espionnite commençait à sévir, comme dans tous les organismes sociaux malades, et chaque fois qu'un soldat polonais allumait une cigarette, on l'accusait immédiatement d'échanger des signaux lumineux avec l'ennemi. Comme je connaissais parfaitement le polonais, je fus utilisé comme interprète au cours des vols en double commande, dont le but était de familiariser les équipages polonais avec notre matériel volant. Debout entre les deux pilotes, je traduisais les conseils et les ordres de l'instructeur français. Le résultat de cette conception originale du travail aérien ne se fit pas attendre. Au moment de l'atterrissage, le pilote polonais ayant été trop long dans la prise du terrain, le moniteur me cria avec une pointe d'anxiété:
– Dis à ce veau qu'il va se vomir dans la nature. Qu'il remette les gaz!
Je traduisis immédiatement. Je peux affirmer, la conscience tranquille, que je ne perdis pas une seconde en disant:
– Prosze dodac gazu bo za chwile zawalimy sic w drzewa na koncu lotniska!
Lorsque je repris mes esprits, le sang ruisselait sur ma figure, les infirmiers se penchaient sur nous, et l'adjudant-chef polonais, en fort piteux état, mais toujours courtois, essayait de se soutenir sur un coude et de présenter ses excuses au pilote français:
– Za pozni mi pan przytlumaczyl!
– Il dit… bégayai-je.
Le sergent-chef, assez mal en point lui-même, eut le temps de nous souffler:
– Merde! avant de s'évanouir. Je traduisis fidèlement, après quoi, mon devoir accompli, je me laissai aller. Mon nez était en capilotade, mais à l'infirmerie, les dégâts internes furent jugés peu graves. En quoi on se trompait. Je souffris du nez pendant quatre ans et je dus dissimuler mon état et les migraines atroces qui me harcelaient sans répit pour ne pas être radié du personnel navigant. Ce fut seulement en 1944 que mon nez fut entièrement refait dans un hôpital de la R.A.F. II n'est plus le chef-d'œuvre incomparable qu'il était auparavant, mais il fait l'affaire et j'ai tout lieu de croire qu'il durera ce qu'il faudra.
En dehors de mes heures de vol comme navigateur, mitrailleur et bombardier, mes camarades me laissaient souvent les commandes en l'air et je faisais ainsi en moyenne une heure de pilotage par jour. Ces heures précieuses n'avaient malheureusement aucune existence officielle et ne pouvaient même pas figurer sur mon carnet de vol. Je tins donc un deuxième carnet, clandestin, celui-là, légalisant scrupuleusement chaque page avec le tampon de l'escadre, grâce à l'obligeance du chef de bureau. J'étais convaincu qu'après les premières pertes de la guerre, le règlement allait être relâché et mes heures clandestines, une bonne et grasse centaine, me permettraient d'être transformé en pilote de combat.
Le 4 avril 1940, à quelques semaines donc à peine de l'offensive allemande, alors que je fumais paisiblement un cigare sur le terrain, un planton me tendit un télégramme: «Mère gravement malade. Venez immédiatement.»
Je restai là, le cigare idiot aux lèvres, avec ma veste de cuir, ma casquette sur l'œil, mon air dur, mes mains dans les poches, cependant que la terre entière devenait soudain un lieu inhabité. C'est de cela que je me souviens surtout aujourd'hui: une sensation d'étrangeté, comme si les lieux les plus familiers, le sol, les maisons et toutes les certitudes fussent devenus autour de moi une planète inconnue où je n'avais jamais mis les pieds auparavant. Tout mon système de poids et mesures s'écroulait d'un seul coup. J'avais beau me dire que les belles histoires d'amour finissent toujours mal, j'avais cru malgré tout que la mienne finirait mal aussi, mais après justice rendue. Que ma mère pût mourir avant que j'eusse le temps de me jeter dans le plateau de la balance pour la redresser, pour retablir l'équilibre et démontrer ainsi clairement, irréfutablement, l'honorabilité du monde, témoigner de l'existence, au cœur des choses, d'un dessein honnête et secret me paraissait une négation de la plus humble, de la plus élémentaire dignité humaine, comme une interdiction de respirer. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, on a compris.
Il me fallut quarante-huit heures pour arriver à Nice, par le train des permissionnaires. Le moral de ce train bleu horizon était au plus bas. C'était l'Angleterre qui nous avait entraînés là-dedans, on allait se faire mettre jusqu'au trognon, Hitler était un type pas si mal que ça qu'on avait pas compris et avec qui on aurait dû causer, mais il y avait tout de même un point clair dans le ciel: on avait inventé un nouveau médicament qui guérissait la blemorragie en quelques jours.
Cependant, j'étais loin d'être désespéré. Je ne le suis même pas devenu aujourd'hui. Je me donne seulement des airs. Le plus grand effort de ma vie a toujours été de parvenir à désespérer complètement. Il n'y a rien à faire. Il y a toujours en moi quelque chose qui continue à sourire.
J'arrivai à Nice au petit matin et me précipitai au Mermonts. Je montai au septième et frappai à la porte. Ma mère occupait la plus petite chambre de l'hôtel: elle avait les intérêts du patron à cœur. J'entrai. La chambre minuscule, triangulaire, avait un air bien fait et inhabité qui me terrifia complètement. Je me précipitai en bas, réveillai la concierge et appris que ma mère avait été transportée à la clinique Saint-Antoine. Je sautai dans un taxi.
Les infirmières me dirent plus tard qu'en me voyant entrer elles avaient cru à une attaque à main armée.
La tête de ma mère était enfoncée dans l'oreiller, son visage était creusé, inquiet, et désemparé. Je l'embrassai et m'assis sur le lit. J'avais toujours mon cuir sur le dos, et ma casquette sur l'œil: j'avais besoin de cette carapace. Il m'arriva pendant cette permission de garder un mégot de cigare serré pendant plusieurs heures entre mes lèvres: j'avais besoin de me ramasser autour de quelque chose. Sur la table de chevet, bien en évidence dans son écrin violet, il y avait la médaille d'argent gravée à mon nom que j'avais gagnée au championnat de ping-pong, en 1932. Nous restâmes là une heure, deux heures sans nous parler. Puis elle me demanda d'aller tirer les rideaux. Je tirai les rideaux. J'hésitai un moment et puis je levai les yeux au ciel, pour lui éviter d'avoir à me le demander. Je demeurai ainsi un bon coup, les yeux levés à la lumière. C'était à peu près tout ce que je pouvais faire pour elle. On resta là, tous les trois, en silence. Je n'avais même pas besoin de me tourner vers elle pour savoir qu'elle pleurait. Et je n'étais même pas sûr que c'était de moi qu'il s'agissait. Puis j'allai m'asseoir dans le fauteuil en face du lit. J'ai vécu dans ce fauteuil quarante-huit heures. Je gardai presque tout le temps ma casquette et mon cuir et mon mégot: j'avais besoin d'amitié. A un moment, elle me demanda si j'avais des nouvelles de ma Hongroise, Ilona. Je lui dis que non.
Читать дальше