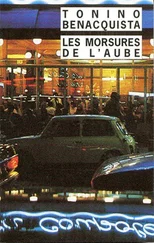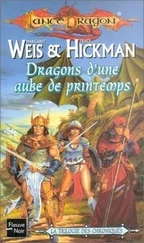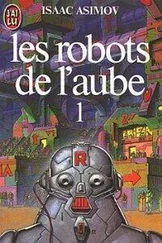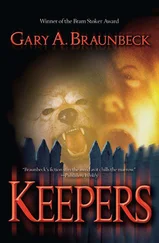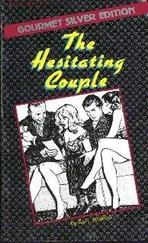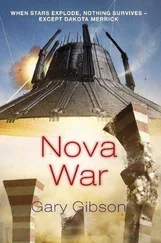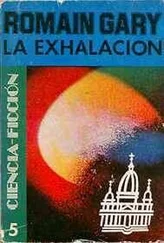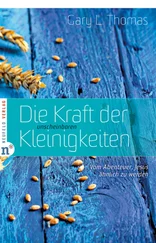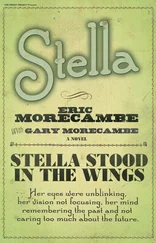Mais il est encore plus difficile de se resigner. Combien de fois me suis-je trouvé, depuis mes débuts dans la carrière d'artiste, la plume à la main, plié en deux, accroché au trapèze volant, les jambes en l'air, la tête en bas, lancé à travers l'espace, les dents serrées, tous les muscles tendus, la sueur au front, au bout de l'imagination et de la volonté, à la limite de moi-même, cependant qu'il faut encore conserver le souci du style, donner une impression d'aisance, de facilité, paraître détaché, au moment de la plus intense concentration, léger au moment de la plus violente crispation, sourire agréablement, retarder la détente et la chute inévitable, prolonger le vol, pour que le mot «fin» ne vienne pas prématurément comme un manque de souffle, d'audace et de talent, et lorsque vous voilà enfin de retour au sol, avec tous vos membres miraculeusement intacts, le trapèze vous est renvoyé, la page redevient blanche, et vous êtes prié de recommencer.
Le goût de l'art, cette obsédante poursuite du chef-d'œuvre, malgré tous les musées que j'ai fréquentés, tous les livres que j'ai lus et tous mes propres efforts au trapèze volant, demeure pour moi, à ce jour, un mystère aussi obscur qu'il l'était il y a trente-cinq ans, lorsque je me penchais du toit sur l'œuvre inspirée du plus grand pâtissier de la terre.
Pendant que je procédais ainsi, côté cour, à mes premiers contacts avec l'art, côte jardin, ma mère se livrait à une prospection systématique pour tenter de découvrir en moi la pépite secrète de quelque talent caché. Le violon et la danse tour à tour écartés, la peinture mise hors de course, on me donna des leçons de chant et les grands maîtres de l'Opéra local furent invités à se pencher sur mes cordes vocales, afin de juger si je n'avais pas en moi la graine de quelque Chaliapine futur, promis aux acclamations des foules dans un décor de lumière, de pourpre et d'or. A mon vif regret, je suis obligé de reconnaître aujourd'hui, après trente ans d'hésitation, qu'il y a entre moi et mes cordes vocales un malentendu complet. Je n'ai pas d'oreille et pas de voix. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé, mais il me faut bien reconnaître ce fait. Je n'ai pas, notamment, cette voix de basse qui m'irait si bien: pour une raison ou une autre, c'est Chaliapine hier et Boris Christoff aujourd'hui qui se sont trouvés dotés de ma voix. Ce n'est pas là le seul malentendu dans ma vie, mais celui-là est de taille. Je suis incapable de dire à quel moment, à la suite de quelle sinistre manipulation, la substitution a eu lieu, mais c'est ainsi, et ceux qui veulent connaître ma véritable voix sont invités à acheter un disque de Chaliapine. Ils n'ont qu'à écouter La Puce , de Moussorgsky, en particulier: c'est tout à fait moi. Ils n'ont qu'à m'imaginer, debout sur la scène, faisant «Ha! Ha! Ha! blokha !» de ma voix de basse, et je suis sûr qu'ils seront de mon avis. Malheureusement, ce qui sort de ma gorge, lorsque, mettant une main sur ma poitrine, le pied en avant et la tête haute, je laisse libre cours à ma puissance vocale, est pour moi une source constante d'étonnement et de tristesse. Encore cela n'aurait-il guère d'importance, si je n'avais pas la vocation. Or, je l'ai. Je ne l'ai jamais dit à personne, pas même à ma mère, mais à quoi bon le cacher plus longtemps? C'est moi, le vrai Chaliapine. Je suis une grande basse tragique incomprise et je le demeurerai jusqu'à la fin de mes jours. Je me souviens qu'au cours d'une représentation de Faust au Metropolitan de New York, je me tins assis près de Rudolf Bing dans sa loge de directeur, les bras croisés, le sourcil méphistophélique, un sourire énigmatique aux lèvres, pendant qu'une doublure, en scène, faisait dans mon rôle ce qu'elle pouvait, et je trouvais quelque chose de tout à fait piquant dans l'idée qu'il y avait là, à côté de moi, un des plus grands impresarii d'opéra du monde, et qu'il ne savait pas. Si Bing, ce soir-là, s'est étonné de mon air diabolique et mystérieux, qu'il veuille bien en trouver aujourd'hui, ici, l'explication.
Ma mère était passionnée d'opéra, elle avait pour Chaliapine une admiration presque religieuse, et je suis sans excuses. Combien de fois à huit, neuf ans, ayant interprété comme il convenait le regard tendre et rêveur qu'elle posait sur moi, ai-je couru me réfugier dans le dépôt de bois, et là, ayant aspiré l'air et pris la pose, je poussais du fond de mes entrailles un ha! ha! ha! blokha ! à faire trembler le monde. Hélas! Ma voix m'avait préféré un autre.
Personne n'a appelé le génie vocal avec plus de ferveur, plus de chaudes larmes que l'enfant que j'étais. S'il m'avait été donné une fois, une seule, de paraître devant ma mère, installée triomphalement dans sa loge, à l'Opéra de Paris, ou même, plus modestement, à la Scala de Milan, devant un parterre éblouissant, dans mon grand rôle de Boris Godounov, je crois que j'eusse donné un sens à son sacrifice et à sa vie. Ça ne s'est pas trouvé. Le seul exploit que je pus accomplir pour elle fut de gagner le championnat de Nice de ping-pong, en 1932. J'ai gagné le championnat une fois, mais j'ai été battu depuis régulièrement.
Les leçons de chant furent donc rapidement abandonnées. Un de mes professeurs me qualifia même, assez perfidement, d' «enfant prodige»: il prétendait n'avoir jamais rencontré, dans sa carrière, un gosse aussi dépourvu d'oreille et de talent.
Je mets souvent le disque de La Puce de Chaliapine sur mon phono et j'écoute ma voix véritable avec émotion.
Forcée ainsi à admettre que je ne manifestais aucune disposition spéciale, ni talent caché, ma mère finit par conclure, comme tant d'autres mères avant elle, qu'il ne me restait plus qu'une solution: la diplomatie. Une fois cette idée ancrée dans son esprit, elle se ragaillardit considérablement. Cependant, comme il me fallait toujours ce qu'il y avait de plus beau au monde, il fallait que je devinsse ambassadeur de France – elle n'était pas disposée à prendre moins.
L'amour, l'adoration, je devrais dire, de ma mère, pour la France, a toujours été pour moi une source considérable d'étonnement. Qu'on me comprenne bien. J'ai toujours été moi-même un grand francophile. Mais je n'y suis pour rien: j'ai été élevé ainsi. Essayez donc d'écouter, enfant, dans les forêts lituaniennes, les légendes françaises; regardez un pays que vous ne connaissez pas dans les yeux de votre mère, apprenez-le dans son sourire et dans sa voix émerveillée; écoutez, le soir, au coin du feu où chantent les bûches, alors que la neige, dehors, fait le silence autour de vous, écoutez la France qui vous est contée comme Le Chat botté; ouvrez de grands yeux devant chaque bergère et entendez des voix; annoncez à vos soldats de plomb que du haut de ces pyramides quarante siècles les contemplent; coiffez-vous d'un bicorne en papier et prenez la Bastille, donnez la liberté au monde en abattant avec votre sabre de bois les chardons et les orties; apprenez à lire dans les fables de La Fontaine – et essayez ensuite, à l'âge d'homme, de vous en débarrasser. Même un séjour prolongé en France ne vous y aidera pas.
Il va sans dire qu'un jour vint où cette image hautement théorique de la France vue de la forêt lituanienne, se heurta violemment à la réalité tumultueuse et contradictoire de mon pays: mais il était déjà trop tard, beaucoup trop tard: j'étais né.
Dans toute mon existence, je n'ai entendu que deux êtres parler de la France avec le même accent: ma mère et le général de Gaulle. Ils étaient fort dissemblables, physiquement et autrement. Mais lorsque j'entendis l'appel du 18 juin, ce fut autant à la voix de la vieille dame qui vendait des chapeaux au 16 de la rue de la Grande-Pohulanka à Wilno, qu'à celle du Général que je répondis sans hésiter.
Читать дальше