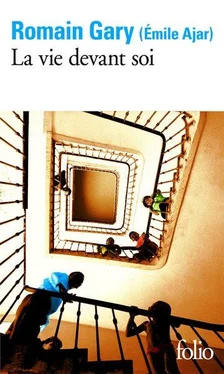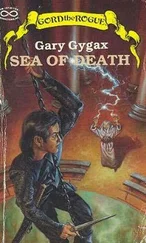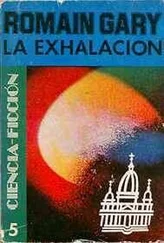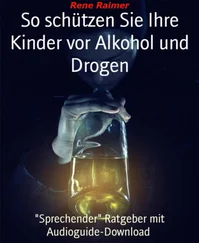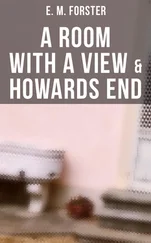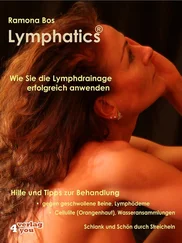La Vie devant soi,
reçut le prix Goncourt que Gary avait déjà obtenu en 1956 pour Les Racines du ciel.
Ajar-Pavlowitch le refusa le 20, sur ordre de Gary. Tout cela dans une atmosphère très mouvementée, d’autant plus qu’au même moment un collectif intitulé G. I. C. L. E. où figurait Jean-Edern Hallier, écrivain-provocateur doué dans les deux registres, manifestait à grand bruit pour l’abolition des prix littéraires et organisait un anti-prix Goncourt. Toujours est-il que le livre d’Ajar, en dépit du refus de son auteur, resta primé par l’Académie Goncourt, que la photo de Pavlowitch fit son chemin et qu’un journaliste finit par découvrir sa véritable identité. Le 22 novembre, La Dépêche du midi
révéla qu’Émile Ajar était le pseudonyme de Paul Pavlowitch installé dans un petit village du Lot, Caniac-du-Causse, près de Cahors, et qu’il était parent de Romain Gary. La manœuvre avait fini par se retourner contre son auteur et Paul était beaucoup trop proche de lui pour qu’il ne fût pas enfin soupçonné. De plus son petit-cousin avait pris des initiatives qu’il lui reprocha ; comment en empêcher d’autres ? Et par-dessus le marché ce deuxième prix Goncourt. Qui d’un côté le réjouit : il avait réussi la démonstration qu’il voulait faire par rapport à un milieu littéraire parisien qui le sous-estimait. Mais qui d’un autre côté le consterna, car nul ne peut concourir deux fois pour le prix Goncourt. Par son silence, il était donc en infraction et se mit à craindre d’éventuelles poursuites. (Pour la fin de ce feuilleton on se reportera à la notice de Pseudo
. — à paraître à l’atelier Panik.)
Le roman
On aura remarqué plus haut l’expression « langue ajar », c’est bien cela qui sidère, au sens fort, et enchante le lecteur qui aborde le premier chapitre et même la première page de La Vie devant soi. Cette impression d’entrer dans un monde nouveau par la magie d’une écriture radicalement nouvelle, Impression rare. La nouveauté d’un univers romanesque venant généralement d’autres explorations, où le style importe, évidemment, mais où la langue n’est pas à ce point l’élément premier. L’invention d’une langue dans la langue, métier de poète, n’appelle chez les romanciers que quelques noms, Proust, Céline, Queneau…
Le premier choc s’était produit avec Gros-Câlin, dont le héros narrateur, nommé Cousin, héberge un serpent (sans doute un avatar de Pete, le python ébauché, mais prometteur, de Chien Blanc) Celui-ci veut écrire un traité sur les pythons, ce qui se trouve être, quoique de façon assez lâche, l’objet du livre lui-même dont la forme, en rapport avec les nœuds du python et les siens propres, se révèle spectaculaire. Cela permet à son auteur d’énoncer un art poétique plus large, valable pour toute l’œuvre d’Ajar : « Je dois donc m’excuser, dit Cousin, rit Gary, de certaines mutilations, mal-emplois, sauts de carpe, entorses, refus d’obéissance, crabismes, strabismes et immigrations sauvages du langage, syntaxe et vocabulaire. » La phrase comporte tout de même deux néologismes, une image peu compatible avec la reptation du python, mais carpe et crabe ne sont pas sans point commun, de même que le strabisme et le crabisme qui désignent des trajectoires physiques anormales, comme celles qu’impose aussi la souffrance des entorses et mutilations, tandis que refus d’obéissance et immigration sauvage se rejoignent dans la contestation de l’ordre public. Tout Ajar expliqué aux enfants dès la première page du premier de ses livres. Qui de plus donne ses raisons : « Il se pose là une question d’espoir, d’autre chose et d’ailleurs, à des cris défiant toute concurrence. » Autre chose et ailleurs désespérément traqués par Gary à travers tous ses livres, qui ont déjà tant varié de genre et de forme. Quant aux cris, on sait depuis son premier roman à quoi s’en tenir sur les révoltes de Gary contre les injustices sociales en particulier et la condition humaine en général. Or le terrorisme de la réalité trouve un complice efficace dans le terrorisme de la langue usuelle et, comme Cousin le dit à sa place, « il me serait très pénible si on me demande avec sommation d’employer des mots et des formes qui ont déjà beaucoup couru, dans le sens courant, sans trouver de sortie. […] L’espoir exige que le vocabulaire ne soit pas condamné au définitif pour cause d’échec. » Il en arrive donc à cette forte conclusion : « Car il ne s’agit pas seulement de tirer votre épingle du jeu, mais de bouleverser tous les rapports du jeu avec les épingles. » Autrement dit, pour Cousin-Ajar-Gary, changer la langue est le mot d’ordre (si on peut dire, car désordre serait plus exact), comme d’autres, les surréalistes à la suite de Rimbaud, ont choisi de changer la vie, et d’autres, les communistes, de changer la société. Il s’agit de révolte contre un état de fait et de révolution parce que, dit Ajar, il y a là « espoir avec possibilités », ouverture sur l’avenir mais aussi violence, par mutilations, entorses et même épingles interposées. Au début de l’affaire Ajar, une rumeur a couru, affirmant que ce pseudonyme cachait un certain Hamil (une sorte d’Émile arabisé et un personnage important de La Vie devant soi) Raja et c’est sous ce nom que Pavlowitch rencontre Cournot (anagramme d’Ajar), terroriste libanais de son état. Un terroriste antiterroriste en somme dont le but pacifique est de changer la langue pour changer le regard et, au-delà, l’esprit et le monde. Vaste programme, aurait dit le Général. Mais il faut bien commencer par un bout.
Dynamiter la langue donc, faire éclater les vieux carcans de la grammaire, du dictionnaire, de la logique cartésienne, la rendre accessible à tous, en « jouir sans entrave », selon un slogan de Mai 1968, et lui redonner sa gaieté, sa jeunesse, son printemps adorable, ses odeurs, ses couleurs, sa vie amoureuse, bref sa liberté.
Le simple énoncé de l’art poétique cité valorise deux des aspects de cette langue nouvelle. Le premier saute aux yeux et aux oreilles, c’est son potentiel comique qui joue à chaque instant sur des effets de surprise. La phrase ne se développe et ne finit jamais comme on l’attend, elle boite, elle reste en suspens, la logique en est calamiteuse, les mots sont utilisés les uns pour les autres, les niveaux de langue s’entrechoquent. Chaque faute, chaque erreur d’aiguillage, chaque pataquès, autant dire chaque phrase est une source d’amusement pour le lecteur.
Le deuxième est plus secret, c’est sa richesse clandestine. « Sous les pavés, la plage », disait un autre slogan de Mai 1968. Sous l’innocence apparente d’un mot d’Ajar (et de Gary depuis longtemps) un bouquet de sens. Si Madame Rosa risque d’être « attaquée », c’est que son hypertension lui fait courir le risque d’une attaque cardiaque, d’un infarctus, mais c’est aussi qu’elle est sans cesse attaquée de toutes parts, par les soucis quotidiens de ravitaillement, de protection de ses enfants contre toutes sortes de dangers en rapport avec la puissance des lois, de l’autorité sous ses formes innombrables, dont la paternelle, mais aussi par la vieillesse, mais aussi par son ennemi intérieur, la peur qui ne l’a pas quittée depuis la rafle du Vél’d’Hiv’. Chaque mot est plein comme un œuf de significations qui cohabitent, drôlement. Et secouent.
Mais surtout à travers jeux de mots, approximations, expressions figées non jointives avec le reste de la phrase et coqs à l’âne, il s’agit non seulement de réveiller la langue française, mais bien de mettre en question l’ordre public et la pensée commune. Nous parlions d’œuf ; dans le premier chapitre, Momo, en mal de mère, en mal de père, en mal de tout, vole pour se faire remarquer. Or il vole un œuf. La sagesse courante, médiocre et méfiante, a inventé le dicton, qui n’apparaît même pas, tellement il est implicite, autour de ce mot : « qui vole un œuf vole un bœuf », ce qui mène tout droit à la condamnation définitive de Jean Valjean. Ici, au contraire, l’épisode nous dit : qui vole un œuf vole un œuf, rien de plus, ou plutôt si, qui vole un œuf en récolte un deuxième, accompagné d’un baiser de la crémière, ce qui est un message révolutionnaire. Et le triomphe de l’espoir.
Читать дальше