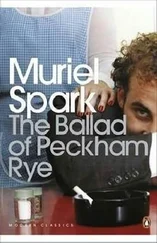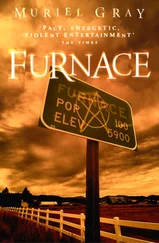— Il faut tremper les nouilles dans cette sauce, rajoute-t-il en posant devant moi un panier d’osier rempli desdites et un somptueux bol bleu-vert duquel monte un parfum de... cacahuète. C’est un « zalu ramen », un plat de nouilles froides avec une sauce un peu sucrée. Vous me direz si vous aimez.
Et il me tend une grande serviette en lin ficelle.
— Il y a des dommages collatéraux, prenez garde à votre robe.
— Merci, dis-je.
Et, allez savoir pourquoi, j’ajoute :
— Ce n’est pas la mienne.
J’inspire un grand coup et je dis :
— Vous savez, je vis seule depuis très longtemps et je ne sors jamais. Je crains d’être un peu... sauvage.
— Une sauvage très civilisée, alors, me dit-il en souriant.
Le goût des nouilles trempées dans la sauce à la cacahuète est céleste. Je ne saurais en revanche jurer de l’état de la robe de Maria. Il n’est pas très facile de plonger un mètre de nouilles dans une sauce semi-liquide et de l’ingurgiter sans commettre de dégâts. Mais comme M. Ozu avale les siennes avec dextérité et néanmoins force bruits, je me sens décomplexée et j’aspire avec entrain mes longueurs de pâtes.
— Sérieusement, me dit M. Ozu, vous ne trouvez pas ça fantastique ? Votre chat s’appelle Léon, les miens Kitty et Lévine, nous aimons tous deux Tolstoï et la peinture hollandaise et nous habitons le même lieu. Quelle est la probabilité qu’une telle chose se produise ?
— Vous n’auriez pas dû m’offrir cette magnifique édition, dis-je, ce n’était pas la peine.
— Chère madame, répond M. Ozu, est-ce que cela vous a fait plaisir ?
— Eh bien, dis-je, ça m’a fait très plaisir mais ça m’a un peu effrayée aussi. Vous savez, je tiens à rester discrète, je ne voudrais pas que les gens ici s’imaginent..
— ... qui vous êtes ? complète-t-il. Pourquoi ?
— Je ne veux pas faire d’histoires. Personne ne veut d’une concierge qui ait des prétentions.
— Des prétentions ? Mais vous n’avez pas de prétentions, vous avez des goûts, des lumières, des qualités !
— Mais je suis la concierge ! dis-je. Et puis, je n’ai pas d’éducation, je ne suis pas du même monde.
— La belle affaire ! dit M. Ozu de la même manière, le croirez-vous, que Manuela, ce qui me fait rire.
Il lève un sourcil interrogateur.
— C’est l’expression favorite de ma meilleure amie, dis-je en guise d’explication.
— Et qu’en dit-elle, votre meilleure amie, de vôtre-discrétion ?
Ma foi, je n’en sais rien.
— Vous la connaissez, dis-je, c’est Manuela.
— Ah, Mme Lopes ? dit-il. C’est une amie à vous ?
— C’est ma seule amie.
— C’est une grande dame, dit M. Ozu, une aristocrate. Vous voyez, vous n’êtes pas la seule à démentir les normes sociales. Où est le mal ? Nous sommes au xxie siècle, que diable !
— Que faisaient vos parents ? je demande, un peu énervée par si peu de discernement.
M. Ozu s’imagine sans doute que les privilèges ont disparu avec Zola.
— Mon père était diplomate. Je n’ai pas connu ma mère, elle est morte peu après ma naissance.
— Je suis désolée, dis-je.
Il fait un geste de la main, pour dire : il y a longtemps. Je poursuis mon idée.
— Vous êtes fils de diplomate, je suis fille de paysans pauvres. Il est même inconcevable que je dîne chez vous ce soir.
— Et pourtant, dit-il, vous dînez ici ce soir. Et il ajoute, avec un très gentil sourire :
— Et j’en suis très honoré.
Et la conversation se poursuit ainsi, avec bonhomie et naturel. Nous évoquons dans l’ordre : Yasujiro Ozu (un lointain parent), Tolstoï et Lévine fauchant dans le pré avec ses paysans, l’exil et l’irréductibilité des cultures et bien d’autres sujets que nous enchaînons avec l’enthousiasme du coq et de l’âne en appréciant nos derniers arpents de nouilles et, surtout, la déconcertante similitude de nos tournures d’esprit.
Vient un moment où M. Ozu me dit :
— J’aimerais que vous m’appeliez Kakuro, c’est quand même moins emprunté. Est-ce que ça vous ennuie que je vous appelle Renée ?
— Pas du tout, dis-je — et je le pense vraiment.
D’où me vient cette soudaine facilité dans la connivence ?
Le saké, qui me ramollit délicieusement le bulbe, rend la question terriblement peu urgente.
— Savez-vous ce que c’est que l’azuki ? demande Kakuro.
— Les monts de Kyoto..., dis-je en souriant à ce souvenir d’infini.
— Comment ? demande-t-il.
— Les monts de Kyoto ont la couleur du flanc d’azuki, dis-je en m’efforçant tout de même de parler distinctement.
— C’est dans un film, n’est-ce pas ? demande Kakuro.
— Oui, dans Les Sœurs Munakata , tout à la fin.
— Oh, j’ai vu ce film il y a très longtemps mais je ne m’en souviens pas très bien.
— Vous ne vous souvenez pas du camélia sur la mousse du temple ? dis-je.
— Non, pas du tout, répond-il. Mais vous me donnez envie de le revoir. Est-ce que ça vous dirait qu’on le regarde ensemble, un jour prochain ?
— J’ai la cassette, dis-je, je ne l’ai pas encore rendue à la bibliothèque.
— Ce week-end, peut-être ? demande Kakuro.
— Vous avez un magnétoscope ?
— Oui, dit-il en souriant.
— Alors, c’est d’accord, dis-je. Mais je vous propose la chose suivante : dimanche, nous regardons le film à l’heure du thé et j’apporte les pâtisseries.
— Marché conclu, répond Kakuro.
Et la soirée avance encore tandis que nous parlons toujours sans préoccupation de cohérence ni d’horaire, en sirotant interminablement une tisane au curieux goût d’algue. Sans surprise, il me faut renouer avec la lunette couleur neige et la moquette solaire. J’opte pour le bouton à un seul lotus — message reçu — et supporte l’assaut du Confutatis avec la sérénité des grands initiés. Ce qui est à la fois déconcertant et merveilleux, avec Kakuro Ozu, c’est qu’il allie un enthousiasme et une candeur juvéniles à une attention et une bienveillance de grand sage. Je ne suis pas coutumière d’un tel rapport au monde ; il me semble qu’il le considère avec indulgence et curiosité alors que les autres êtres humains de ma connaissance l’abordent avec méfiance et gentillesse (Manuela), ingénuité et gentillesse (Olympe) ou arrogance et cruauté (le reste de l’univers). La collusion de l’appétit, de la lucidité et de la magnanimité figure un inédit et savoureux cocktail.
Et puis mon regard tombe sur ma montre.
Il est trois heures.
Je bondis sur mes pieds.
— Mon Dieu, dis-je, vous avez vu l’heure ?
Il regarde sa propre montre puis lève les yeux vers moi, l’air inquiet.
— J’ai oublié que vous travailliez tôt demain. Je suis retraité, je ne me soucie plus de cela. Est-ce que ça va aller ?
— Oui, bien sûr, dis-je, mais il faut que je dorme un peu tout de même.
Je tais le fait que, en dépit de mon âge avancé et alors qu’il est bien connu que les vieux dorment peu, je dois faire la bûche pendant au moins huit heures pour pouvoir appréhender le monde avec discernement.
— À dimanche, me dit Kakuro à la porte de son appartement.
— Merci beaucoup, dis-je, j’ai passé une très bonne soirée, je vous en suis très reconnaissante.
— C’est moi qui vous remercie, dit-il, je n’avais pas ri ainsi depuis très longtemps, ni eu une si agréable conversation. Voulez-vous que je vous raccompagne jusqu’à chez vous ?
— Non merci, dis-je, c’est inutile.
Il y a toujours un Pallières potentiel qui rôde dans les escaliers
— Eh bien, à dimanche, dis-je, ou peut-être nous croiserons-nous avant.
Читать дальше