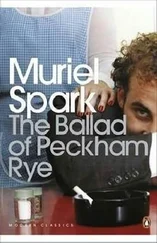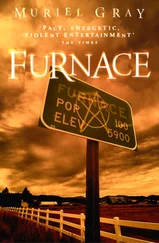Au début, j’étais plutôt contente de moi. J’avais réussi à le faire bouger. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, je me suis sentie de plus en plus déprimée. Parce que ce qui s’est passé quand il a bougé, c’est quelque chose de pas très beau, de pas très propre. J’ai beau savoir qu’il y a des adultes qui ont des masques tout sucre toute sagesse mais qui sont très laids et très durs en dessous, j’ai beau savoir qu’il suffit de les percer à jour pour que les masques tombent, quand ça arrive avec cette violence-là, ça me fait mal. Quand il a frappé le sous-main, ça voulait dire : « Très bien, tu me vois tel que je suis, inutile de continuer la comédie, tope là pour ton petit pacte misérable et dégage de mon tapis en vitesse. » Eh bien, ça m’a fait mal, oui, ça m’a fait mal. J’ai beau savoir que le monde est laid, je n’ai pas envie de le voir.
Oui, quittons ce monde où ce qui bouge dévoile ce qui est laid.
Il fait beau reprocher aux phénoménologues leur autisme sans chat ; j’ai voué ma vie à la quête de l’intemporel.
Mais qui chasse l’éternité récolte la solitude.
— Oui, dit-il en prenant mon sac, je le pense aussi. C’est une des plus dépouillées et pourtant, elle est d’une grande harmonie.
Chez M. Ozu, c’est très grand et très beau. Les récits de Manuela m’avaient préparée à un intérieur japonais, mais s’il y a bien des portes coulissantes, des bonsaïs, un épais tapis noir bordé de gris et des objets à la provenance asiatique — une table basse de laque sombre ou, tout le long d’une impressionnante enfilade de fenêtres, des stores en bambou qui, diversement tirés, donnent à la pièce son atmosphère levantine —, il y a aussi un canapé et des fauteuils, des consoles, des lampes et des bibliothèques de facture européenne. C’est très... élégant. Ainsi que Manuela et Jacinthe Rosen l’avaient noté, en revanche, rien n’est redondant. Ce n’est pas non plus épuré et vide, comme je me l’étais représenté en transposant les intérieurs des films d’Ozu à un niveau plus luxueux mais sensiblement identique dans le dépouillement caractéristique de cette étrange civilisation.
— Venez, me dit M. Ozu, nous n’allons pas rester ici, c’est trop cérémonieux. Nous allons dîner à la cuisine. D’ailleurs, c’est moi qui cuisine.
Je réalise qu’il porte un tablier vert pomme sur un pull à col rond couleur châtaigne et un pantalon de toile beige. Il a aux pieds des savates de cuir noir.
Je trottine derrière lui jusqu’à la cuisine. Misère. Dans tel écrin, je veux bien cuisiner chaque jour, y compris pour Léon. Rien ne peut y être ordinaire et jusqu’à ouvrir une boîte de Ronron doit y paraître délicieux.
— Je suis très fier de ma cuisine, dit M. Ozu avec simplicité.
— Vous pouvez, dis-je, sans l’ombre d’un sarcasme.
Tout est blanc et bois clair, avec de longs plans de travail et de grands vaisseliers emplis de plats et de coupelles de porcelaine bleue, noire et blanche. Au centre, le four, les plaques de cuisson, un évier à trois vasques et un espace bar sur un des accueillants tabourets duquel je me perche, en faisant face à M. Ozu qui s’affaire aux fourneaux. Il a placé devant moi une petite bouteille de saké chaud et deux ravissants godets en porcelaine bleue craquelée.
— Je ne sais pas si vous connaissez la cuisine japonaise, me dit-il.
— Pas très bien, réponds-je.
Une vague d’espoir me soulève. On aura en effet pris note de ce que, jusqu’à présent, nous n’avons pas échangé vingt mots, tandis que je me tiens en vieille connaissance devant un M. Ozu qui cuisine en tablier vert pomme, après un épisode hollandais et hypnotique sur lequel personne n’a glosé et qui est désormais rangé au chapitre des choses oubliées.
La soirée pourrait fort bien n’être qu’une initiation à la cuisine asiatique. Foin de Tolstoï et de tous les soupçons : M. Ozu, nouveau résident peu au fait des hiérarchies, invite sa concierge à un dîner exotique. Ils conversent de sashimis et de nouilles au soja.
Peut-il se trouver plus anodine circonstance ?
C’est alors que la catastrophe se produit.
Au préalable, il me faut confesser que j’ai une petite vessie. Comment expliquer sinon que la moindre tasse de thé m’envoie sans délai au petit coin et qu’une théière me fasse réitérer la chose à la mesure de sa contenance ? Manuela est un vrai chameau : elle retient ce qu’elle boit des heures durant et grignote ses mendiants sans bouger de sa chaise tandis que j’effectue maints et pathétiques allers et retours aux waters. Mais je suis alors chez moi et, dans mes soixante mètres carrés, les cabinets, qui ne sont jamais très loin, se tiennent à une place depuis longtemps bien connue.
Or, il se trouve que, présentement, ma petite vessie vient de se manifester à moi et, dans la pleine conscience des litres de thé absorbés l’après-midi même, je dois entendre son message : autonomie réduite.
Comment demande-t-on ceci dans le monde ?
— Où sont les gogues ? ne me paraît curieusement pas idoine.
À l’inverse :
— Voudriez-vous m’indiquer l’endroit ? bien que délicat dans l’effort fait de ne pas nommer la chose, court le risque de l’incompréhension et, partant, d’un embarras décuplé.
— J’ai envie de faire pipi , sobre et informationnel, ne se dit pas à table non plus qu’à un inconnu.
— Où sont les toilettes ? me pose problème. C’est une requête froide, qui sent son restaurant de province.
J’aime assez celui-ci :
— Où sont les cabinets ? parce qu’il y a dans cette dénomination, les cabinets, un pluriel qui exhale l’enfance et la cabane au fond du jardin. Mais il y a aussi une connotation ineffable qui convoque la mauvaise odeur.
C’est alors qu’un éclair de génie me transperce.
— Les ramen sont une préparation à base de nouilles et de bouillon d’origine chinoise, mais que les Japonais mangent couramment le midi, est en train de dire M. Ozu en élevant dans les airs une quantité impressionnante de pâtes qu’il vient de tremper dans l’eau froide.
— Où sont les commodités, je vous prie ? est la seule réponse que je trouve à lui faire.
C’est, je vous le concède, légèrement abrupt.
— Oh, je suis désolé, je ne vous les ai pas indiquées, dit M. Ozu avec un parfait naturel. La porte derrière vous, puis deuxième à droite dans le couloir.
Tout pourrait-il toujours être si simple ?
Il faut croire que non.
Journal du mouvement du monde n° 6
Culotte ou Van Gogh ?
Aujourd’hui, avec maman, nous sommes allées faire les soldes rue Saint-Honoré. L’enfer. Il y avait la queue devant certaines boutiques. Et je pense que vous voyez quel genre de boutique il y a rue Saint-Honoré : mettre autant de ténacité à acheter au rabais des foulards ou des gants qui, malgré ça, valent encore le prix d’un Van Gogh, c’est quand même sidérant. Mais ces dames font ça avec une passion furieuse. Et même avec une certaine inélégance.
Mais je ne peux tout de même pas totalement me plaindre de la journée parce que j’ai pu noter un mouvement très intéressant quoique, hélas, très peu esthétique. En revanche, très intense, ça oui ! Et amusant aussi. Ou tragique, je ne sais pas bien. Depuis que j’ai commencé ce journal, j’en ai pas mal rabattu, en fait. J’étais partie dans l’idée de découvrir l’harmonie du mouvement du monde et j’en arrive à des dames très bien qui se battent pour une culotte en dentelle. Mais bon... Je pense que, de toute façon, je n’y croyais pas. Alors tant qu’à faire, autant s’amuser un peu...
Читать дальше