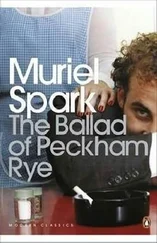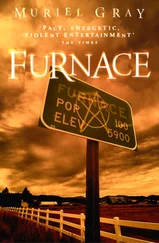En fait, Diane aurait dû tirer vers le haut et l’autre vers le bas, ce qui aurait décollé les deux chiens mais, au lieu de ça, elles sont parties latéralement et comme c’est étroit devant la cage de l’ascenseur, elles se sont très vite heurtées à un obstacle : l’une à la grille de l’ascenseur, l’autre au mur de gauche et, du coup, Neptune, qui avait été déstabilisé par la première traction, a retrouvé un nouveau souffle et s’est arrimé de plus belle à Athéna qui roulait des yeux affolés en hurlant. À ce moment-là, les humaines ont changé de stratégie en tentant de traîner leurs chiens vers des espaces plus larges pour pouvoir refaire la manœuvre plus confortablement. Mais il y avait urgence : tout le monde sait bien qu’il arrive un moment où les chiens deviennent indécollables. Elles ont donc mis le turbo en criant ensemble « Oh mon Dieu Oh mon Dieu » et en tirant sur leurs laisses comme si leur vertu en dépendait. Mais dans la précipitation, Diane Badoise a légèrement glissé et s’est tordu la cheville. Et voilà le mouvement intéressant : sa cheville s’est tordue vers l’extérieur et, en même temps, tout son corps s’est déporté dans la même direction, sauf sa queue-de-cheval qui est partie dans l’autre.
Je vous assure que c’était magnifique : on aurait dit un Bacon. Ça fait des lustres qu’il y a un Bacon encadré dans les W.-C. de mes parents avec quelqu’un qui est sur des W.-C, justement, et à la Bacon, quoi, genre torturé et pas très ragoûtant. J’ai toujours pensé que ça avait probablement un effet sur la sérénité des actions mais bon, ici, tout le monde a ses W.-C. à soi, donc je ne me suis jamais plainte. Mais quand Diane Badoise s’est complètement désarticulée en se tordant la cheville, en faisant avec ses genoux, ses bras et sa tête des angles bizarres et le tout couronné par la queue-de-cheval à l’horizontale, ça m’a immédiatement fait penser au Bacon. Pendant un très petit instant, elle a ressemblé à un pantin désarticulé, ça a fait un grand couac corporel et, pendant quelques millièmes de seconde (parce que ça s’est passé très vite mais, comme je suis attentive maintenant aux mouvements du corps, je l’ai vu comme au ralenti), Diane Badoise a ressemblé à un personnage de Bacon. De là à me dire que ce truc est dans les W.-C. depuis toutes ces années juste pour me permettre de bien apprécier ce mouvement bizarre, il n’y a qu’un pas. Ensuite, Diane est tombée sur les chiens et ça a résolu le problème puisque Athéna, en s’écrasant au sol, a échappé à Neptune. A suivi un petit ballet compliqué, Anne-Hélène voulant porter de l’aide à Diane tout en tenant sa chienne à distance du monstre lubrique et Neptune, complètement indifférent aux cris et à la douleur de sa maîtresse, continuant à tirer en direction de son steak à la rose. Mais à ce moment-là, Mme Michel est sortie de sa loge et moi j’ai attrapé la laisse de Neptune et je l’ai amené plus loin.
Il était bien déçu, le pauvre. Du coup, il s’est assis et il s’est mis à se lécher les coucougnettes en faisant beaucoup de « slurps », ce qui a rajouté au désespoir de la pauvre Diane. Mme Michel a appelé le SAMU parce que sa cheville commençait à ressembler à une pastèque et puis a ramené Neptune chez lui pendant que Anne-Hélène Meurisse restait avec Diane. Moi, je suis rentrée chez moi en me disant : bon, un Bacon en vrai, est-ce que ça en vaut la peine ?
J’ai décidé que non : parce que non seulement Neptune n’a pas eu sa gâterie mais, en plus, il n’a pas eu sa promenade.
8
Prophète des élites modernes
Ce matin, en écoutant France Inter, j’ai eu la surprise de découvrir que je n’étais pas ce que je croyais être. J’avais jusqu’alors attribué à ma condition d’autodidacte prolétaire les raisons de mon éclectisme culturel. Comme je l’ai déjà évoqué, j’ai passé chaque seconde de mon existence qui pouvait être distraite au travail à lire, regarder des films et écouter de la musique. Mais cette frénésie dans la dévoration des objets culturels me semblait souffrir d’une faute de goût majeure, celle du mélange brutal entre des œuvres respectables et d’autres qui l’étaient beaucoup moins.
C’est sans doute dans le champ de la lecture que mon éclectisme est le moins grand, quoique ma diversité d’intérêts y soit la plus extrême. J’ai lu des ouvrages d’histoire, de philosophie, d’économie politique, de sociologie, de psychologie, de pédagogie, de psychanalyse et, bien sûr et avant tout, de littérature. Les premières m’ont intéressée ; la dernière est toute ma vie. Mon chat, Léon, se prénomme ainsi parce que Tolstoï. Le précédent s’appelait Dongo parce que Fabrice del. Le premier avait pour nom Karénine parce que Anna mais je ne l’appelais que Karé, de crainte qu’on ne me démasque. Hormis l’infidélité stendhalienne, mes goûts se situent très nettement dans la Russie d’avant 1910, mais je me flatte d’avoir dévoré une part somme toute appréciable de la littérature mondiale si l’on prend en compte le fait que je suis une fille de la campagne dont les espérances de carrière se sont surpassées jusqu’à mener à la conciergerie du 7 rue de Grenelle, et alors qu’on aurait pu croire qu’une telle destinée voue au culte éternel de Barbara Cartland. J’ai bien une inclination coupable pour les romans policiers — mais je tiens ceux que je lis pour de la haute littérature. Il m’est particulièrement pénible, certains jours, de devoir m’extirper de la lecture d’un Connelly ou d’un Mankell pour aller répondre au coup de sonnette de Bernard Grelier ou de Sabine Pallières, dont les préoccupations ne sont pas congruentes aux méditations de Harry Bosch, le flic amateur de jazz du LAPD, spécialement lorsqu’ils me demandent :
— Pourquoi les ordures sentent jusque dans la cour ?
Que Bernard Grelier et l’héritière d’une vieille famille de la Banque puissent se soucier des mêmes choses triviales et ignorer conjointement l’utilisation du pronom personnel postverbe que la forme interrogative requiert jette sur l’humanité un éclairage nouveau.
Au chapitre cinématographique, en revanche, mon éclectisme s’épanouit. J’aime les blockbusters américains et les œuvres du cinéma d’auteur. En fait, j’ai longtemps consommé préférentiellement du cinéma de divertissement américain ou anglais, à l’exception de quelques œuvres sérieuses que je considérais avec mon œil esthétisant, l’œil passionnel et empathique n’ayant d’accointances qu’avec le divertissement. Greenaway suscite en moi admiration, intérêt et bâillements tandis que je pleure comme une madeleine spongieuse chaque fois que Melly et Mama montent l’escalier des Butler après la mort de Bonnie Blue et tiens Blade Runner pour un chef-d’œuvre de la distraction haut de gamme. Pendant longtemps, j’ai considéré comme une fatalité que le septième art soit beau, puissant et soporifique et que le cinéma de divertissement soit futile, réjouissant et bouleversant.
Tenez, par exemple, aujourd’hui, je frétille d’impatience à l’idée du cadeau que je me suis offert. C’est le fruit d’une exemplaire patience, l’assouvissement longtemps différé du désir de revoir un film que j’ai vu pour la première fois à la Noël 1989.
À la Noël 1989, Lucien était très malade. Si nous ne savions pas encore quand la mort viendrait, nous étions noués par la certitude de son imminence, noués en nous-mêmes et noués l’un à l’autre par cet invisible lien. Lorsque la maladie entre dans un foyer, elle ne s’empare pas seulement d’un corps mais tisse entre les cœurs une sombre toile où s’ensevelit l’espoir. Tel un fil arachnéen s’enroulant autour de nos projets et de notre respiration, la maladie, jour après jour, avalait notre vie. Lorsque je rentrais du dehors, j’avais le sentiment de pénétrer dans un caveau et j’avais froid tout le temps, un froid que rien n’apaisait au point que, les derniers temps, lorsque je dormais aux côtés de Lucien, il me semblait que son corps aspirait toute la chaleur que le mien avait pu dérober ailleurs.
Читать дальше