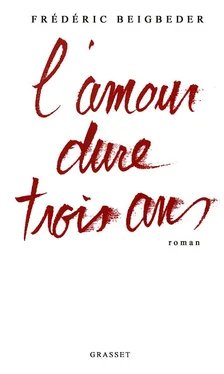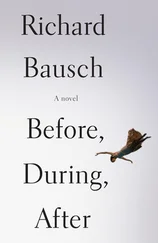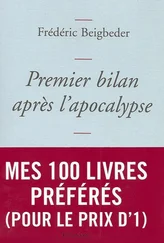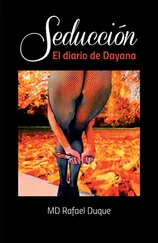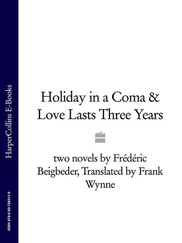Frédéric Beigbeder - L'amour dure trois ans
Здесь есть возможность читать онлайн «Frédéric Beigbeder - L'amour dure trois ans» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 1997, ISBN: 1997, Издательство: Grasset and Fasquelle, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:L'amour dure trois ans
- Автор:
- Издательство:Grasset and Fasquelle
- Жанр:
- Год:1997
- Город:Paris
- ISBN:978-2-246-54659-7
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
L'amour dure trois ans: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «L'amour dure trois ans»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
L'amour dure trois ans — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «L'amour dure trois ans», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Nous avons joué la comédie du romantisme, uniquement pour jouir plus fort. Et nous avons fini par y croire. Rien de plus efficace que la méthode Coué en amour : quel dommage qu’elle ne fonctionne que dans un seul sens. Une fois qu’on a cristallisé, il est trop tard pour revenir en arrière. On pensait jouer, et c’était vrai, mais on jouait avec le feu. On flottait déjà dans le vide du précipice, comme ces personnages de dessins animés qui regardent le spectateur, puis le vide sous leurs pieds, puis de nouveau le spectateur, avant de chuter définitivement. « That’s all folks ! »
Je me souviens que, quand Anne et moi étions séparés, quelles que soient les fêtes où je mettais les pieds, je ne rencontrais plus que des gens qui me demandaient d’un air faux où était Anne, que devenait Anne, pourquoi elle était pas là Anne, et comment elle allait Anne en ce moment ? Je leur répondais, au choix :
— Elle bosse tard en ce moment.
— Ah bon ? Elle n’est pas là ? Justement je la cherchais, j’ai rendez-vous avec ma femme.
— Entre nous, elle a bien fait de ne pas venir dans cette soirée de merde : j’aurais dû l’écouter, elle a un sixième sens pour détecter les mauvais plans, ah, pardon, c’est toi qui organises…
— Anne ? On est en procédure de divorce ! Ha ha ! Je plaisante.
— Elle bosse vraiment trop en ce moment.
— Tout va bien : j’ai la permission de minuit.
— Partie en séminaire de travail avec l’équipe de football du Congo.
— Anne ? Anne comment ? Marronnier ? Quelle coïncidence, une fille qui porte le même nom que moi !
— Anne est à l’hôpital… Un accident atroce… Entre deux hurlements de douleur insoutenables, elle m’a supplié de rester avec elle, mais je ne voulais pas louper cette sympathique soirée. Exquis, ces œufs de saumon vous ne trouvez pas ?
— D’un autre côté, avec ce qu’elle bosse, je vais bientôt être bourré de fric.
— Le mariage est une institution qui n’est pas au point.
— Où est Alice ? Vous connaissez Alice ? Vous n’auriez pas vu Alice ? Vous croyez qu’Alice va venir ?
En revanche, chaque fois que j’entendais le mot « Alice » prononcé quelque part, c’était comme un coup de poignard.
— Chers amis, auriez-vous l’obligeance de ne plus prononcer ce prénom en ma présence, s’il vous plaît ?
Merci d’avance,
Moi.
Le paradis, c’est les autres, mais il ne faut pas en abuser. J’entendais de plus en plus de médisances sur Anne et moi. Bien sûr, je faisais une croix sur celles qui couraient sur mon propre compte : elles avaient toujours couru déjà bien avant que d’être vraies. Je n’avais jamais été dupe de la jalousie mondaine et de la superficialité des noctambules, mais là, s’attaquer à Anne, j’en fus presque dégoûté. Moi, si je sortais le soir, c’était pour ralentir ma vie, parce que je ne supportais pas que l’existence puisse s’arrêter à huit heures du soir. Je voulais voler des heures d’existence aux couche-tôt. Mais cette fois, c’en était trop. Je ne sortirais plus. Je réalisais que je haïssais tous ces gens qui se nourrissaient de mon malheur. Moi aussi, j’avais été comme eux, un charognard. Mais ça suffisait : ils ne me faisaient plus rire. Cette fois, je voulais saisir ma chance, autant que possible. Ils devraient se passer de moi. Je démissionnai des magazines où j’écrivais des chroniques mondaines.
Adieu, mes faux amis du Tout-Paris, vous ne me manquerez pas. Poursuivez sans moi votre lente putréfaction, je ne vous en veux pas, au contraire, je vous plains. Le voilà, le grand drame de notre société : même les riches ne font plus envie. Ils sont gros, moches et vulgaires, leurs femmes sont liftées, ils vont en prison, leurs enfants se droguent, ils ont des goûts de ploucs, ils posent pour Gala. Les riches d’aujourd’hui ont oublié que l’argent est un moyen, non une fin. Ils ne savent plus quoi en faire. Au moins, quand on est pauvre, on peut se dire qu’avec du fric tout s’arrangerait. Mais quand on est riche, on ne peut pas se dire qu’avec une nouvelle baraque dans le Midi, une autre voiture de sport, une paire de pompes à douze mille balles ou un mannequin supplémentaire, tout s’arrangerait. Quand on est riche, on n’a plus d’excuses. C’est pour ça que tous les milliardaires sont sous Prozac : parce qu’ils ne font plus rêver personne, pas même eux.
Écrire sur la nuit était un cercle vicieux dont j’étais prisonnier. Je me bourrais la gueule pour raconter la dernière fois où je m’étais bourré la gueule. C’est fini, affrontons désormais le jour. Voyons voir, quels articles de journaux pourrait bien écrire un parasite au chômage ? Imaginez le comte Dracula en plein jour : quel métier ferait-il ? En quoi se recyclent les sangsues ?
Et c’est ainsi que je suis devenu critique littéraire.
XXXIV
La théorie de l’éternel retour
Quand je les informe de ma rupture, mes parents (divorcés en 1972) tentent de me raisonner. « Tu es sûr ? » « Ce n’est pas rattrapable ? » « Réfléchis bien… » La psychanalyse a eu une influence considérable dans les années soixante ; cela explique sans doute pourquoi mes parents sont persuadés que tout est de leur faute. Ils sont beaucoup plus inquiets que moi : du coup je ne leur mentionne même pas Alice. Une catastrophe à la fois, c’est suffisant. Je leur explique calmement que l’amour dure trois ans. Ils protestent, chacun à leur façon, mais ne sont guère convaincants. Le leur n’a pas duré tellement plus longtemps. Je suis époustouflé de les sentir revivre leur histoire à travers la mienne. Je n’en reviens pas que mes parents aient autant espéré, pensé, et finalement cru que je serais différent d’eux.
Nous sommes sur Terre pour revivre les mêmes événements que nos parents, dans le même ordre, comme eux ont commis les mêmes erreurs que leurs parents à eux, et ainsi de suite. Mais ce n’est pas grave. Ce qui est bien pire, c’est quand, soi-même, on refait les mêmes conneries continuellement. Or c’est mon cas.
Je retombe dans la même ornière, tous les trois ans. Sans cesse je revis un perpétuel déjà-vu. Ma vie radote. Je dois être programmé en boucle, comme un compact-disc quand on enfonce la touche « Repeat ». (J’aime bien me comparer à des machines, car les machines sont faciles à réparer.) Ce n’est pas du comique de répétition, mais un cauchemar bien réel : imaginez une montagne russe atroce avec des loopings écœurants et des chutes vertigineuses. Vous vous laissez embarquer une fois et cela vous suffit. Vous descendez du manège en vous écriant : « Ouh lala ! J’ai failli vomir ma barbapapa trois fois, on ne m’y reprendra plus ! » Eh bien moi, on m’y reprend. Je suis abonné au Toboggan Infernal. Le Space Mountain, c’est ma maison.
Je viens enfin de comprendre la phrase de Camus : « Il faut imaginer Sisyphe heureux. »
Il voulait dire qu’on répète toute sa vie les mêmes bêtises mais que c’est peut-être cela, le bonheur. Il va falloir que je m’accroche à cette idée. Aimer mon malheur car il est fertile en rebondissements.
Un rêve. Je pousse mon rocher boulevard Saint-Germain. Je le gare en double file. Un agent de police me demande de circuler sinon il verbalisera mon rocher. Je suis obligé de le déplacer et tout d’un coup il m’échappe, il se met à descendre la rue Saint-Benoît en roulant de plus en plus vite. J’en ai perdu tout contrôle : il faut dire qu’il pèse tout de même six tonnes, ce bloc de granit. Arrivé au coin de la rue Jacob, il emplafonne une petite voiture de sport. Ouille ! Le capot, la portière et le minet qui conduisait sont écrabouillés. Je dois remplir le constat avec sa veuve sexy en larmes. Je lui mords l’épaule. À la ligne « immatriculation », j’inscris : « S.I.S.Y.P.H.E. » (modèle d’occasion). Et je remonte la rue Bonaparte en poussant mon rocher, suant sang et eau, centimètre par centimètre, pour enfin le laisser au parking Saint-Germain-des-Prés. Demain, le même cirque recommence. Et il faudrait m’imaginer heureux.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «L'amour dure trois ans»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «L'amour dure trois ans» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «L'amour dure trois ans» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.