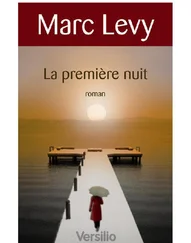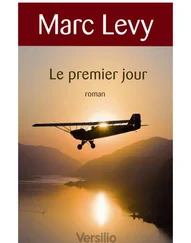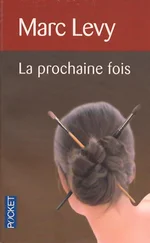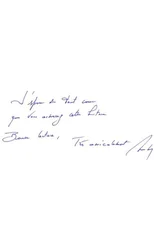— C’est moi qui t’ai posé la question.
— Qu’est-ce que ma tante est allée vous raconter ? Elle inventerait n’importe quoi pour que j’arrête de vous aider dans vos recherches. Elle est si obstinée quand elle a une idée en tête qu’elle aurait pu vous faire croire que je comptais vous demander en mariage, mais, je vous rassure, je n’en avais pas l’intention.
Alice prit la main de Can dans la sienne.
— Je te promets que je ne l’ai pas crue une seconde.
— Ne faites pas cela, soupira Can en retirant sa main.
— C’était juste un geste d’amitié.
— Peut-être, mais l’amitié n’est jamais innocente entre deux êtres qui ne sont pas du même sexe.
— Je ne suis pas d’accord avec toi, ma plus grande amitié, je la partage avec un homme, nous nous connaissons depuis l’adolescence.
— Il ne vous manque pas ?
— Si, bien sûr, je lui écris chaque semaine.
— Et il répond à toutes vos lettres ?
— Non, mais il a une bonne excuse, je ne les lui poste pas.
Can sourit à Alice et s’en alla en marchant à reculons.
— Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi vous n’envoyiez jamais ces lettres ? Je crois qu’il est temps de rentrer, il est tard.
*
Cher Daldry,
C’est le cœur en désordre que je rédige cette lettre. Je crois être arrivée au terme de ce voyage et, pourtant, si je vous écris ce soir, c’est pour vous annoncer que je ne rentrerai pas, tout du moins pas avant longtemps. En lisant les lignes qui vont suivre, vous comprendrez pourquoi.
Hier matin, j’ai retrouvé la nourrice de mon enfance. Can m’a conduite chez M me Yilmaz. Elle habite une maison au sommet d’une ruelle pavée qui n’était dans le temps couverte que de terre. Il faut que je vous dise aussi qu’au bout de cette ruelle se trouve un grand escalier…
Comme chaque jour, ils avaient quitté Üsküdar de bon matin, mais ainsi que Can l’avait promis à Alice, ils s’étaient rendus à la gare d’Haydarpasa. Le train avait quitté le quai à neuf heures trente. Le visage collé à la vitre du compartiment, Alice s’était demandé à quoi ressemblerait sa nourrice et si son visage réveillerait des souvenirs. Arrivés à Izmit une heure plus tard, ils avaient pris un taxi qui les conduisit sur les hauteurs d’une colline, dans le plus vieux quartier de la ville.
La maison de M me Yilmaz était bien plus âgée que sa propriétaire. Bâtie en bois, elle penchait étrangement de côté et semblait prête à s’écrouler à tout moment. Les lambris de la façade n’étaient plus retenus que par de vieux clous étêtés, les fenêtres rongées par le sel, et les morsures de maints hivers s’accrochaient péniblement à leurs châssis. Alice et Can frappèrent à la porte de cette demeure moribonde. Lorsque celui qu’elle prit pour le fils de M me Yilmaz la fit entrer dans le salon, Alice fut saisie par l’odeur de résine du bois fumant dans la cheminée, des livres anciens qui sentaient le lait caillé, d’un tapis qui sentait la douceur sèche de la terre, d’une paire de vieilles bottes en cuir qui sentaient encore la pluie.
— Elle est en haut, dit l’homme en désignant l’étage, je ne lui ai rien dit, simplement qu’elle aurait de la visite.
Et, gravissant l’escalier bringuebalant, Alice perçut le parfum de lavande des cantonnières, l’odeur de l’huile de lin qui lustrait la rambarde, des draps amidonnés qui sentaient la farine, et, dans la chambre de M me Yilmaz, celle de la naphtaline qui sentait la solitude.
M me Yilmaz lisait, assise sur son lit. Elle fit glisser ses lunettes sur la pointe de son nez et regarda ce couple qui venait de frapper à sa porte.
Elle dévisagea Alice qui s’approchait, retint son souffle avant de pousser un long soupir, et ses yeux s’emplirent de larmes.
Alice ne voyait sur ce lit qu’une vieille femme qui lui était étrangère jusqu’à ce que M me Yilmaz la prenne dans ses bras en sanglotant et la serre contre elle…
… le nez plongé dans sa nuque, j’ai reconnu l’accord parfait de mon enfance, retrouvé les odeurs du passé, le parfum des baisers reçus avant d’aller au lit. J’ai entendu, surgi de cette enfance, le bruissement des rideaux qui s’ouvraient le matin, la voix de ma nourrice me criant : « Anouche, lève-toi, il y a un si joli bateau dans la rade, il faut que tu viennes voir ça. »
J’ai retrouvé l’odeur du lait chaud dans la cuisine, revu les pieds d’une table en merisier sous laquelle j’aimais tant me cacher. J’ai entendu les marches de l’escalier craquer sous les pas de mon père, et j’ai revu soudain, sur un dessin à l’encre noire, deux visages que j’avais oubliés.
J’ai eu deux mères et deux pères, Daldry, je n’en ai plus aucun.
Il a fallu du temps pour que M me Yilmaz sèche ses larmes, ses mains me caressaient les joues et ses lèvres me couvraient de baisers. Elle murmurait mon prénom sans pouvoir s’arrêter : « Anouche, Anouche, ma toute petite Anouche, mon soleil, tu es revenue voir ta vieille nourrice. » Et, à mon tour, j’ai pleuré, Daldry. J’ai pleuré, de toute mon ignorance, de n’avoir jamais su que ceux qui m’ont fait naître ne m’ont pas vue grandir, que ceux que j’ai aimés et qui m’ont élevée m’avaient adoptée pour me sauver la vie. Je ne me prénomme pas Alice, mais Anouche, avant d’être une Anglaise, je suis une Arménienne et mon vrai nom n’est pas Pendelbury.
À cinq ans, j’étais une enfant silencieuse, une petite fille qui refusait de parler sans que l’on sache pourquoi. Mon univers n’était fait que d’odeurs, elles étaient mon langage. Mon père, cordonnier, possédait un grand atelier et deux commerces, sur l’une et l’autre rive du Bosphore. Il était, m’a affirmé M me Yilmaz, le plus réputé d’Istanbul et on venait le voir de tous les faubourgs de la ville. Mon père s’occupait du magasin de Péra, ma mère gérait celui de Kadıköy et, chaque matin, M me Yilmaz me conduisait à l’école, au fond d’une petite impasse d’Üsküdar. Mes parents travaillaient beaucoup, mais le dimanche mon père nous emmenait toujours nous promener en calèche.
Au début de l’année 1914, un énième médecin avait suggéré à mes parents que mon mutisme n’était pas une fatalité, que certaines plantes médicinales pourraient calmer mes nuits troublées par de violents cauchemars et que le sommeil retrouvé me délierait la langue. Mon père avait pour client un jeune pharmacien anglais qui aidait des familles en difficulté. Chaque semaine, M me Yilmaz et moi nous rendions rue Isklital.
Dès que je voyais la femme de ce pharmacien, paraît-il, je criais son prénom d’une voix claire.
Les potions de M. Pendelbury eurent des vertus miraculeuses. Au bout de six mois de traitement, je dormais comme un ange et retrouvais de jour en jour le goût de la parole. La vie redevint heureuse, jusqu’au 25 avril 1915.
Ce jour-là, à Istanbul, notables, intellectuels et journalistes, médecins, enseignants et commerçants arméniens furent arrêtés au cours d’une rafle sanglante. La plupart des hommes furent exécutés sans jugement, et ceux qui avaient survécu furent déportés vers Adana et Alep.
En fin d’après-midi, la rumeur des massacres parvint jusqu’à l’atelier de mon père. Des amis turcs étaient venus le prévenir de mettre sa famille à l’abri au plus vite. On accusait les Arméniens de comploter avec les Russes, ennemis de l’époque. Rien de cela n’était vrai, mais la fureur nationaliste avait embrasé les esprits et, en dépit des manifestations de bien des Stambouliotes, les assassinats s’étaient perpétrés dans la plus grande impunité.
Mon père se précipita pour venir nous rejoindre, en chemin, il croisa une patrouille.
Читать дальше