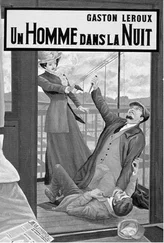Dans son appartement emménage en 1938 une veuve de fonctionnaire nommée Elfriede Fiegl, mère de deux enfants mariés, membre du parti, aryenne, pas d’antécédents judiciaires, habitant actuellement Reichenbergerstrasse 20.
Au second étage droite, logeaient depuis 1925 Rudolf Everding, lecteur à l’université, sa femme Gerda, née Schütte, et leur fils Oswald. Avant 1933, Everding avait été responsable d’une cellule d’entreprise — une maison d’édition — du parti communiste. Communiste actif. Membre de l’Association du Front des combattants rouges, a eu affaire entre 1928 et 1932 à la police de sécurité lors de manifestations de rue et de bagarres avec les SA. Arrêté par deux fois pour trouble porté à l’ordre public. Relâché. Everding avait été appréhendé chez lui dans la nuit même de l’incendie du Reichstag. Déporté au camp de concentration de Sachsenhausen, transféré un an plus tard à Börgermoor. Tentative d’évasion réussie, figure sur la liste des personnes recherchées. Pendant un certain temps, sa femme a été placée sous haute surveillance, mais sans succès : Rudolf Everding n’avait pas réapparu et on n’avait pas la moindre idée de l’endroit où il pouvait séjourner. Gerda Everding n’était pas non plus une page vide. Par deux fois, en juillet et septembre 1933, soupçonnée d’activités illégales, elle avait été arrêtée, puis libérée sous condition. Elle devait se présenter à la Gestapo tous les mois et habitait à présent dans le quartier ouvrier de Wedding.
Au rez-de-chaussée gauche, à côté du fonds de commerce, habitaient un certain Ruprecht Haas, son épouse et leur fils. Gérant du magasin jusqu’au printemps 1943. Arrêté en janvier 1943 pour haute trahison et déporté à Bautzen, transféré peu après à Buchenwald. Porté disparu l’été 1944, lors d’un raid de bombardement sur les camps de travail annexes, puis déclaré mort. Au printemps 1943, Frau Haas échangea son appartement contre la mansarde de Fräulein Frick. En mars 1944, Frau Haas et son fils sont tués lors du bombardement qui a détruit l’immeuble.
Il empila sur l’étagère les dossiers qu’il venait d’éplucher. Drôle de communauté censée faire joyeusement la fête, comme Frau Stankowski avait voulu le lui faire accroire. En y regardant de près, cet immeuble devait grouiller de conflits. Rien que le dossier Everding. Il connaissait l’arrogance des rouges avant 33 pour l’avoir souvent vécue à la préfecture de police. Quand on les interrogeait, ils jouaient les intouchables, avaient toujours le soutien des avocats du Secours rouge, croyaient toujours qu’il serait impossible de les confondre. Mais après 33, le vent avait tourné, principalement pour les rouge foncé. Après l’incendie du Reichstag, plus personne ne put protéger des commandos SA des traîtres comme Everding.
En ce temps-là, il n’était encore qu’un petit fonctionnaire à la brigade des mœurs, mais il avait entendu des collègues se targuer de la rapidité avec laquelle on pouvait enfin mettre le holà aux agissements des délinquants, ce qui impressionnait beaucoup la majorité des fonctionnaires de police. Un court procès, sans ce blabla ennuyeux, sans les incessantes objections des avocats. Enfin l’Allemagne redevenait un pays sûr : on y combattait efficacement la criminalité, entendait-on alors dans les couloirs et à la cantine. Quelques-uns avaient bien parlé de droits du prévenu, de présomption d’innocence, mais le plus souvent à voix feutrée. Il n’avait pas pris part à ce genre de discussions.
Il tenait enfin un mobile de vengeance pour raisons politiques. Everding, un rouge indécrottable, avait échappé aux autorités et vivait vraisemblablement quelque part dans Berlin, probablement avec des faux papiers, travaillant dans la clandestinité aux ordres de Moscou et assassinant ses anciens voisins.
La forêt lui donna l’impression d’être retournée à l’état sauvage. Des feuilles en décomposition recouvraient le sol et plus personne ne semblait se donner la peine d’en débarrasser les chemins. Il y avait partout des branches ou des souches d’arbres récemment coupées. Pénurie de charbon. Les Berlinois fourbissaient leurs armes pour l’hiver qui s’annonçait et transformaient la forêt de Grunewald en bois de chauffage.
C’était éprouvant de circuler à bicyclette sur le feuillage épais et glissant tout en gardant l’équilibre, alors qu’il fallait appuyer de toutes ses forces sur les pédales.
Karasek, ce bonze du parti corrompu et bedonnant, sans scrupules, qu’il savait capable de toutes les saloperies, avait donc été assassiné. Il s’habituait lentement à cette idée. Quelqu’un avait fait son travail à sa place, mais — nom de Dieu ! — il aurait tellement aimé échanger quelques mots avec ce vieux trafiquant. Il avait encore quelques questions sans réponse. Il lui aurait arraché les mots de la gorge à grands coups de poing, à cette crapule, et cette saleté lui aurait certainement avoué qui l’avait donné. Il lui fallait donc fureter encore un peu plus dans ce nid de vipères, ce panier de crabes de la communauté patriotique nationale, pour que quelqu’un lui avoue enfin la vérité.
Il ne restait plus sur sa liste que la mère Fiegl. On disait d’elle à l’époque qu’elle ne lavait pas que le linge de Karasek et ne lui repassait pas que ses chemises et que, depuis la mort de sa femme, elle l’aidait aussi à d’autres bricoles. Quoi qu’il en soit, elle était la dernière sur sa liste. Le cas échéant, il pourrait aussi rendre visite à Frau Everding. Il était évident qu’elle n’avait certainement rien à voir dans tout cela, mais peut-être avait-elle eu vent de quelque chose.
Rien ne collait dans cette histoire de la mort de Lotti et Fritzchen, avec les circonstances de leur mort. Il avait clairement eu le sentiment que Stankowski ne lui avait pas tout avoué. Malgré les gifles, la Frick ne lui avait servi que des échappatoires. Jusqu’à ce qu’il cogne plus fort. Elle s’était alors emportée en phrases confuses : elle savait bien qui l’avait dénoncé, mais elle ne le lui dirait pas, dût-elle mourir, parce qu’un sac de merde apatride comme lui ne méritait pas d’apprendre la vérité ; puis elle s’était moquée de lui, et bien que le sang lui dégoulinât déjà du menton, elle l’avait insulté en hurlant qu’il mourrait aussi idiot qu’il avait vécu. Seul le coup de pelle à incendie sur sa face de chienne avait réussi à la réduire au silence. Stankowski, lui, n’avait plus rien dit vers la fin, il avait trop de mal à déglutir…
Il suivit la lisière de la forêt et pédala sur le chemin de randonnée pédestre qui longeait le petit lac de Hundekehle en direction de la longue ligne droite de l’Avus où, avant la guerre, il avait souvent assisté à des courses automobiles. Durant des après-midi entiers, il avait admiré les coureurs qui fonçaient à grands coups de sifflements de pneus, comme Hermann Lang, Manfred von Brauchitsch ou Bemd Rosemeyer, enveloppés de nuages de vapeur d’essence. Ils avaient été ses héros.
Cloué à un tronc d’arbre, un écriteau altéré par les intempéries proclamait : « L’air de la forêt ne supporte pas l’odeur des Juifs ! » Il détourna le regard. Ça sentait le brûlé dans la forêt, une odeur à laquelle se mélangeait le parfum du bois fraîchement coupé. Une brume charbonneuse s’étirait entre les arbres.
Le long du chemin, dissimulés dans des buissons et sous le feuillage des arbres, apparaissaient à intervalle régulier des bancs qui invitaient à la flânerie malgré l’air humide et frais. Il avait le temps, il ne voulait regagner sa cabane de jardin que l’après-midi, en profitant de la protection du changement d’équipe des ouvriers. Il descendit de bicyclette et s’assit sur un banc. Col du manteau relevé, mains profondément enfouies dans les poches, jambes étendues devant lui, il contempla la surface de l’eau sale et grise. Alors qu’elle était déjà enceinte de plusieurs mois, Lotti l’avait accompagné une fois à une course automobile sur l’Avus. Tout en essayant vainement de couvrir le rugissement des moteurs, il lui avait expliqué que là, c’était Hartmann avec sa Maserati, là Delius dans une Auto Union et là, qui filait comme un zèbre dans une Mercedes-Benz tonitruante, le légendaire Rudolf Caracciola.
Читать дальше