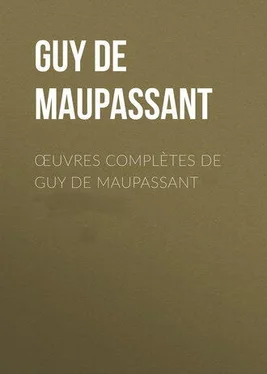Guy de Maupassant - Les sœurs Rondoli (1884)
Здесь есть возможность читать онлайн «Guy de Maupassant - Les sœurs Rondoli (1884)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Les sœurs Rondoli (1884)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Les sœurs Rondoli (1884): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Les sœurs Rondoli (1884)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La plupart des contes ont fait l'objet d'une publication antérieure dans des journaux comme Le Gaulois ou Gil Blas, parfois sous le pseudonyme de Maufrigneuse.
Les sœurs Rondoli (1884) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Les sœurs Rondoli (1884)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
« Mais attendu que Mme Luneau avait primitivement invoqué l’assistance de Hippolyte Lacour, moyennant une indemnité convenue et consentie de cent francs ;
« Attendu pourtant que si on peut estimer entière la bonne foi du sieur Lacour, il est permis de contester son droit strict de s’engager d’une pareille façon, étant donné que le plaignant est marié, et tenu par la loi à rester fidèle à son épouse légitime ;
« Attendu, en outre, etc., etc., etc.,
« Condamne Mme Luneau à vingt-cinq francs de dommages-intérêts envers le sieur Hippolyte Lacour, pour perte de temps et détournement insolite. »
21 août 1883
Un sage
Au baron de Vaux
Blérot était mon ami d’enfance, mon plus cher camarade ; nous n’avions rien de secret. Nous étions liés par une amitié profonde des cœurs et des esprits, une intimité fraternelle, une confiance absolue l’un dans l’autre. Il me disait ses plus délicates pensées, jusqu’à ces petites hontes de la conscience qu’on ose à peine s’avouer à soi-même. J’en faisais autant pour lui.
J’avais été confident de toutes ses amours. Il l’avait été de toutes les miennes.
Quand il m’annonça qu’il allait se marier, j’en fus blessé comme d’une trahison. Je sentis que c’était fini de cette cordiale et absolue affection qui nous unissait. Sa femme était entre nous. L’intimité du lit établit entre deux êtres, même quand ils ont cessé de s’aimer, une sorte de complicité, d’alliance mystérieuse. Ils sont, l’homme et la femme, comme deux associés discrets qui se défient de tout le monde. Mais ce lien si serré que noue le baiser conjugal cesse brusquement du jour où la femme prend un amant.
Je me rappelle comme d’hier toute la cérémonie du mariage de Blérot. Je n’avais pas voulu assister au contrat, ayant peu de goût pour ces sortes d’événements ; j’allai seulement à la mairie et à l’église.
Sa femme, que je ne connaissais point, était une grande jeune fille, blonde, un peu mince, jolie, avec des yeux pâles, des cheveux pâles, un teint pâle, des mains pâles. Elle marchait avec un léger mouvement onduleux, comme si elle eût été portée par une barque. Elle semblait faire en avançant une suite de longues révérences gracieuses.
Blérot en paraissait fort amoureux. Il la regardait sans cesse, et je sentais frémir en lui un désir immodéré de cette femme.
J’allai le voir au bout de quelques jours. Il me dit : « Tu ne te figures pas comme je suis heureux. Je l’aime follement. D’ailleurs elle est… elle est… » Il n’acheva pas la phrase, mais posant deux doigts sur sa bouche, il fit un geste qui signifie : divine, exquise, parfaite, et bien d’autres choses encore.
Je demandai en riant : « Tant que ça ? »
Il répondit : « Tout ce que tu peux rêver ! »
Il me présenta. Elle fut charmante, familière comme il faut, me dit que la maison était mienne. Mais je sentais bien qu’il n’était plus mien, lui, Blérot. Notre intimité était coupée net. C’est à peine si nous trouvions quelque chose à nous dire.
Je m’en allai. Puis je fis un voyage en Orient. Je revins par la Russie, l’Allemagne, la Suède et la Hollande.
Je ne rentrai à Paris qu’après dix-huit mois d’absence.
Le lendemain de mon arrivée, comme j’errais sur le boulevard pour reprendre l’air de Paris, j’aperçus, venant à moi, un homme fort pâle, aux traits creusés, qui ressemblait à Blérot autant qu’un phtisique décharné peut ressembler à un fort garçon rouge et bedonnant un peu. Je le regardais, surpris, inquiet, me demandant : « Est-ce lui ? » Il me vit, poussa un cri, tendit les bras. J’ouvris les miens, et nous nous embrassâmes en plein boulevard.
Après quelques allées et venues de la rue Drouot au Vaudeville, comme nous nous disposions à nous séparer, car il paraissait déjà exténué d’avoir marché, je lui dis : « Tu n’as pas l’air bien portant. Es-tu malade ? » Il répondit : « Oui, un peu souffrant. »
Il avait l’apparence d’un homme qui va mourir ; et un flot d’affection me monta au cœur pour ce vieux et si cher ami, le seul que j’aie jamais eu. Je lui serrai les mains.
« Qu’est-ce que tu as donc ? Souffres-tu ?
— Non, un peu de fatigue. Ce n’est rien.
— Que dit ton médecin ?…
— Il parle d’anémie et m’ordonne du fer et de la viande rouge. »
Un soupçon me traversa l’esprit. Je demandai :
« Es-tu heureux ?
— Oui, très heureux.
— Tout à fait heureux ?
— Tout à fait.
— Ta femme ?
— Charmante. Je l’aime plus que jamais. »
Mais je m’aperçus qu’il avait rougi. Il paraissait embarrassé comme s’il eût craint de nouvelles questions. Je lui saisis le bras, je le poussai dans un café vide à cette heure, je le fis asseoir de force, et, les yeux dans les yeux :
« Voyons, mon vieux René, dis-moi la vérité. » Il balbutia : « Mais je n’ai rien à te dire. »
Je repris d’une voix ferme : « Ce n’est pas vrai. Tu es malade, malade de cœur sans doute, et tu n’oses révéler à personne ton secret. C’est quelque chagrin qui te ronge. Mais tu me le diras à moi. Voyons, j’attends. »
Il rougit encore, puis bégaya, en tournant la tête :
« C’est stupide !… mais je suis… je suis foutu !… »
Comme il se taisait, je repris : « Ça, voyons, parle. » Alors il prononça brusquement, comme s’il eût jeté hors de lui une pensée torturante, inavouée encore :
« Eh bien ! j’ai une femme qui me tue… voilà. »
Je ne comprenais pas. – « Elle te rend malheureux. Elle te fait souffrir jour et nuit ? Mais comment ? En quoi ? »
Il murmura d’une voix faible, comme s’il se fût confessé d’un crime : « Non… je l’aime trop. »
Je demeurai interdit devant cet aveu brutal. Puis une envie de rire me saisit, puis, enfin, je pus répondre :
« Mais il me semble que tu… que tu pourrais… l’aimer moins. »
Il était redevenu très pâle. Il se décida enfin à me parler à cœur ouvert, comme autrefois :
« Non. Je ne peux pas. Et je meurs. Je le sais. Je meurs. Je me tue. Et j’ai peur. Dans certains jours, comme aujourd’hui, j’ai envie de la quitter, de m’en aller pour tout à fait, de partir au bout du monde, pour vivre, pour vivre longtemps. Et puis, quand le soir vient, je rentre à la maison, malgré moi, à petits pas, l’esprit torturé. Je monte l’escalier lentement. Je sonne. Elle est là, assise dans un fauteuil. Elle me dit : « Comme tu viens tard ». Je l’embrasse. Puis nous nous mettons à table. Je pense tout le temps pendant le repas : « Je vais sortir après le dîner et je prendrai le train pour aller n’importe où ». Mais quand nous retournons au salon, je me sens tellement fatigué que je n’ai plus le courage de me lever. Je reste. Et puis… et puis… Je succombe toujours… »
Je ne pus m’empêcher de sourire encore. Il le vit et reprit : « Tu ris, mais je t’assure que c’est horrible.
— Pourquoi, lui dis-je, ne préviens-tu pas ta femme ? À moins d’être un monstre, elle comprendrait. »
Il haussa les épaules. « Oh ! tu en parles à ton aise. Si je ne la préviens pas, c’est que je connais sa nature. As-tu jamais entendu dire de certaines femmes :
« Elle en est à son troisième mari ? » Oui, n’est-ce pas, et cela t’a fait sourire, comme tout à l’heure. Et pourtant, c’était vrai. Qu’y faire ? Ce n’est ni sa faute, ni la mienne. Elle est ainsi, parce que la nature l’a faite ainsi. Elle a mon cher un tempérament de Messaline. Elle l’ignore, mais je le sais bien, tant pis pour moi. Et elle est charmante, douce, tendre, trouvant naturelles et modérées nos caresses folles qui m’épuisent, qui me tuent. Elle a l’air d’une pensionnaire ignorante. Et elle est ignorante, la pauvre enfant.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Les sœurs Rondoli (1884)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Les sœurs Rondoli (1884)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Les sœurs Rondoli (1884)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.