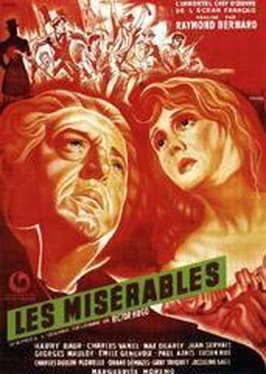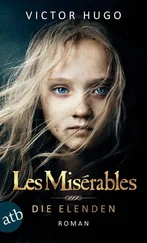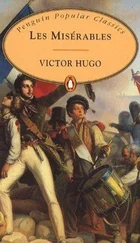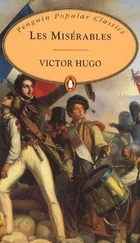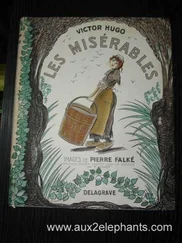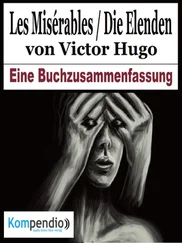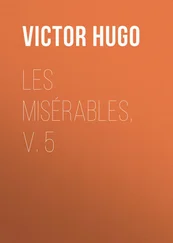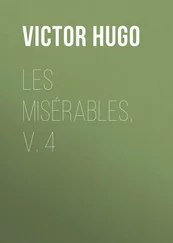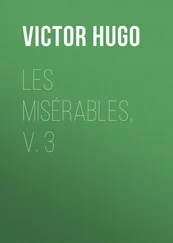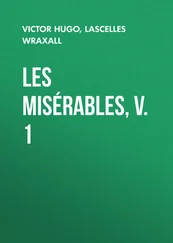Toute la conversation qui suit – la partie de domino – reproduit à peu près un fragment dramatique daté du 30 mars 1855 (voir éd. J. Massin, t. IX, p. 990).
[25]Escousse et Lebras se suicidèrent après l'échec de leur drame Raymond , joué à Paris en février 1832, répétant ainsi le geste du Chatterton de Vigny.
[26]Sauf Balzac qui, note M. M.-F. Guyard ( Les Misérables , Garnier, «Classiques Garnier»), décrit ce lieu au début de la quatrième partie de La Femme de trente ans .
[27]Voir déjà II, 4, 1 et note 3. Hugo avait vu, en septembre 1827, le bourreau «répéter» l'exécution de Louis Ulbach qui devait avoir lieu le lendemain. Ce spectacle et cette mort firent sur lui une impression profonde qui ne fut pas étrangère à la rédaction du Dernier Jour d'un condamné .
[28]Némorin: amant d'Estelle dans le roman de Florian. Schinderhannes (Jean l'Écorcheur): chef d'une bande de voleurs, guillotiné en 1803 – figure importante de l'imaginaire sadique hugolien, dans Châtiments en particulier.
[29]Déjà Panchaud – en III, 8, 10 (p. 603) – avait de cette façon signé son nom. Le condamné du Dernier Jour … observe avec la même fascination les noms gravés sur les murs de sa cellule et Hugo, visitant la Conciergerie en septembre 1846, note soigneusement les noms et inscriptions charbonnés sur les murs avant d'écrire lui-même, au crayon, quelques vers sur un pilier – voir Choses vues , ouv. cit., 1830-1846, p. 397-433.
[30]Le lecteur, lui, en est sûr: voir la liste des affiliés de Patron-minette en III, 7, 4.
[31]C'était en III, 2, 6.
[32]Le château de Vauvert était hanté par les diables, croyait-on à Paris depuis le Moyen Age. La manufacture installée sur la Bièvre tire, elle, son nom de son fondateur au XVe siècle, Jehan Gobelin.
[33]Célèbres historiens et philosophes du droit, allemands, de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. Hugo savait peut-être que cette querelle opposait à Gans non seulement Savigny, mais aussi Gustave Hugo.
[34]C'est rue Plumet que le général Hugo passa les derniers mois de sa vie et mourut – voir III, 3, note 51. Par ailleurs on lit dans le dossier Faits contemporains (d'où beaucoup de matériaux ont été extraits pour Les Misérables ) la description et l'histoire d'une maison environnée d'un jardin, construite en 1787 par le comte d'Artois pour la Guimard, habitée ensuite par Joséphine de Beauharnais et enfin, en 1822, par le vieux général Bertrand. Son architecture aussi a beaucoup de points communs avec cette maison de Jean Valjean (texte daté 1845-1846, éd. J. Massin, t. VII, p. 959-960).
[35]Il y eut, pendant la Révolution, une section parisienne portant ce nom. Le beau-père de Hugo, P. Foucher en relevait (voir Souvenirs , Pion, 1929, p. 77). Ce nom n'a pas été choisi au hasard par Hugo qui avait d'abord écrit rue Planche-Mibray.
[36]La multiplication des domiciles, utile à l'action, est parallèle à celle des noms, forme de l'anonymat. D'autre part on ne peut pas ne pas voir ici une ironique allusion autobiographique: au moment où il commence Les Misérables , Hugo aussi a trois domiciles: le sien, celui de Juliette et celui de Léonie Biard, séparée de son mari. Enfin les trois adresses ont valeur symbolique autant que biographique. Le père de Hugo mourut rue Plumet; la rue de l'Ouest, actuelle rue d'Assas, parallèle à la rue Notre-Dame-des-Champs était voisine de la demeure des Hugo et de la maison d'Adèle au temps de leur jeunesse; la rue de l'Homme-Armé – au nom éloquent – passait pour la plus misérable de Paris.
[37]L'ameublement typiquement hugolien de Cosette (baldaquin, damas rouge ornèrent toutes les demeures de Hugo du palais Masserano à l'avenue d'Eylau) est complété par le lit de sangle de Jean Valjean qui reprend la baraque du couvent – voir II, 8, note 16 – elle-même écho de la chapelle habitée par Lahorie au fond du jardin des Feuillantines. Hauteville-House répète cette disposition, mais en hauteur, avec le «look-out» et la minuscule chambre à petit lit du poète.
[38]C'est l'église la plus proche des Feuillantines et elle avait, pour Hugo, une valeur toute particulière. «Cette église […] a de grosses colonnes et des entrecolonnements assez élevés. Un des plaisirs des petits Hugo était de sauter de ces entrecolonnements à terre.
[39]Ce détail se révélera important en V, 1, 4.
[40]Hugo n'aimait guère le maréchal Mouton, comte Lobau, qui commandait la garde nationale sous Louis-Philippe. Voir déjà, dans Claude Gueux : «Il est très important de faire des lois pour que j'aille, déguisé en soldat, monter patriotiquement la garde à la porte de M. le Comte de Lobau que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître.»
[41]D'un vers de Lucrèce ( De natura rerum , V, 971): «[…] s'enveloppant de feuilles et de branches ». Du parc des Feuillantines que les enfants découvrirent «inculte, sauvage, […] forêt vierge», Hugo garda le goût des jardins livrés au désordre et aux forces de la nature. Préférence contraire à la passion de sa mère pour le jardinage et qui s'exprime dans l'ambiguïté du thème: «Un jardinier est un fossoyeur», a dit Fauchelevent en II, 8, 1.
[42]En fait, soit moins, 34 ans, s'il s'agit du moment (1827-1828) où Hugo allait quotidiennement voir son père rue Plumet; soit plus, 50 ans, s'il s'agit de l'époque (1812) où il habitait Les Feuillantines dont le jardin de la rue Plumet ressuscite les splendeurs. Mais il est vrai que Hugo retourna aux Feuillantines en 1822 pour y rencontrer Lamennais (voir I, 3, note 23).
[43]Sur ce principe de l'unité du monde dont Hugo a la première intuition à Montreuil-sur-Mer, en 1837, et qu'il formule dans la lettre à sa femme (éd. J. Massin, t. V, p. 1307-1308), voir déjà I, 5, note 1.
[44]Le mot «compression» est souvent employé, au XIXe siècle, dans le sens technique de notre actuel «répression».
[45]La même course, le même essoufflement, et un autre baiser, sont le premier et l'unique souvenir d'amour du condamné dans Le Dernier Jour … (chap. XXXIII). Ce chapitre et les suivants sont imprégnés du souvenir de Léopoldine, mêlé à celui d'Adèle petite.
[46]Marchands de nouveautés à la mode.
[47]Ne pouvant faire venir à lui une montagne, Mahomet alla, sagement, vers elle.
[48]Voir tout le livre 6 de la troisième partie, La conjonction de deux étoiles .
[49]Hugo avait assisté au ferrement puis au départ des forçats pour Toulon lors d'une visite à Bicêtre, le 24 octobre 1827, avec David d'Angers et décrit déjà ce spectacle dans Le Dernier Jour d'un condamné .
[50]Cette Vestale est là par dérision; sa première représentation date de 1807.
[51]Les traces s'en voient chez Hugo jusque dans le projet de discours sur les prisons, préparé pour la Chambre des Pairs en mai 1847 (éd. J. Massin, t VII, p. 119).
[52]Cette leçon a déjà trouvé son application dans Le guet-apens, III, 8, 20 et 21.
[53]La mère Plutarque a autant de crédulité que l'historien grec dont elle porte le nom.
[54]Il lui a été présenté en III, 3,7 et Gillenormand a exécuté «le remplaçant» en III, 5, 6.
[55]Opéra de Weber créé à Paris en 1831. Adèle, la fille de V. Hugo, avait noté en septembre 1854 ce propos de son père: «Lorsque je vis Paganini pour la première fois, c'était en 1835 ou en 1836, à une répétition d'un opéra de Weber, Euryanthe . C'est là que j'ai entendu le choeur d' Euryanthe que je considère comme une des plus belles choses de la musique.» ( Journal d'Adèle Hugo . Minard, 1984, t. III, p. 350.)
Читать дальше