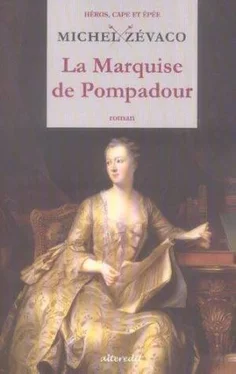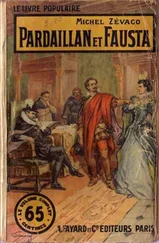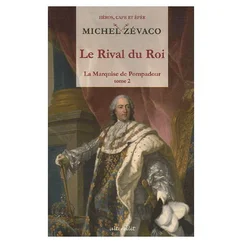Cette fois, du Barry parlait avec une évidente sincérité.
Juliette Bécu, profondément troublée de cette terreur qu’elle voyait chez son redoutable compagnon, n’osa pas insister.
– Quoi qu’il en soit, reprit-elle pour détourner les soupçons qu’elle craignait d’avoir éveillés dans l’esprit de du Barry, M. Jacques se conduit avec moi en vrai galant homme… Cette demeure… cette prison qu’il m’assigne, est une véritable bonbonnière. Tout y est d’un goût charmant. Et que me faut-il de plus à moi, pauvre fille…
– Pauvre fille? Vous? ricana du Barry; mais vous êtes comtesse, ma chère, ne l’oubliez jamais.
– Oh! sur la scène, je n’aurai garde de l’oublier; mais ici, dans la coulisse…
– Vous avez tort, mon enfant, fit brusquement une voix.
Juliette et du Barry tressaillirent, et, se retournant, aperçurent M. Jacques.
Ils pâlirent.
Par où était-il entré?…
Comment se trouvait-il là, à deux pas, au milieu du salon, souriant et paternel?…
Une sorte de superstitieuse épouvante s’empara d’eux.
Toutes les portes étaient fermées…
Ils n’étaient pas éloignés de croire que le mystérieux personnage était armé d’une surhumaine puissance.
– Il sait tout! Il voit tout! Il entend tout! se dit Juliette palpitante en répétant les paroles que le comte venait de prononcer.
– Vous avez tort, continuait M. Jacques avec son paisible sourire, de supposer que vous êtes comtesse du Barry en certaines circonstances et que vous ne l’êtes pas en d’autres. Toujours et partout, vous êtes la comtesse du Barry. Et en voici la preuve que je vous apportais, et que je vous laisse…
À ces mots, il étala sur un guéridon un parchemin que Juliette et le comte parcoururent ensemble avec la même avidité et le même étonnement.
C’était un acte en règle signé par le curé de Saint-Eustache, avec signatures de témoins à l’appui, qui certifiait véritable et valable le mariage du comte du Barry et de Juliette Bécu. La date remontait à trois années en arrière.
– À bientôt, mon enfant, reprit M. Jacques. Comte, voulez-vous m’accompagner? J’ai besoin de vos infatigables bons offices. Il faut que je traverse les champs qui entourent Versailles, et figurez-vous que la nuit, seul, j’ai peur!
Du Barry suivit M. Jacques. Il chancelait presque.
Juliette, demeurée seule, tint longtemps son regard fixé sur le parchemin.
Elle méditait.
– Eh bien! soit, murmura-t-elle enfin avec un frisson. Je suis dans les mains de cet homme. J’irai jusqu’au bout… J’empêcherai M med’Étioles de devenir la favorite du roi… mais…
Elle s’arrêta, haletante, regardant autour d’elle, comme si elle eût craint que sa pensée même ne fût surprise. Puis, elle acheva:
– Mais je ne veux pas qu’on tue ce pauvre petit chevalier d’Assas, moi!…
La Maison où Jeanne avait consenti à entrer sur la promesse formelle que le roi n’y entrerait lui-même qu’en plein jour et qu’elle y pourrait recevoir qui bon lui semblerait était disposée de la façon suivante:
L’entrée d’abord. Une pièce à droite, une à gauche; celle de droite était occupée par l’office et la cuisine; celle de gauche par la cuisinière et deux filles de service. Au fond de l’entrée s’ouvrait l’antichambre; à droite de l’antichambre, la salle à manger; à gauche, un petit salon.
Salles à manger, antichambre et salon donnaient par des portes-fenêtres sur un jardin assez vaste et parfaitement entretenu, entouré de hautes murailles difficiles à escalader; il n’y avait à ces murs qu’une petite porte bâtarde par où entrait tous les matins un jardinier qui ne pénétrait jamais dans la maison et qui, une fois son ouvrage fait, se retirait.
Dans l’entrée, un petit escalier tournant permettait d’accéder au premier étage qui comprenait cinq pièces dont la plus petite était occupée par la femme de chambre et dont les quatre autres, assez vastes, constituaient l’appartement privé de la maîtresse.
Chambre à coucher d’une royale élégance, grand salon-atelier comme c’était la mode à cette époque où toutes les grandes dames faisaient de la peinture, de la musique et même de la gravure; boudoir encombré de bibelots, et enfin magnifique cabinet de toilette.
La femme de chambre était cette fille même qui avait ouvert au roi et que Bernis avait signalée à M. Jacques.
Elle était pour ainsi dire l’intendante de cette maison, qu’elle menait au doigt et à l’œil. Elle régnait despotiquement sur les trois domestiques, c’est-à-dire sur la cuisinière et les deux filles de service, qui ne devaient jamais franchir l’entrée ou monter en haut que sous sa surveillance et qui, leur besogne achevée, disparaissaient dans leur coin, Suzon seule demeurant en relations avec la maîtresse de céans.
C’était une fille de vingt-deux ans, très fine, très exercée à tout comprendre à demi-mot, d’une discrétion à toute épreuve, et enfin très apte aux fonctions qui lui étaient dévolues.
Bernis l’avait peinte d’un mot: une fine mouche.
Suzon, comme tout être vivant au monde, avait son idéal.
C’était une rusée commère à demi-Normande, à demi-Picarde, – le grand La Fontaine eût dit: Normande à demi.
Elle avait un bon sens pratique et une façon d’envisager la vie qui lui faisait un peu mépriser et pas du tout envier ce qui l’entourait. Elle avait résolu de vivre heureuse, à sa guise, et n’avait pas tardé à comprendre tout ce que la vie des grands cache de misère morale et de servitude.
Qu’on n’aille pas en conclure à une certaine fierté de caractère.
Suzon était une jolie matoise, voilà tout.
Et quant à son idéal que nous avons promis d’exposer, nous allons l’entendre développer par elle-même.
Dès le lendemain du jour où Jeanne était entrée dans la maison, Bernis, comme on l’a vu, s’était mis en campagne en allant trouver le chevalier d’Assas à l’auberge des Trois-Dauphins.
– Voilà la première partie de mon œuvre, se dit-il quand il fut rentré au château. Reste la deuxième, la plus difficile, qui est de pénétrer dans la maison et de séduire la jolie Suzon.
Bernis, qui était surtout homme de comédie et d’intrigue, était prodigieusement intéressé par ce qu’il allait entreprendre.
En somme, il avait mission de se mettre au mieux avec Suzon et de lui faire certaines propositions que lui avait fort clairement exposées M. Jacques: il fallait tout simplement amener Suzon à trahir le roi et Berryer.
– Le roi? passe encore! songeait le poète-abbé; mais le lieutenant de police? Hum! Ce sera difficile.
Le lendemain, donc, il s’en vint rôder autour de la maison, en plein jour.
Pendant deux heures, il ne vit rien.
Les volets étaient clos.
La maison paraissait abandonnée.
Mais la grande qualité de Bernis était la patience.
Il patienta comme le chasseur à l’affût.
Et sa constance fut enfin récompensée: sans doute, s’il n’avait rien vu, on l’avait vu, lui, de l’intérieur. Car à un moment donné, l’une des fenêtres du premier étage s’ouvrit, comme si on eût voulu aérer une pièce, et Suzon parut, mais elle ne sembla nullement avoir aperçu Bernis.
Celui-ci n’hésita pas. Il fit rapidement quelques pas en avant, et de son bras valide (il avait toujours le gauche en écharpe), il fit un signe, puis envoya un baiser.
Suzon eut un éclat de rire et referma la fenêtre.
Mais elle avait vu Bernis! Elle avait vu qu’il était blessé! Et bien qu’elle ne fût pas d’une sensibilité excessive, elle ne put s’empêcher de tressaillir… Peut-être Bernis avait-il compté un peu sur l’impression que produirait sa blessure: un bras en écharpe étant toujours une chose intéressante pour les femmes, ces douces créatures qui, au fond, ne rêvent que plaies et bosses et sont toujours enchantées d’un récit de bataille. Bien entendu, c’est l’opinion de Bernis que nous donnons là. Quant à la nôtre, nous supposons que nos lectrices n’en ont que faire.
Читать дальше