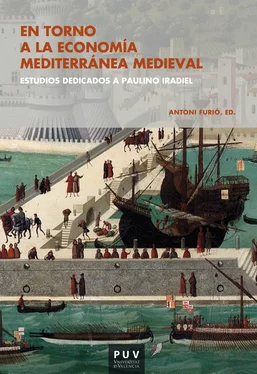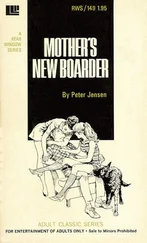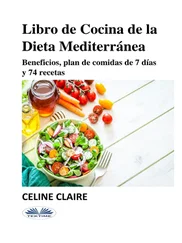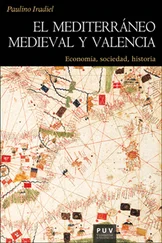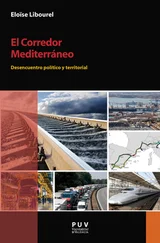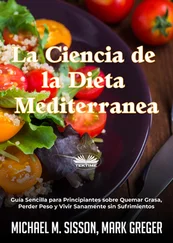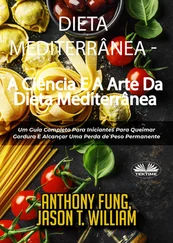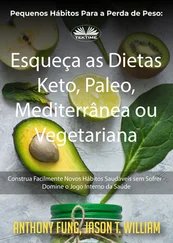C’est cette image qui peut être proposée du monde du labeur vénitien, bien qu’elle soit assurément incomplète. Les sources manquent en effet, est-il besoin de le préciser, pour mieux déterminer les hiérarchies et les clivages, pour donner vie à ces acteurs d’une chronique économique qui a longtemps semblé comme sans grand relief au regard de l’aventure maritime.
Examinons maintenant les activités et les productions
Dans cette agglomération qui compta plus de 100.000 habitants et où le niveau de vie des dominants était fort élevé, toute une série de métiers travaillait en premier lieu pour nourrir, vêtir, chausser, abriter, divertir cette population, la fournir en objets simples ou plus raffinés. A côté des marchands et des charpentiers de navires, il nous faut faire ressurgir des bouchers et des pâtissiers, des maîtres de danse et d’escrime, des cabaretiers et des merciers, des barbiers et des apothicaires, des fabricants de chandelles et des jardiniers, des fripiers et des tailleurs, des orfèvres et des fourreurs, des cordonniers et des tisserands… Les inventaires après décès des plus misérables des populaires citent au moins, à côté du lit et des escabeaux, quelques draps et hardes, un seau, une marmite et la chaîne pour l’accrocher. 15
Il fonctionna donc à Venise, et particulièrement dans la paroisse de San Barnaba, une petite métallurgie, bien que la concurrence de la Terre Ferme, dès le XIV esiècle, lui ait porté des coups sévères. 16 Il exista de même une industrie du coton ou de la futaine, qui traitait une part du coton importé par les bâtiments vénitiens, même si les futaines lombardes ou les tissus de coton allemands, à partir du XV esiècle, l’ébranlèrent sérieusement. 17 Il y eut aussi aux siècles modernes une production, sans doute massive, d’une céramique peinte d’usage courant mais joliment décorée, aux motifs verts et jaunes surtout. La lagune, les zones de remblaiement qui livrent en abondance fragments plus ou moins cassés, poteries un peu décolorées, en portent témoignage. Et puis, là comme ailleurs, certains secteurs employaient une main d’œuvre nombreuse. Dès la fin du XIII esiècle, les tanneurs polluent suffisamment pour que la commune décide de les éloigner de l’autre côté du canal de la Giudecca, dans l’île homonyme. Leur industrie y est attestée dès 1285: un conflit oppose, à cette date, les artisans du cuir à des officiers publics qui leur contestent la libre disposition de l’eau. Au XV esiècle, cette activité économique est toujours bien présente, au voisinage du ponte lungo . De même, comment imaginer que Venise, ses palais, ses églises, ses maisons, ses quais et ses ponts soient surgis de l’eau sans évoquer les ouvriers et les maîtres du bâtiment, les sculpteurs mais aussi les manœuvres et les tâcherons, sans rappeler les fours à briques nécessaires aux constructions que revêtaient simplement des parements de pierre? 18 Enfin, le tableau ne serait pas complet si l’on ne décrivait pas, à la périphérie de la ville, toutes ces parcelles où étaient séchés et entreposés les bois de flottage qui ravitaillaient l’agglomération. Au nord de la paroisse des Santi Giovanni e Paolo, en allant vers Santa Giustina, dans la Barbaria de le Tole , les marchands de bois étaient depuis longtemps installés. Mais on retrouvait les aires de stockage ailleurs, sur des terrains de conquête récente, à proximité de fabriques de chandelles, de fonderies ou de raffineries de sucre quoique la concurrence croissante du sucre atlantique et les arrivages, en provenance de Chypre, de sucre déjà raffiné, aient affecté au début du XVI esiècle cette spécialité vénitienne.
Il reste que, longtemps, aucune activité ne parut véritablement se détacher. Et de cette médiocrité du centre industriel vénitien, le métier de la laine fut considéré, je l’ai dit, comme le symbole le plus fort. On connaît l’essor, au XIII esiècle, de l’industrie textile florentine. Dans les mêmes décennies à Venise, les lanaiuoli semblent bien modestes, lorsqu’ils sont mentionnés par la chronique de Martino da Canal parmi les divers métiers qui participent aux cérémonies fêtant l’élection du doge Lorenzo Tiepolo. La rédaction des statuts de l’art a suivi, semble-t-il, l’institution en 1244 des Consuls des Marchands et ce premier texte concernait les tisserands, d’abord organisés. 19 La réglementation et les prescriptions techniques s’étendent ensuite au filage, à la teinture, aux diverses branches du métier, qui fut entièrement placé sous la responsabilité des Consuls. La Commune s’efforce donc, alors, de mettre sur pied une industrie capable de répondre à certains des besoins du marché local même si elle ne peut affronter, pour les trafics, la concurrence des draps étrangers. De fait, signe de cette dépendance, tout au long du XIV esiècle, les maîtres de l’art continuent à siéger au marché du Rialto, à proximité de la Draperia où sont entreposés les étoffes étrangères. Pour ce qui est du travail, il nous demeure, jusqu’à tard, à peu près inconnu. Certains textes paraissent, à la fin du XIII esiècle, vouloir le cantonner au nord de la lagune, autour des îlots de Torcello. 20 Mais leur application semble douteuse et, au début du XIV esiècle au moins, la liberté du travail de la laine paraît établie à Venise. Avant cette date, le filage, source d’emploi pour les femmes, ne quitta sans doute pas Rialto. Une dernière touche vient compléter cette description déjà bien terne: le site multipliait les diffficultés. L’appui technique de la Terre Ferme s’avéra d’abord indispensable. Faute d’eau douce, les draps étaient envoyés au foulage à Trévise, à Padoue et à Portogruaro.
Vaille que vaille pourtant, cette histoire se poursuit. Et au XV esiècle, la fabrication commence à marquer d’une empreinte plus ferme la topographie urbaine. Au sud-ouest de Venise, dans la paroisse de San Simone Propheta, auprès du rio Marin, le travail est regroupé. A son tour, l’administration du métier s’installe sur ces rives où elle peut, avec une facilité accrue, effectuer les contrôles techniques nécessaires. Au début du XVI esiècle, c’est une véritable concentration industrielle qu’il nous est donné d’observer: présence des équipements indispensables, vastes terrains d’étendage ( chiovere ) où les draps sèchent, après la teinture, sur des cadres de bois, maisons populaires construites en série, «lainiers» et tisserands nombreux dans les listes des locataires… A partir de ce centre, l’art pousse même quelques antennes vers les paroisses voisines. Mais surtout, preuve d’un dynamisme réel, au début du XVI esiècle, le travail de la laine peut, hors de cette zone, rassembler encore ponctuellement des groupes d’ouvriers. Au nord, en plein périmètre soyeux, quelques petits unités de fabrication lainière fonctionnent. Plus souvent, les métiers de la laine sont localement associés à d’autres activités industrielles qui définissent le rôle des confins. Des teintureries et leurs zones d’étendage des draps attenantes jalonnent ainsi le revers lagunaire. La commune, avec constance, s’était attachée à rejetter, loin des canaux du centre urbain, la teinture et ses rejets polluants. Et, en 1413, décision avait été prise d’éloigner «aux extrémités urbaines», sur les lisières que bordait la palud, les teintures au sang et à l’indigo. Au début de l’époque moderne, ces efforts sont entrés dans les faits. Les ateliers et les champs de séchage, au caò di Cannaregio, à San Girolamo ou à Sant’ Alvise, participent de l’exploitation, encore très extensive, de la périphérie. 21
L’industrie de la laine, quasi invisible des décennies durant, inscrit dorénavant avec vigueur sa présence dans la trame et dans l’économie urbaines. Comment expliquer ces évolutions? L’essor, spectaculaire au cours du XVI esiècle, de la production lainière est aujourd’hui compté parmi les causes du rebond contemporain de l’économie vénitienne. Dans le dernier tiers du XVI esiècle, Venise aurait fabriqué entre 20.000 et 26.000 pièces de laine; et, en 1602, un maximum de 28.700 pièces aurait même été atteint. C’est dire l’ampleur de la croissance puisque, selon les estimations les plus optimistes, cette même production, vers 1500, se serait située à une hauteur de 2.000 pièces par an. 22 Il reste que les indices convergent pour attester des progrès plus précoces, clairement accélérés durant la seconde moitié du XV esiècle. Des draps vénitiens d’excellente qualité sont alors couramment exportés sur les marchés d’Orient. On les repère sans difficulté à Constantinople, en Syrie et en Egypte et il s’agit le plus souvent de pièces d’écarlate, les fameux bastardi de grana. 23 J’en déduis que le «know how» des teinturiers de Venise, connus par exemple pour leur gamme de rouges, entre pour beaucoup dans l’élan de la laine. 24
Читать дальше